- LA
BAGARRE DE NÎMES
-
les
13, 14 et 15 juin 1790
-
par l'Abbé
Goiffon, 1871
|
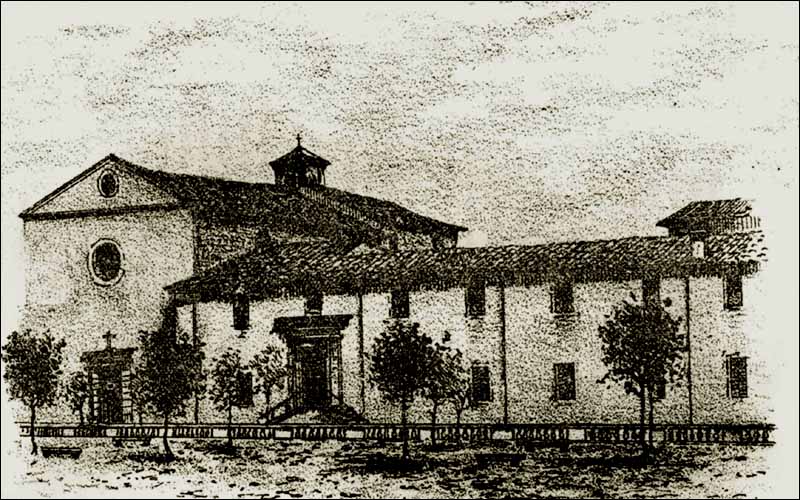
- L'ancienne
église et le couvent des Capucins, devenue église Ste Perpétue
-
A peine l'édit de 1787 eut-il rendu
aux Protestants le libre exercice de leur culte religieux, qu'ils
cherchèrent à s'assurer dans Nîmes, d'une école pour leurs
prédicants et d'un temple pour leur prêche. Ils jetèrent les yeux
sur l'église et le couvent des Capucins ; mais le moment ne leur
sembla pas encore venu de mettre ce projet à exécution, ils surent
donc le tenir dans le secret ; mais lorsque, en 1789, l'Assemblée
nationale agita la question de la liberté absolue des cultes, les
Calvinistes crurent pouvoir enfin exécuter leur des-sein et ils
firent offrir une somme de 200,000 livres de l'église et du
couvent. Ces avances officieuses furent rejelées avec indignation
et dès cet instant il fut convenu dans le parti qu'on userait de
tous les moyens, pour arriver au but. C'est ce qui nous explique la
fureur particulière déployée contre les Capucins ; on trouvait,
en effet, plus simple d'avoir l'établissement pour rien en
égorgeant et terrorisant les religieux et en s'en emparant de vive
force ; on s'épargnait ainsi les dépenses d'achat Infâme calcul
qui fit couler le sang et donna à l'Église de nouveaux martyrs,
mais qui ne fournit pas aux protestants l'établissement qu'ils
désiraient.
-
-
Par suite d'une coalition formée
sous l'influence de la mauvaise foi du parti protestant, qui, selon
son habitude, avait fait accepter ses candidats aux catholiques sous
promesse de soutenir les leurs ce qu'il s'était ensuite bien gardé
de faire, les élections municipales de 1790 firent entrer dans le
conseil de ville une forte majorité catholique. Le mot-d'ordre fut
immédiatement donné ; il fut résolu de renverser à tout prix la
nouvelle administration et, dans ce but, on chercha toutes les
occasions de susciter des troubles dans la ville.
-
-
Une première émeute grave éclata
dès le commencement de mai entre des catholiques et des soldats du
régiment de Guienne,
excités par des gardes nationaux protestants.
-
-
L'énergique attitude de M. de
Marguerittes, maire de Nîmes et député à l'Assemblée
Constituante parvint, pour le moment à rétablir l'ordre ; l'audace
du parti devait bientôt amener de nouvelles collisions. Le Corps
municipal parvint à les empêcher jusqu'au 13 juin ; mais, ce
jour-là, sous un prétexte futile, imaginé par les dragons
huguenots de la garde nationale, les légionnaires catholiques sans
armes furent reçus sur la place de la Cathédrale à coups de fusil
; plusieurs furent blessés. En même temps, des ordres expédiés
dans les communes protestantes du voisinage amenèrent à Nîmes
plus de 5,000 gardes nationaux, qui allèrent camper sur
l'Esplanade, en face du couvent des Capucins, et dont le but,
hautement avoué, était le massacre des catholiques nîmois et en
particulier des officiers municipaux et des Capucins. Les huguenots
ne pouvaient oublier, en effet, que l'établissement de ces
religieux à Nîmes avait eu pour but de les ramener à la foi
catholique et que, fidèles à leur mission, ils avaient converti un
grand nombre de religionnaires.
-
-
Mais il fallait un prétexte. On
essaya de le faire naître, le lundi 14 juin, dans une visite
domiciliaire que le major de la légion fit faire dans le couvent,
sur les onze heures du matin. Malgré la sévérité des recherches,
on ne put trouver rien de suspect dans le monastère; on n'y
rencontra surtout ni armes, ni hommes cachés. Recommandation fut
faite aux religieux de fermer soigneusement leurs portes et leurs
fenêtres; ils obéirent à l'instant.
-
-
Quelques heures après, les religieux
récitaient leurs vêpres dans l'église, lorsqu'un coup de fusil
éclata aux environs de l'Esplanade ; c'était un signal. Ce coup ne
blessa personne, mais occasionna un certain désordre parmi les
volontaires étrangers. A ce moment, par suite de la maladresse d'un
de ces hommes, un nouveau coup de feu vint donner la mort à M.
Massip, officier municipal de Saint-Cosme.
-
-
Quoique les portes et les fenêtres
du couvent fussent hermétiquement fermées, ceux qui cherchaient,
l'occasion de verser le sang prétendirent aussitôt que le coup
était parti de chez les Capucins. La foule se porte alors avec
fureur sur le monastère, s'écriant qu'il faut en finir avec les
prêtres et les porteurs de froc ; la porte est enfoncée à coups
de haches et les assassins se répandent dans le cloître.
-
-
Les religieux purent pour la plupart
trouver un refuge contre les envahisseurs ; trois se cachèrent sur
la voûte de l'église, deux sur le plafond de la bibliothèque,
trois autres sur celui ; du dortoir et trois enfin dans une ruelle
ou impasse qui se trouve entre l'église et le Luxembourg. Le
supérieur, âgé de 70 ans, entraîné par le jardinier, eut à
peine le temps de sortir ; six avaient fui en franchissant les murs
du jardin, ils se sauvèrent à travers champs; un des frères était
absent de Nîmes ; mais cinq d'entre les religieux devinrent les
victimes des assaillants.
-
-
Le Père Benoit, de Beaucaire, âgé
de 50 ans, fut saisi dans une des chapelles de l'église : « Mon
ami, dit-il à son bourreau, donnez-moi le temps d'achever ma prière
et vous m'immolerez ensuite si tel est votre dessein.
» Le barbare sort sa montre et lui accorde cinq minutes ; dès que
ce terme est expiré, il lui tire un coup de fusil et lui plonge sa
baïonnette dans le corps. Le P. Benoit vint rendre le dernier
soupir à la porte de l'église qui conduisait au monastère.
Beaucoup se souviennent encore d'avoir vu les dalles empreintes de
son sang, non loin de l'escalier qui montait au premier étage du
couvent.
-
-
Le Père Siméon, né à Sanilhac,
vers 1750, fut percé en mille sens divers à coups de fourches et
de baïonnettes, dans sa cellule même.
-
-
Le Père Séraphin (Reboul), né à
Nîmes, vers 1762, capucin du couvent de Pont-Saint-Esprit, était
arrivé à Nîmes, la veille, pour visiter sa famille, il fut
massacré dans le dortoir comme le Père Siméon.
-
-
Le frère Célestin (Clat), né à
Nîmes, en 1766, et le frère Fidèle, d'Annecy, succombèrent
ensuite sous les coups des meurtriers; ce dernier, âgé de 82 ans,
sourd, aveugle et retenu dans son lit par une attaque de paralysie,
ne put échapper aux scélérats envahisseurs qui, l'ayant trouvé
couché dans sa cellule, le hachèrent à coups de sabre dans son
lit et le brûlèrent ensuite en mettant le feu à sa paillasse.
-
-
Deux jeunes clercs furent tués, l'un
à la porte du chœur, l'autre à celle de la sacristie ; deux
pauvres ouvriers furent massacrés dans le jardin.
-
-
Après ces exploits, tout dans le
couvent fut saccagé et détruit. La riche bibliothèque de 2,000
volumes, donnée aux Capucins par Antoine-Balthazard Fléchier,
archidiacre de Nîmes et neveu de l'illustre évêque de ce nom, fut
dévastée (1), la pharmacie, une des plus belles du royaume et une
de celles qui fournissaient aux pauvres les plus abondants secours,
fut entièrement détruite. Quatre calices, leurs patènes, deux
ciboires, le linge sacré, les ornements sacerdotaux furent volés
dans la sacristie, un crucifix fut mutilé dans le chœur à coups
de sabre et une statue de la Vierge servit de cible aux forcenés.
Il serait trop long de détailler toutes les profanations dont ces
lieux furent témoins ; n'oublions pas cependant ce fait qu'on n'a
jamais pu démentir : Quelques jours après la Bagarre, des
protestants dansaient à Massillargues vêtus en capucins, portant
les surplis, les étoles et les chapes du couvent, et buvant
tour-à-tour, dans les vases sacrés, à la santé de la Nation.
-
-
(1) Cette
bibliothèque, composée de nombreux ouvrages d'Ecriture Sainte, de
patrologie, de théologie, de controverse, de littérature, etc.,
avait été léguée aux Capucins, à la condition qu'elle serait
ouverte, deux jours de la semaine, aux membres du clergé séculier
et régulier.
-
-
On n'osera jamais, de bonne foi,
contester l'exactitude de ces horreurs, elles ressortent avec
évidence des procès-verbaux de la municipalité de Nîmes et des
brochures du temps, auxquelles on ne sut répondre qu'en persécutant
ceux qui avaient eu le courage de les écrire et les forçant à
s'expatrier pour éviter la mort.
-
-
En vain voudrait-on s'appuyer sur le
certificat qu'on arracha à M. Clemenceau, curé de la cathédrale,
et qu'on eut soin de faire parvenir, comme atténuation des faits, à
tous les curés de la ville et des environs. Ce certificat,
insidieusement écrit par le parti dominant qui le fit ensuite
répandre et afficher à profusion, dit trop et pas assez, et il est
facile de lire dans les interlignes la preuve la plus complète des
scènes épouvantables que nous venons de raconter.
-
-
Citons d'abord ce certificat :
-
« J'ai
été chargé la faire la visite de l'église des RR. PP. Capucins
de cette ville, et, d'en retirer les vases sacrés ci, ornements ;
je dois, pour détruire les faux bruits qui se sont répandus, vous
prier d'annoncer à vos paroissiens, que j'ai trouvé le tabernacle
exactement fermé, que les Saintes-Hosties n'ont point été
profanées et que je les ai transportées, mercredi dernier, dans le
tabernacle de mon église, dans laquelle il n'a été fait, ni
profanation, ni dommage, »
-
-
M Clemenceau dit bien qu'il a été
chargé de faire la visite de l'église des Capucins, mais il ne dit
pas dans quel état il l'a trouvée d'en retirer les vases sacrés
et ornements, mais il ne dit pas qu'il les a retirés, ce qui aurait
été difficile, tout ayant été pillé ; d'ailleurs les prisons de
Nîmes reçurent bientôt après un voleur arrêté à Sommières,
ayant un ciboire en sa possession. Le curé de la cathédrale
affirme, en terminant, qu'il n'a été fait dans son église, ni
profanation, ni dommages ; pour qui sait lire, il est clair que
cette affirmation ne signifie nullement qu'il en soit de même pour
l'église des Capucins. Ce certificat, tout négatif, ne saurait
être opposé à des faits positivement affirmés.
-
-
Les certificats obtenus des Capucins
survivants n'infirment en rien notre récit ; ils taisent les scènes
de l'après-midi et ne rapportent que la visite du matin dans
laquelle les assaillants « se
comportèrent avec décence et honnêteté.
» Les officiers municipaux, dit l'historien Baragnon, firent signer
à chacun des religieux qui reparurent dans Nîmes, un état de tous
les effets et de toutes les sommes qui avaient été pillées dans
leurs cellules : il relève à un total considérable.
-
-
Le même historien nous apprend que
la plupart des religieux qui s'étaient cachés dans le couvent
furent recueillis, dans la soirée, par le sieur Pierre Paulhan,
fenassier, qui leur donna asile dans sa mai-son pendant deux jours
et deux nuits, à la sollicitation de sa femme qui était
catholique. Roussillon, sellier, contribua puissamment à cette
bonne œuvre ; ce fut lui qui, dans la soirée du 14, s'introduisit
dans le couvent, fit sortir les religieux de leur retraite et guida
leurs pas vers Paulhan.
-
-
Les massacres duraient encore dans la
ville, lorsque deux généreux catholiques s'introduisirent dans le
couvent pour ensevelir les martyrs qu'ils déposèrent dans un
caveau de l'église située devant la chapelle de
l'Immaculée-Conception, près de la chaire. Ils les placèrent tous
les cinq sur la même pierre, les prêtres les premiers et les
frères ensuite, en ayant soin de mettre à côté du corps du frère
Fidèle le tison éteint qui avait été en partie l'instrument de
son martyre ; touchant souvenir des catacombes romaines ! Avant de
refermer le tombeau, les deux catholiques en couvrirent le sol de
branches de laurier, symbole de l'éternelle victoire dey martyrs,
et ils mirent les restes des religieux sous la protection d'une
statue de la Sainte-Vierge qu'ils fixèrent sur le mur opposé, les
mains étendues du côté des victimes, comme pour les inviter à
venir régner avec elle dans le Ciel.
-
-
Honteux de leurs violences et de
leurs crimes, les protestants cherchèrent à présenter la Bagarre
comme une affaire entièrement politique, et ils firent rappeler les
religieux échappés au massacre. Voici la réponse que le P.
Alexandre de Saint-Maximin, écrivit à cette occasion aux officiers
municipaux, elle fait parfaitement connaître la résignation et
l'innocence de ceux dont les jours avait couru de si grands dangers.
-
-
Avignon, 26 juin 1790.
-
-
« Messieurs,
j'eus l'honneur de recevoir hier au soir votre lettre venant de
Tarascon. Je ne pus avoir celui d'y répondre tout de suite la poste
étant partie. Nous venons aujourd'hui vous témoigner combien nous
sommes sensibles à l'empressement que vous avez de nous revoir à
Nismes. Nous nous y serions rendus aujourd'hui, si notre état nous
l'avait permis ; mais lundi prochain, nous » aurons un peu plus de
force pour soutenir le voyage et je compte » pouvoir partir avec le
P. Gélestin, les frères Julien, Antoine et peut-être le frère
Mathieu qui est à Carpentras. Quant aux autres nous ne savons où
ils sont. Je pense que nous pouvons venir à Nismes avec toute
confiance. Nous n'avons rien à nous reprocher, par la grâce de
Dieu. Nous avons tâché de nous rendre utiles à tout le monde ;
nous espérons que Dieu daignera nous continuer les mêmes
dispositions. Nous sommes dépourvus de tout ; mais nous osons
compter sur les bontés de nos bienfaiteurs : un peu moins de
confiance de notre part nous aurait fait prendre quelques
précautions, mais Dieu l'a voulu ainsi pour nous éprouver
davantage ; sa volonté s'accomplisse ;nous nous y soumettons. J'ai
l'honneur d'être, etc.
-
Frère Alexandre, capucin. »
-
-
Les religieux rentrèrent
successivement, mais ils trouvèrent leur couvent dans un tel état
de dévastation qu'ils se virent forcés de recourir à la charité
des fidèles et à la bienveillance de la municipalité. La lettre
suivante décrit parfaitement leur triste situation.
-
-
Nimes, ce 10 juillet 1790.
-
« Messieurs,
après nous être rendus dans cette ville pour seconder vos vues et
contribuer par notre ministère à affermir la paix, nous osons vous
manifester nos besoins et vous prier d'y pourvoir incessamment.
-
La majeure partie de nos cellules
sont fermées ; l'on travaille à la sacristie, mais on n'a pas
encore mis la main à la porte du couvent. Plusieurs serrures
manquent dans l'intérieur ; aucun de nos meubles n'est réparé.
Les livres qui nous restent sont sous le scellé et nous sommes
autant dévorés par l'ennui que par le souvenir de nos malheurs.
-
Nous avons mille actions de grâces
à rendre aux citoyens qui nous ont reçus chez eux, et nous devons
dire que toute la ville s'est empressée d'adoucir notre sort. Mais
cette vie, que nous menons dans ce monde, n'est pas celle qui nous
convient ; elle nous éloigne trop de l'église que nous devons
desservir.
-
Nous n'avons trouvé dans le
couvent que quelques paillasses, quelques couvertures et quelques
mauvais habits. Tout le reste a été enlevé.
-
La sacristie manque aussi de tout.
Les ornements qui y ont été trouvés par M. Clemenceau, quand il
est venu prendre la réserve, sont tous hors de service ou ont
besoin de réparations.
-
La cuisine, le réfectoire sont
à-peu-près dans le même état que le reste de la maison.
-
Nous vous prions d'ordonner que
toutes ces réparations s'achèvent le plutôt possible, de nous
accorder en commun la somme que vous jugerez convenable pour nous
établir en communauté, et à chaque particulier une petite avance
pour nos besoins les plus urgents, en attendant que nous ayons pu
vous donner l'état exact de tout ce qui nous manque, ce que nous ne
pourrons que lorsque la bibliothèque sera ouverte et que quand les
deux religieux qui sont encore absents seront arrivés.
-
Nous ne pouvons pas compter, pour
tous les besoins, ni sur la sacristie, ni sur la quête ; nous avons
pour quelques mois de messes à dire, dont l'honoraire nous a été
enlevé ; la quête n'a produit que 122 livres et quelques sous, et
nous devons à divers boulangers 327 livres 19 sous, à la
poissonnerie ou à la boucherie environ 19 livres, et quelques
autres petites sommes à divers ouvriers de la maison, qui devaient
porter leur compte à la foire de Beaucaire.
-
Vous êtes les pères de la
patrie, nous sommes dans une entière nécessité. Voilà les titres
que nous avons pour solliciter votre bienfaisance et compter sur vos
bontés.
-
Nous sommes avec un profond
respect, etc. »
-
-
Le couvent commençait à peine à
reprendre son ancien état, lorsque, sous prétexte d'affranchir les
victimes des cloîtres, un décret de l'Assemblée nationale
supprima les ordres religieux et les vœux monastiques. Interrogés
officiellement sur la décision qu'il leur convenait de prendre,
dix-sept capucins, sur dix-neuf qui composaient encore la maison de
Nîmes, répondirent qu'ils voulaient rester dans leur monastère et
y continuer la vie commune ; les deux autres, pour lors absents, ne
purent, comme leurs confrères, affirmer la liberté qui avait
accompagné leur vocation. Cette réponse valut aux religieux un
moment de répit ; mais dès le mois de mars 1791, ils durent se
disperser de nouveau et cette fois sans espoir de retour. Leur
église était destinée à servir de paroisse constitutionnelle.
-
-
-oOo-
|
- La Révolution à Nîmes, suite d'articles
- > La Révolution à Nîmes les massacres de juin 1790, la religion, le tribunal Rélutionnaire, la guillotine et la Terreur..
- > Contact webmaster
|
|
