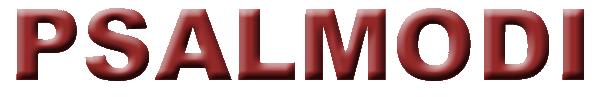|
par
Georges Rivals, 1937 CHAPITRE
TROISIEME Le
crépuscule de Psalmodi LA
COMMENDE. de 1482
à 1537 La Commende (du
latin commendare, confier), était l'usufruit d'un bénéfice
ecclésiastique, accordé par le Pape à un personnage qui n'en exerçait pas les
fonctions. Cet abus remonte au moins au XIVe siècle, puisque nous voyons
Clément VI (Bertrand de Got, 1305-1314), tenter de lutter contre lui.
Il ne s'établit à Psalmodi qu'en 1482 ; nous l'avons vu. Encore Guy Lauret,
Jacques et Martin de Beaune, L. de Canosse, Régnauld de Martigny sont-ils des
évêques régulièrement consacrés, mais il n'en va pas de même pour les de
Fayoles et les de Calvière. L'abbé, protecteur naturel du Couvent, en devient
l'exacteur. Dès 1498, il faut du papier d'homme de loi entre les religieux et
leur chef, les moines reconnaissent à l'abbé, divers usages « sous
l'albergue de 16 livres tournois » En 1532, ils protesteront contre cet
acte et le Parlement de Toulouse devra statuer encore, en 1647, la «
jouissance commune de la Pinède. » Fait plus
curieux : le titre d'Abbé de Psalmodi survivra à la sécularisation, jusqu'en
1690. Et 153 ans plus tard, il conférera à celui qui le porte des droits
fiscaux, origine de nombreux procès au sein du chapitre d'Aigues-Mortes. Les
derniers abbés sont Jacques de Beaune, évêque de Vannes, qui succède en 1507
à Guy Laurel. Martin de Beaune, son parent, fait casser l'élection, en 1510,
du moine de Psalmodi Girard Pilet (dit de la Verne), qui a eu l'audace
de vouloir faire revivre l'autonomie abbatiale. Gérôme de Canosse, en 1523,
succède à Martin de Beaune et passe les revenus à Louis de Canosse, évêque de
Bayeux (1529-1531). On le voit; c'est la transmission de famille à famille.
L'évêque de Vabres Régnauld de Martigny, en 1536, transmet à Jean de
Luxembourg, ce qu'il a acheté à la famille de Beaune. en 1532. C'est l'heure
de la sécularisation qui sonne. Que se
passa-t-il au juste ? Il n'est que trop aisé de l’imaginer et les
documents sont là. Le grand prieur claustral, soustrait à tout contrôle
disciplinaire, imite les Abbés dans leur souci exclusif des biens terrestres.
D'autre part, le vent d'Allemagne apporte sur les bords du Rhône, du Vistre
et du Vidourle, l'hérésie luthérienne. Or, ce sont les réguliers qui, à
partir de 1540, comme en 1792, fournissent les plus nombreux et les premiers
évadés de l’Eglise. De plus, nous
avons fait allusion plus haut, aux agissements peu délicats des Calvisson. La
garnison, que le baron a établie vers 1480 dans le fort Sainte Julien,
comprend des soudards adonnés au jeu et à la boisson, qui attirent les filles
de mauvaise vie. (1) En 1483, un arrêt du Parlement de Toulouse est rendu
contre Calvisson, « cet homme terrible et sans conscience. » Tout d'abord,
les moines sont violemment révoltés contre de tels attentats, puis trois
années s'écoulent et l'accoutumance commence son œuvre. (1)
Archives du Gard, A, 111. ...Après Satan,
Guillaume Louet de Nogaret de Calvisson est le principal responsable de la
décadence morale de Psalmodi. Le ver rongeur est entré dans le fruit et
rapidement la décomposition intérieure va s'opérer. Bientôt, deux
catégories de moines ne veulent plus de l'antique règle bénédictine : les
libertins et les hérétiques. Les premiers restent attachés à l'Eglise, mais
pensent, peut-être, trouver au sein du clergé mondain, une existence plus
large et plus libre. Les seconds, instruits des « prédications hardies »,
dénoncées par les échevins de Nîmes, le 7 Avril 1532, doutent non seulement
de Saint Benoît, mais du catholicisme lui-même. Les documents portent à
croire que ces derniers furent très peu nombreux. Il fallait
trouver un prétexte; on en découvrit deux fort ingénieux au cours d'un
chapitre général tenu le lundi de Quasimodo, 12 Avril 1537, par les 26
religieux présents. Le Placet de Sécularisation de François Ier y fait
allusion : « Considérée la situation de ladite Abbaye qui est, ainsy que nous
sommes bien advisés, en lieu malsain et à propos pour habiter en danger des
invasions et incursions des coursaires. » Certes, les
fils de Benoît d'Aniane avaient supporté du tant des siècles, les piqûres des
moustiques languedociens. Pénitence bien légère, somme toute, pour un ascète.
Mais le souvenir des farouches Sarrazins était bien loin pour pouvoir être
remis en cause, et parler des « incursions des coursaires » tournait à
la bonne galéjade depuis les temps immémoriaux ou Psalmodi était distant du
littoral de plus de quinze kilomètres. Seulement, les secrétaires royaux
feignaient d'ignorer la topographie du golfe du Lion. LA SÉCULARISATION. (de 1537 à 1789) Le placet de
François 1er est daté du 16 mai 1537 et la bulle du pape Paul III qui le
confirme du 15 décembre de la même année. Le 27 mars 1536, Psalmodi avait été
précédé par Maguelonne devenu évêché de Montpellier. Les frais
furent très élevés, car les moines durent emprunter au sieur Franc Conseil
3.000 écus d'or et au sieur Jean Fortia, 4.593 livres pour payer les droits
de procédure. La chose n'alla pas d'ailleurs sans difficulté; les Etats de
Languedoc firent des remontrances au Roi sur cette sécularisation, ainsi que
sur plusieurs autres et, encore dix ans plus tard, le 17 octobre 1547, une
assemblée, tenue à Carcassonne, déclarait qu'il « seroit acquiescé à la
volonté du Roy, sauf aux particuliers si bon leur semble de poursuivre ».
(1) Ce n'était pas des motifs religieux qui animaient les protestataires,
mais la perte de bénéfices et de privilèges fonciers, fondés sur de vieilles
servitudes dont comptaient bien tirer parti les petits seigneurs voisins de
l'abbaye. Ces bénéfices passaient tous au chapitre collégial d'Aigues-Mortes,
résidant à Notre Dame du Sablon. Ledit chapitre comprenait un abbé doyen
assisté de quatre dignitaires (le prévôt, l'archidiacre, le chantre et le
sous chantre), entouré de quinze chanoines majeurs (dans les ordres majeurs)
et de douze chanoines mineurs (clercs). (2) Le doyen pouvait entretenir six
prêtres desservants et avoir une schola cantorum de 9 chantres, de quatre
enfants de chœur et d'un maître de chapelle. On voit que la vieille
réputation musicale de Psalmodi se maintenait. (1) Cf. Hist. Générale de Languedoc, éd. Privât, IV, pp. 506-510. (2) Primitivement les Canonicats majeurs et mineurs étaient de 22 ; c'est pas extinction qu'ils tombèrent à 17 et à 15. Les revenus
étaient assez coquets, l’abbé doyen touchait de 18 à 20.000 livres de
rente (près de 80.000 frs de 1914); chaque chanoine, 8 à 900 livres (près de
2.000 frs de 1914). D'autre part,
le doyen était le décimateur d'Aigues-Mortes et possédait la feuille des
impôts. Situation qui se maintiendra après le transfert à Alais (1094). Voici que le
Protestantisme déferle à Aigues-Mortes; une partie du chapitre apostasie et
l'autre prend la fuite (comme, en témoignera une supplique à M. de Bernage,
Intendant du Languedoc, en 1728). Sous le décanat
de Barnabé de Fayoles (1550), habitant Paris et régisseur pour le compte du
Connétable de Montmorency, huit chanoines passent au parti huguenot, en 1563.
François et Jean de la même famille de Fayoles se lèguent les revenus, mais
en 1606, nous les voyons aux mains de Marc de Calvière, baron de Coufoulens
et d'Hauterive, président au Parlement de Toulouse. En 1656,
Antoine de Calvière, agissant en son nom et en celui de son fils
Claude-Louis, troque sa pension avec l’évêque d'Alais et reçoit, en
échange, les revenus de l'Abbaye de Lire (Maine-et-Loire). C'est en
effet, François Chevalier de Saulx, évêque d'Alais qui met fin à la vie
posthume de notre Abbaye, en 1694. Le 16e jour des
calendes de juin de cette même année-là, Innocent XII fulmine une bulle (1),
par laquelle Alais est érigé en évêché du consentement mutuel des chapitres
de Nîmes et de Psalmodi, et il est stipulé que tous les revenus de l'ancien
monastère passeront au nouveau chapitre cathédral. Le domaine de Psalmodi
lui-même, les ruines de Saint-Pierre et de Sainte-Marie, au nom si mystiquement
poétique, a été débaptisé. Ce n'est plus Psalmodi, c'est en patois du pays
San-Mozy (francisé en Saint Mauzy); saint nouveau assurément, que nous
chercherions en vain dans le martyrologe chrétien. (1)
Archives du Gard, G. 129. La terre même a
été affermée, en 1693, au sieur Jean Fontaine pour 600 setters de bled
thouzelle et 30 salmées d'avoine. De leur côté, les chanoines renonceront en
faveur dudit fermier, aux deux salmées de bled qu'on a accoustumé de donner
pour le passage de la Tour Carbonnière et aux poules qu'on leur apportait
pour la Noël. (1) En 1716, le domaine sera affermé à mi-fruits au
saint-Laurentais, Jean Maystre ; en 1726, à Jean Mourgues, pour 2.600 livres
de « rente sûre » ; et avec la cherté croissante des terrains, de 1730
à 1777 (en 47 ans), le fermage passera de 2.800 livres à 6.450 livres
; il aura plus que doublé. (1)
Archives du Gard, G. 764. L'évêque
d'Alais est bien loin et les chanoines d'Aigues-Mortes paraissent être dans
un état de torpeur; les habitants de Saint Laurent d’Aigouze se livrent
à des déprédations au bord du Vistre (1701). Et c'est quand un abbé-doyen
songe à faire de ces ruines un moulin-à-vent, (le monticule étant
excellemment exposé au mistral), que le camisard Abdias Morel, dit «
Catinat », à la tête de sa troupe cévenole, dans la nuit du 26 avril
1704, appelé peut-être par le fermier d’alors, qui était un protestant
du nom de Fontanès, met le feu aux vestiges du passé, (1) (1).
« Plusieurs catholiques fuyant (la bande des Camisards) s'étaient réfugiés dans
la nef; ils furent maltraités et quelques-uns tués. Le fermier de Psalmodi
était alors un protestant nommé Fontanès; ses meubles et ses effets furent
mis à l'écart; puis on entassa dans les bâtiments tout le bois qu'on put se
procurer et deux jeunes filles qui retournaient à Aigues-Mortes furent
forcées d'y mettre le feu. » (Abbé Goiffon, l'Abbaye de Psalmodi, Nimes, 1895
pp. 59-60). L'émotion
passée, les bénéficiaires retombent dans leur somnolence. Déjà, en 1696, les
habitants d'Aigues-Mortes se plaignaient de n'avoir personne pour leur
prêcher le Carême ; ils avaient dû s'adresser à l'illustre Fléchier et
l'évêque avait désigné d'office, le 17 février, le Père Bernard Vigne,
mettant à la charge du chapitre les honoraires du prédicateur, s'élevant à 200
livres tournois. Le 14 octobre 1707; c'est au tour des paroissiens de Saint
Sauveur de Marsillargues, de faire appel au Roi lui-même et le parlement de
Toulouse condamne le chapitre à payer les portions congrues des curés et
vicaires de Marsillargues. Vers 1737 nouvelles instances pour des ornements.
Tout cela fera dire, en 1746, à propos des chanoines, par Gautier de
Terreneuve, qu’ « ils ont un peu oublié leur mère nourrice. » Le lecteur
veut-il à présent monter jusqu'à Alais, pour comparer les chanoines
d'aujourd'hui aux bénédictins d'autrefois ? Ils sont dix-neuf prébendiers, y
compris l’évêque. Les uns sont bénéficiaires de la mense épiscopale
d'Alais, les autres, de la mense collégiale d'Aigues-Mortes, mais comme les
revenus ne s'équivalent pas. les dissensions sont fréquentes. C’est
que, réunis pour le spirituel en 1694, les deux chapitres ne l'avaient pas
été pour le temporel et les dotations continuaient à être régies séparément.
(1) Et c'est l'histoire de l’huître et des plaideurs : Jean Louis de
Buisson-Beauteville, évêque d'Alais et abbé de Saint-Gilles et de Psalmodi,
supprime cinq canonicats de Saint Jean d'Alais et se les adjuge et...
l'égalité des bénéfices est rétablie. (1)
Archives du Gard, G. 776. Nous pouvons,
grâce au règlement de 1720 (1), voir vivre nos bons chanoines; on leur défend
de « porter perruques avec mondanité, de causer au chœur, de s'offrir du
tabac à priser et de se faire des signes; un bon chanoine, fut-il noble, n'a
pas le droit de porter l’épée ni de revêtir des costumes de chasse, ni
de se livrer aux jeux de hasard... » Péchés mignons que tout cela et
excellent rappel à l'ordre où l'on sent l'esprit bienfaisant et grandissant
des Sulpiciens et de M. Olier. (1)
Archives du Gard, H. 753. S'il est
juridiquement possible, avec de hautes protections, de garder des titres de
propriétés, il l’est moins de faire fructifier des domaines qu'on ne
visite plus; néanmoins, un effort est tenté le 17 mars 1723, par
l’évêque Ch. de Banne d'Avéjan, aumônier de la duchesse de Berri. Il
s'associe avec d'autres propriétaires, pour une entreprise des Salins de
Peccais. Mais l'échec est total et quelques années plus tard, le prélat
demande au roi la permission de vendre ces Salins « qui ne sont plus pour lui
qu'une source de pertes depuis que personne ne les surveille plus. » (1) (1)
Archives du Gard, H. 182. Enfin, le
dernier document que nous possédions sur Psalmodi est lamentable. C'est la
déconfiture; on vend tout. Une lettre patente de Louis XVI (1786), autorise
le chapitre d’Alais, à vendre les seigneuries directes, censives,
etc... d'Aubais, Aigues-Vives, Aimargues, Codognan, Lunel, Marsillargues,
Mudaisons, Saint-Clément, Aigues-Mortes, Aspères, etc. pour rembourser les
dettes de l'église cathédrale. (1) (1)
Archives du Gard, G. 874. Voici quelle était au début du 18e siècle la mense
conventuelle dite de Psalmodi: d'abord les trois prieurés de Notre-Dame du
Sablon, Ste-Cécile de Loupian et Saint-Sylvestre de Teillan; aux offices
claustraux étaient annexés sept prieurés : St-Julien de Cornillac, Ste-Marie
d'Aubais, St-Pierre d'Aigues-Vives, St-Jean de Nozet, Malespels, Mont-Redon,
Nissan, Saussine, Cécelès, Vaugine, Vaux, Camberlaye. Château Dauphin,
Saint-Clément de la Forêt, St-Etienne du Désert, Dassargues, Aspères,
Valergues, St-Bonnet, Cucuron, Candiac, du Grez, Cosme de CandiIIargues,
St-Asisele de Mudaisons, St-Michel de Varanègue; venaient ensuite les
prieurés de St-Pierre du Fort, Marsillargues, Ste-Marie de Laval et Pierre
Verte. Ainsi, le
fantôme de l'antique Abbaye n'a pas eu assez de forces pour attendre le coup
de grâce de la Révolution. Le sieur Laurent de Joubert, baron de Sommières,
bénéficie un moment de cette débâcle; les Etats de la province font un
suprême effort en 1788, en allouant au Chapitre, une rente de mille francs... Or, les
chanoines de Louis François de Bausset ne vont pas en jouir longtemps; 1789
est là, et le 24 janvier 1791, Psalmodi, le domaine, le maisonnage, les
terres cultes, les pâturages et toutes dépendances sont vendus pour la somme
de 241.000 frs à Denis Rame, Abraham Combe fils et à Jean-Louis Trouchaud. Conclusion Cette esquisse
historique n'aura pas été sans utilité si, par elle, on a pu se faire une
idée de la grandeur morale, de la poésie et de la puissance d'une grande
abbaye méridionale qui a rendu, à ses heures, d'incontestables services à la
cause de la civilisation. Laissons de côté les moments de dissolution et d’agonie. Restons à la vision de Psalmodi dans son apogée; dans le crépuscule d'un beau jour, faisons une longue station à ce qui reste de « l’île de Psalmodi » : si nous savons nous recueillir dans la magie d'un ciel d'émeraude, nous verrons se profiler l'enceinte, la lourde Porte de Fer crénelée et redoutable, la grosse tour carrée de Teillan, emplie des éclats de voix de la manécanterie du père Précenteur, puis dominant l'ensemble, telle une forteresse de Dieu, la vieille église de Saint-Pierre. Et peut-être, serons-nous amenés à regretter, en un siècle d'industrialisme forcené et d'âpreté au gain, ces âges idéalistes où tout homme, quelle que fut l'humilité de sa naissance, pouvait sous le scapulaire de Saint-Benoît, sonder les éternels mystères de la pensée, chanter avec ferveur et art, traiter d'égal à égal avec le puissant du jour. Appendice Placer de François Ier au pape pour obtenir la
sécularisation de Psalmodi 1537 Représenté
de la part des religieux, abbé et couvent de l’abbaye de Saint-Maudi du
Diocèse de Nismes et considéra la situation de la ditte abbaye qui est ainsi
que Nous sommes bien advisés en lieu malsain et à propos pour habiter en
dangier des invasions et incursions des coursaires et pirates de mer. Nous
avons consenti et accordé, soubs le bon playsir de Vostre Saincteté, auxdicts
religieux, qu'ils puissent transférer leur église et demeure du lieu où elle
est du présent en nostre ville d'Aigues-Mortes et par une mesme voye à eux
commués de leur régularité en estat des chanoines séculiers ayantz pour
principale dignité de leur églize, un doyen sur eux, moyennant aussi que Nous
conférerons et pourvoirons, comme ils nous ont fait offrir, à la moitié des
chanoinies et prébendes de la dicte églize; toutes lesquelles demeureront
alternatives pour y estre par Nous et par le chaspitre dycelle églize saint
Maudi pouren en l’ung après l'autre ainsi qu'elles viendront à vaquer
par mort, résignation ou aultrement. A
cette, très Sainct Père. Nous supplions et requérons Vostre Saincteté tant et
si affectueusement qu'il Nous est possible que Son bon playsir soit pour
l'amour de nous avoir agréable la requeste d'yceux religieux, abbé et
couvent, icelle admettre et Nous y gratifier en ce faisant octroyer et
concéder et faire expédier sur les dessusdicts translation et commutation et
alternative collation desdittes chanonies et prébendes ainsi que dict et
toutes et chascunes les bulles, dispenses et provisions apostoliques requises
et nécessaires suivant les mémoyres et supplications qui en seront présentés
à Ycelle Vostre ditte Saincteté, laquelle, en ce faisant, nous fera très
singulier playsir priant à tout le Créateur, très sainct Père, qu'il la
veuille longuement maintenir, persévérer et garder au bon régime et
gouvernement de Nostre Mère Saincte Églize. Escrit
à Laffare sur Oyze le sexième jour de may, mil cinq cents trente sept. Vostre
dévot fils le Roy de France, Signé : François Bourbon (Archives du Gard, H. 107). > Chapitre Premier : L’Aurore de
Psalmodi (du Ve Siècle à 1004) D’où
vient le nom de psalmodi Le
faux diplôme de 791 > Chapitre Second : L’Apogée de
Psalmodi (de 1004 à 1472) Le
territoire de Psalmodie > Chapitre Second :(suite) La
vie Monastique Les
Abbés et l’indépendance de Psalmodi Liste
des Abbés de Psalmodi de 791 à 1482 > Chapitre Troisième : Le crépuscule de Psalmodi La
Commende (de 1482 à 1537) La
sécularisation (de 1537 à 1782) Conclusion. |