| GRANDE ET PETITE HISTOIRE DE SAINT-GILLES (Gard)
PRÉSENTATION
Cette publication
est le début d'une série sur l'histoire des 27 communes de l’agglomération de
Nîmes Métropole : Bernis, Bezouce, Bouillargues, Cabrières, Caissargues,
La Calmette, Caveirac, Clarensac, Dions, Garons, Générac, Langlade, Lédenon,
Manduel, Marguerittes, Milhaud, Nîmes, Poulx, Redessan, Rodilhan,
Sainte-Anastasie, Saint-Chaptes, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionizy,
Saint-Gervazy, Saint-Gilles, Sernhac. A ce jour
Saint-Gilles est la troisième commune qui voit son histoire publiée dans
nemausensis.com. Ce document
est établi dans l’esprit du site nemausensis. Présentation des sujets en
conservant au maximum les textes sources. Ces dernières sont toujours
identifiées. Les textes
et illustrations sont fournis par les archives du site, alimentées par Gérard
Taillefer, Philippe Ritter et Georges Mathon. Dans les
divers textes énumérés ci-dessous vous pourrez découvrir plusieurs versions sur
l'origine controversée de l'ancienne citée, nous ne manquerons pas aussi
d'aborder l'histoire des deux personnages dont l'ombre plane sur la ville : Ægidius
et Gui Fulcodi, plus connus sous les noms, Saint-Gilles et Clément IV. Cette
ville qui a vu naître le futur Pape Clément IV a aussi vécu un drame qui
contribuera à la chute des puissants Comte de Toulouse.
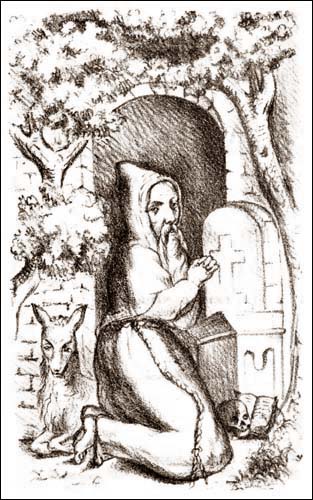
Ægidius (St-Gilles) | 
Gui Fulcodi - Clément IV |
- En premier, nous
fournissons un extrait du « Dictionnaire
Topographique du Département du Gard » réalisé par Germer-Durand en
1868. - Ensuite c’est un extrait
du « Dictionnaire Historique du Département
du Gard » d’Hector Rivoire de 1845. L’article est illustré avec une
carte du XVIIIe siècle, la carte de Cassini. - Le cahier des Doléances de Saint-Gilles rédigé lors des états
généraux de 1789 est publié dans son intégralité, grâce au travail de synthèse
réalisé par E. Bligny Bondurand en 1908. Le département du Gard ne sera
formé que l’année suivante, en 1790. - Un récit historique plus
récent d'Augustin Fliche datant de 1925, nous donne quelques précisions sur la
légende de Saint-Gilles qui vécut au VIIe siècle, il précise qu'aucune source
digne et référencée n'a pu à ce jour attester la véracité de tous les exploits
qui lui sont attribués. Cet historien nous explique avec concision les rapports
conflictuels entre les différents Comtes de Toulouse, l'abbaye et les papes de
l'époque. - Les Annuaires du Gard du
début du XXe siècle nous ont fourni des renseignements très intéressants, nous
avons retenu les listes professionnelles et administratives, données dans ceux
de 1923 et 1955. Le tout a été enrichi par les données des dénombrements de la
période comprise entre 1793 et 2010 et la liste des maires de la commune qui
couvre la période de 1790 à nos jours. - Des renseignements sont
donnés sur la création de la ligne de Chemin de Fer allant de Arles à Lunel.
L'autre ligne de chemin de fer celui de la Camargue n'est pas oubliée. Des
photos anciennes des gares illustrent ce sujet. - Un extrait de la
biographie de Paulin Talabot publié par le baron Ernouf en 1886, nous donne un
historique du canal de Beaucaire à Aigues-Mortes et nous décrit les
améliorations que cet ingénieur y a apporté. - Le monument au mort érigé
en 1921 pour honorer les enfants de la ville de St Gilles morts pour la patrie
lors de la guerre de 14-18 fera l'objet d'une petite étude. Ceux des conflits
suivants : 1939-1945, Indochine, Afrique du Nord y seront rajoutés.
- Un extrait d'un incroyable travail de recherches réalisé par Jacques Fermaut sur l'origine du texte de la légende de St-Gilles
-
Trop
volumineux, divers sujets sont proposés en pièces annexes : Deux
version sur la
vie de St-Gilles, une datant de 1862 du prêtre Teissonnier et l'autre
de 1911,
de Jules Charles-Roux ; en complément sur ce saint l'histoire de St
Vérédème, et sa rencontre avec St Gilles dans son ermitage au bord du
gardon à la baume de Sanilhac ; un texte publié à l'Académie de
Nîmes en 1865/66 nous
décrit la découverte par Henri Révoil du tombeau du saint ; deux études
sur Guy
Fulcodi, le pape Clément IV, sont
aussi proposées en pièces annexes, l'une de Mazer, publiée à l'Académie de Nîmes
en 1908 et l'autre de Charles-Roux en 1911 ; les Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem à Saint-Gilles feront l'objet d'une petite publication réalisée par
Charles-Roux ; Philippe Ritter présente une imposante étude sur le
Grant-Prieuré de Saint-Gilles, résultat de plusieurs années de recherches et de nombreuses
conférences et publications ; ensuite une l'étude détaillée sur
l'abbatiale de Saint-Gilles avec sa crypte réalisée par Charles-Roux ; et pour
terminer, retour au début XXe siècle avec de nombreuses cartes postales d'époque
sur la ville : "Saint-Gilles en Sépia".
Bonne lecture
|
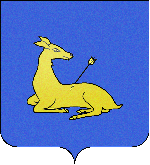
|
SAINT-GILLES
Extrait du
Dictionnaire Topographique du Gard,
par Germer-Durand, 1868, page 208.
|
NDLR : Les
renseignements donnés dans ce texte indiquent : la situation administrative et
l'orthographe de l'année 1868. Ils ne sont pas forcément identiques à ceux de
notre époque.
SAINT-GILLES, arrondissement
de Nîmes.
- Nom, Date, (Sources)
- Monasterium Sancti-Petri, in
Vall-Flaviana, 813, (Ménard I, preuves page 3 colonne 1)
- Sanctus-Petrus, in Valle-Flaviana, 817, (Dom Martin Bouquet, Historien de France)
- In Valle-Flavania, in comitatu
Nemausense, ad fines Septimaniœ, 878,
(bullaire de Saint-Gilles)
- Monasterium Sancti-Petri, in quo
quiescit corpus B. Ægidii, in Valle-Flaviana, in pago Nemausense, in finibus
Gothiœ, 879, (Ménard I, preuves page 11 colonne 2)
- Sanctus- Ægidius, 1024, (cartulaire de Notre-Dame de Nîmes, chapitre 32)
- Ægidiensis (moneta), 1095, (Histoire de Languedoc II, preuves colonne 336)
- Villa Sancti-Ægidii, 1256, (Ménard I, preuves page 81 colonne 2)
- Sanctus-. Ægidius, 1384, (dénombrement de la sénéchaussée)
- Sainct-Gille, 1435, (répartition du subside
de Charles VII)
- Le fort de Saint-Gilles, 1533, (archives départementales C. 902)
- Sainct-Gelly, 1650, (G. Guiran, style de la
cour royale ordinaire de Nîmes)
- Héraclée (*), 1793, (archives
départementales L 393)
(*) NDLR : Nom
révolutionnaire donné à Saint-Gilles de
1793 à 1801.
Saint-Gilles faisait
partie de la viguerie et du diocèse de Nîmes.
- En 1384, on y comptait 40 feux, en
y comprenant ceux d'Estagel, son annexe. Le recensement de 1744 lui donne 600
feux et 3500 habitants ; celui de 1789, 1181 feux.
(NDLR : En 1793, St Gilles
comprend 5000 habitants.)
- Saint-Gilles, bâti près de
l'emplacement d'une ville antique (que
plusieurs ont cru être Hétraclée), doit son origine et son accroissement à
la dévotion des chrétiens pour le tombeau de Saint Gilles, qui y fut inhumé en
721.
- En 1231, saint Gilles comprenait
sept paroisses.
- La premier grand prieuré de
Saint-Jean-de-Jérusalem fondé en Europe le fut à Saint-Gilles, par Raymond IV,
au commencement du XIIe siècle.
- Quatre conciles ont été tenus à
Saint-Gilles.
- L'abbaye de Saint-Gilles,
sécularisée par une bulle du pape Paul III en 1538, était à la nomination du
roi ; elle valait 18000 livres.
- En 1790, lors de la première
organisation du département, Saint-Gilles devint le chef-lieu d'un canton du
district de Nîmes. Ce canton ne se composait que de la ville de Saint-Gilles et
de ce qu'on appelait son taillable, c'est à dire les villages ou hameaux de
Sieure, d'Espeiran, de Saint-André-de-Camarignan et de Sainte-Colombe.
Blasonnement :
Saint-Gilles porte : "d'azur à une
biche percée d'une flèche", avec cette devise :
IN.
VIRTVTE. DECOR - IN. LABORE. QVIES.
|
Extrait du Dictionnaire Historique des
Communes du Gard, St-Gilles
par Hector Rivoire, 1842 tome II, pages 589 à 599.
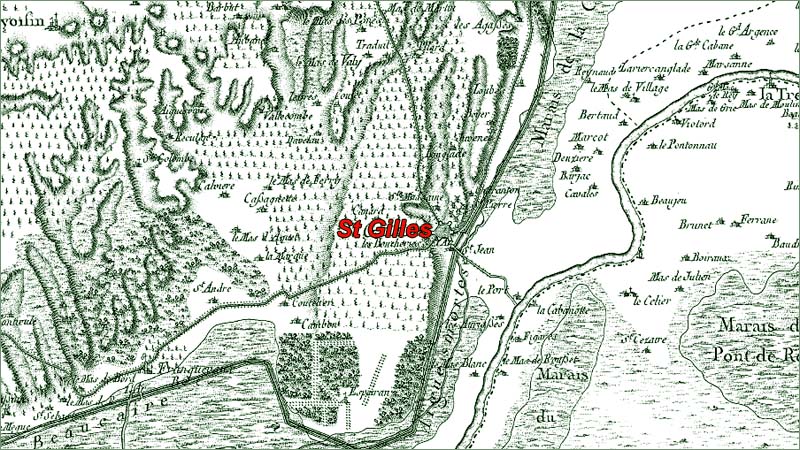 Carte de Cassini XVIIIe siècle Carte de Cassini XVIIIe siècle
Saint-Gilles -
Arrondissement de Nîmes - Chef-lieu du canton - Population 5635.
Longitude 2° 5'. Latitude 43° 40'.
Les auteurs de l'Histoire Générale de
Languedoc (1) combattent l'opinion
de ceux (2) qui ont prétendu que la
ville appelée dans le moyen-âge Sanctus Egidius, St-Gilles, avait été
construite sur les ruines d'Héraclée, colonie grecque, située à l'embouchure du
Rhône, et qui fut détruite ainsi que la colonie de Rhodes, avant le temps de
Pline. L'opinion des auteurs qui se sont ainsi prononcés sur l'origine de St-Gilles,
s'est appuyée sur une inscription qu'on prétend avoir trouvée dans ce lieu.
Cette inscription (3), faite par les
Anatiliens (4), peuple habitant la
rive gauche du Rhône, et dont il est fait mention par Pline, comme ayant voulu,
par ce monument, témoigner leur reconnaissance à Ataulphe, roi des Visigoths,
et à Placidie, son épouse, de ce qu'ils avaient choisi leur résidence à
Héraclée.
(1) Histoire Générale de
Languedoc, tome 1er, pages 4, 60, 168, 259, 644, 645, 646.
(2) Poldo d'Albenas, Bouche,
Spon, le père Ménestrier, Dom Bouquet, l'abbé leboeuf et autres, ont cru que
St-Gilles était réellement l'Héraclée des anciens.
(3) L'inscription dont il
s'agit est conçue en ces termes :
ATAULPHO FLAVIO,
POTENTISSIMO REGI REGUM
RECTISSIMO VICTORI VICTORUM IVICTISSIMO, VANDALICÆ BARBARIEI DEPULSORI, ET
CÆSAREÆ PLACIDIÆ ANIMÆ SUÆ : DOMINIS SUIS CLEMENTISSIMIS ANATILII, NARBONENSES,
ARECOMICI OPTIMIS PRINCIPIBUS IN PALATIO POSUERUNT OB ELECTRAM HERACLEAM IN
REGIÆ
MAJESTATIS SEDEM.
(4) Notices sur l'ancienne Gaule, par M. d'Anville
- Héracléa, Anatilii.
Dans cette inscription, Ataulphe est
appelé Flavius, et, comme les environs de St-Gilles ont porté le nom de vallis flaviana, on en a conclu que
l'inscription, le séjour du roi Ataulphe, et la dénomination de la vallée flavienne aux environs
d'Héraclée, datent de la même époque, et que c'est, dans le lieu où est bâti
St-Gilles qu'existait autrefois Héraclée. - M. de Bâville, dans ses mémoires
sur le Languedoc rapporte que le lieu où est situé St-Gilles était appelé,
pendant l'occupation des peuples du nord, le palais des Goths en Septimanie. -
L'importance de cette ville était telle que, sous quelques comtes de Toulouse,
le Languedoc fut appelé province de St-Gilles. La vénération que les comtes de
Toulouse avaient pour ce saint, détermina quelques-uns d'entre eux à en porter
le nom.
Dom Vaissette et Dom Vic (Histoire Générale de Languedoc), disent,
contradictoirement à cette opinion : que le style de l'inscription ne peut se
rapporter aux temps reculés (414)
auxquels on prétend qu'elle a été écrite ; qu'Ataulphe n'a pas été le premier
roi qui ait porté le nom de Flavius, mais que ce fut Reccarède, roi des
Visigoths, qui employa le premier ce prénom à la tête de ses lois ; que les
Anatiliens habitaient l'autre côté du Rhône, dans la Provence, tandis que
St-Gilles se trouve sur la rive droite du fleuve, et que les auteurs qui ont
avancé cette opinion ne s'accordent pas entre eux sur l'authenticité de
l'inscription, puisque Bouche, dans son Histoire
de Provence, dit que ce monument fut trouvé au terroir de la ville de
St-Gilles, près du Rhône, sous le règne de Charles V, roi de France ; Spon dit
au contraire, que le marbre sur lequel l'inscription est gravée fut déterré à
St-Gilles, et il en conclut, ainsi que Poldo d'Albenasd, que la ville de
St-Gilles est l'ancienne Héraclée ; le père Hardouin assure, de son côté, que
l'inscription fut trouvée à St-Remy, petite ville de Provence, et ajoute que
cette dernière ville est la véritable Héraclée de Pline.
Cette diversité de sentiments jette
de l'obscurité sur l'origine de St-Gilles. Ce n'est qu'à l'époque de l'arrivée
dans ce pays, de Sanctus Egidius, patron de St-Gilles, qu'on aperçoit un peu de
clarté, et même l'on ne s'accorde pas sur la date précise de son arrivée dans
les Gaules. Dom Mabillon, dom Vaissette et le critique Baillet, la fixent au
commencement du VIe siècle ; mais des recherches scientifiques appuyées par la
bulle de Benoit II, trouvée par Ménard, ne dont arriver saint Gilles dans le
midi des Gaules qu'environ 150 ans après. Nous adopterons cette dernière
assertion comme la plus probable, puisqu'elle est corroborée par les preuves
consignées dans les manuscrits du monastère, et par les dénombrements et
déclarations faits au roi de France par les abbés et seigneurs de St-Gilles.
Le patron de St-Gilles vint donc de
la Grèce dans la Septimanie, vers la fin du VIIe siècle. Il passa quelques
années dans une retraite située sur la frontière des diocèses de Nîmes et
d'Arles, à la droite du Rhône, vers l'embouchure de ce fleuve. Ce lieu appelé
la Vallée flavienne, lui fut donné en
673, par Wamba, roi des Visigoths.
C'est alors que saint Gilles fonda un monastère sous la règle de saint Benoît,
et sous l'invocation de saint Pierre. Ce monument religieux fut appelé Monastérium Sancti-Petri de viâ sacrâ.
Il passa sous la domination et la propriété du pape Benoît II, en 685, après un voyage de saint Gilles à
Rome. Une bulle de la même année, 6 des kalendes de mai (24 avril), lança
l'excommunication contre les rois, ducs ou comtes, qui voudraient établir leur
domination sur ce monastère, ses propriétés et ses religieux. Cette bulle
accordait aux frères de l'ordre le droit d'élire leur abbé, à condition qu'il
ne pourrait recevoir la bénédiction que des papes. Elle leur accordait aussi le
privilège de ne pouvoir être excommunié.
Ce monastère fut détruit par les
Sarrasins, en 715. Saint Gilles
obtint de Charles-Martel l'autorisation de le faire reconstruire ; mais il ne
choisit pas le même emplacement ; ce fut dans l'enceinte même de la ville
gauloise, qui depuis reçut son nom, qu'il enferma son nouvel édifice, afin de
le mettre à l'abri des attaques des barbares. Enfin, il mourut au mois de
septembre de l'année 720, en léguant
à la dévotion des fidèles un tombeau de sain, et un nom illustre, que la ville
où il demeura si longtemps pris en reconnaissance de ses bienfaits.
Nous ne suivons pas en détail
l'histoire de la ville de St-Gilles, qui n'est autre que celle de son monastère
jusqu'au XIe siècle ; nous laisserons cette fondation du patron de la ville
régénérée, qui ne s'appellera plus ni Rhodes, ni Héraclée, mais St-Gilles, et
nous nous transporterons, trois siècles plus tard, à l'année 1042, époque du premier concile tenu à
St-Gilles, sur la paix et la trêve de
Dieu. Il y en avait eu précédemment plusieurs autres sur le même sujet,
dans d'autres villes de France ; mais ils étaient mixtes, c'est à dire,
composés de laïques et d'ecclésiastiques. Celui-ci ne fut composé que
d'archevêques et d'évêques, au nombre de vingt-deux.
Vers l'année 1096, (1) saint
Ladislas, roi de Hongrie, fonda le monastère de Summichen, en l'honneur de
saint Gilles : les Français seuls pouvaient y être reçus. Ce prince en fi don à
Odilon et aux abbés, ses successeurs, sous la condition expresse que l'abbé de
Summichen serait toujours sous l'obédience de l'abbé de St-Gilles. L'abbé de
Summichen était le plus souvent appelé abbé de St-Gilles de Hongrie.
(1) NDLR : date probablement antérieure à 1096, Ladislas Ier étant décédé le 29 juillet 1095.
Raymond de St-Gilles, qui prit le
titre de comte de Toulouse et de Rouergue, de duc de Narbonne et de marquis de
Provence, fit abandon, en 1096, à l'abbé de St-Gilles, de tout ce qu'il
possédait dans la ville et dans le territoire de la Vallée Flavienne ;
conséquemment, l'entière juridiction de la ville appartint à l'abbé (1), ce qui
n'empêche pas les successeurs de Raymond de faire des entreprises contre la
ville et le monastère.
(1) Trois villages : Sieure, Speiran et Stagel, dépendaient aussi de
l'abbaye de St-Gilles. Ces trois villages sont appelés villa, dans la bulle du
pape Calixte II, l'année 1119. à St-Félix, et L'église de Sieure, portait le
nom de St-Saturnin ; celle de Speiran était dédiée à St Félix, et celle de
Stagel, à Ste-Cécile.
Dans la même année, le pape Urbain II
vint à St-Gilles ; il y célèbrera la fête patronale du 1er septembre. C'est à
la suite de ce voyage qu'il déclara, dans une bulle, qu'il avait dédié à Dieu
la nouvelle basilique de St-Gilles (1).
(1) Urbain II veut parler de l'église inférieure, l'église supérieure
n'ayant été commencée que 20 ans plus après.
Environ quatre siècles après la mort
de son patron, St-Gilles était parvenu à un point qui en faisait une des
principales villes du Languedoc. Elle devait surtout sa splendeur à la piété et
au concours des peuples qui venaient en pèlerinage sur le tombeau de son
fondateur. Cette vénération est attestée par des actes authentiques. Ce
pèlerinage fut même obligatoire pour certains peuples. On lit dans le traité de
paix passé entre les Flamands et le roi Charles-le-Bel, que les habitants de
Bruges et de Coutray, étaient tenus d'y envoyer annuellement cent pèlerins.
La population de St-Gilles était
devenue très-considérable ; la ville et ses faubourgs contenaient, au Xe
siècle, 33 000 feux (a). Les comtes
de Toulouse, qui en furent souverains, y avaient leur palais et un hôtel des
Monnaies. Elle eut ses lois, son consulat, qui se composait de lieux anciens,
tels que Stagel, Sieure, Ste-Colombe, St-André-de-Camarignan et Speiran. La
qualification de comtes de Speiran fut prise par quelques abbés de St-Gilles.
Speiran était une forêt immense, au centre de laquelle s'élevait un château,
qui n'était autre chose qu'un rendez-vous de chasse, appartenant aux comtes de
Toulouse.
(a) NDLR - 33 000 feux au Xe S, cela
nous donne une population de plus de 100 000 habitants, plus loin il donne pour
la population de 1410 : 40 000 feux,
ces chiffres sont contestés par certains
historiens. En effet, une ville de plus de 100 000 habitants était
forcément dotée d'une énorme infrastructure. Elle aurait laissé d'importants
vestiges, mais rien à ce jour n'a été prouvé.
Pour argumenter voici quelques chiffres donnés par différents historiens
: Germer-Durand 1383 : 40 feux ; 1744 : 600 feux ; 1789 : 1181 feux - Dictionnaire des Gaules 1559 : 600 feux - Bligny Bondurand 1789 : 1180 feux.
L'agriculture, enseignée par les
religieux, le commerce, favorisé par la situation d'un port commode sur le
Rhône (1), contribuaient beaucoup à
ses progrès industriels. L'intelligence y faisait aussi de grands pas. On
cultivait les belles-lettres dans l'enceinte du monastère. On y copiait les
ouvrages des anciens, et même ceux des modernes qui avaient le plus de
célébrité, ainsi que cela se pratiquait dans tous les couveras de Bénédictins. (2)
(1) Quoique cette ville ne soit pas sur le bord de la mer, elle n'a pas
laissé d'être autrefois un port considérable, à peu près comme ceux de
Narbonne, de Bordeaux, de Rouen et des autres villes placées à l'embouchure des
rivières. Les vaisseaux et autres bâtiments entraient dans le port de St-Gilles
par le petit bras du Rhône, et trouvaient une retraite assurée dans le lit du
fleuve. On abordait ensuite sur la rive gauche, vis-à-vis de la ville, à
l'endroit qui conserve encore aujourd'hui le nom de port. Divers traits de
l'histoire du moyen-âge, nous fournissent les preuves certaines de l'existence
et de la fréquentation de ce port, surtout dans les XIe et XIIe siècles. Il
parait même que ce port avait rendu le commerce florissant à St-Gilles. (Ménard,
Notice de la viguerie de Nîmes, t. VII, page 619).
(2) Dom. Mabillon, que nous avons déjà mentionné, s'occupa d'une
polygraphie sur les hommes qui ont illustré l'ordre des Bénédictins. On y voit
que les différents ordres mendiants, tels que Franciscains (St François
d'Assise), Dominicains (Ignace de Loyala), et Bénédictins (St Benoit), ont
beaucoup fait dans leur époque pour la société, et que l'histoire du monachisme
chrétien est l'histoire de la civilisation.
Dès le commencement du XIIe siècle il
y eut à St-Gilles une école de belles-lettres et de dialectique, dirigée par
Jourdain de Clivo, que les citoyens de Milan élirent archevêque en 1112.
La fondation du grand-prieuré de
l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem (1),
remonte à cette dernière époque ; c'est la maison la plus ancienne de cet
ordre. Sa commodité, et sa position agréable sur le Rhône, à trois lieues de la
mer, y attiraient un grand nombre de pèlerins, qui passaient en ces lieux pour
se rendre dans la Terre-Sainte. Les comtes de St-Gilles y fondèrent un hôpital
dont l'administration fut confiée aux frères hospitaliers de
St-Jean-de-Jérusalem.
Le second concile de St-Gilles fut
tenu en 1115, par un légat du St-Siège. On y agita un différend survenu entre
les abbés de la Grasse et d'Aret. L'année suivante on finit de bâtir l'église
supérieure, vingt ans après qu'on
eut posé la première pierre de l'église inférieure.
(1) L'établissement des Templiers, à St-Gilles, est postérieur de
quelques années à celui de l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem. Le supérieur se
nommait, en 1139, Robert, maître du temple ; Bertrand lui succéda. Leur manoir
était situé-vis-à-vis de l'hôpital de St-Jean-de-Jérusalem. Leur église
existait encore en 1790, mais elle était abandonnée.
On sait que ce fut en 1307 que Je roi Philippe IV fit commencer les
procédures contre l'ordre des Templiers. Elles aboutirent à son extinction e
prononcée par Clément V dans le concile de Vienne, et au supplice du
grand-maitre et des principaux frères de la chevalerie du Temple. Les chevaliers
de StJean-de-Jérusalem prirent possession, le 12 juillet 1312, des biens
considérables que les Templiers de St-Gilles possédaient dans ce territoire et
dans celui de la Camargue.
Le pape Gelase II, et le pape Calixte
II, passèrent tous les deux à St-Gilles : le premier, en 1118, et le second en
1120. Le pape Innocent II y passa aussi en 1130.
L'hérésie de Pierre Bruys et du moine
Henri donna lieu, en 1146, à un acte de cruauté dont le fanatisme religieux et
l'ignorance de ces temps reculés sont les moteurs. Arrivés à St-Gilles, ces
deux hérésiarques, dans le but sans doute de prouver le mépris que leur système
témoignait au mystère de la Croix, firent cuire, le vendredi saint, sur la
place publique, de la viande qu'ils mangèrent en présence du peuple ; le feu
était alimenté par des morceaux de bois provenant des débris de plusieurs croix
qu'ils avaient arrachées. Pierre de Bruys fut victime de son sacrilège ; les
habitants furieux le saisirent et le brûlèrent sur le bûcher qu'il avait allumé
lui-même. Le moine Henri, son disciple, évita pas la fuite le châtiment qui
l'attendait.
Au mois de septembre de l'année 1165
eut lieu une bineuse bataille entre les Pisans, alliés des St-Gillois et les
Génois. Cette bataille se donna sur le territoire de Fourques et sur celui de
St-Gilles. Les Pisans y conservèrent l'avantage.
Suivant le témoignage du rabbin
Benjamin de Tudèle, il y avait à St-Gilles, en 1170, une synagogue célèbre
composée de cent juifs savants, dirigés par six principaux rabbins.
En 1181, le 4 janvier, bulle
d'Alexandre III, qui accorde à l'abbé de St-Gilles le privilège de porter la
mitre, la crosse et l'anneau. En 1208, alliance entre les villes de Marseille,
d'Avignon et de St-Gilles. Ces trois villes devaient se donner mutuellement
conseil, secours et assistance, soit en paix, soit en guerre. L'alliance était
contractée pour dix ans, mais pouvait se renouveler ; l'abbé de St-Gilles et
les quatre consuls la signèrent. Elle était encore en vigueur cinquante ans
après, du temps de St Louis.
Le troisième concile de St-Gilles fut
tenu, en 1209, contre Raymond VI comte de Toulouse, accusé de favoriser les
Albigeois, et d'avoir fait périr Pierre de Castelnau, légat du pape, assassiné,
le 15 janvier 1208, sur les bords du Rhône, à l'endroit où est aujourd'hui le
pont de bateaux. Nous puisons dans, Pierre de Vaulx-Sernay, qui était témoin
oculaire, le détail de là cérémonie de l'amende honorable du comte-de Toulouse.
« Milon, légat du pape, venu à
St-Gilles pour donner l'absolution à Raymond et le réconcilier avec l'église,
se rendit dans le vestibule de l'église supérieure où l'on avait exposé le
St-Sacrement et les reliques des saints. Il était accompagné de trois
archevêques et de dix-neuf évêques. Le comte Raymond était nu jusqu'à la
ceinture, seize barons vassaux du comte, les consuls de St-Gilles, tant pour
eux que pour le consulat de la ville et de l'église de St-Gilles, composé des
villages de Sieure, Stagel, Ste-Colombe, Speyran et St-André-de-Camarignan,
jurèrent en même temps que le comte Raymond, sur l'Eucharistie, et sur les
reliques des saints, d'obéir à tout ce qui leur serait ordonné par la sainte
Église romaine. Après ce serment, le légat Milon reconduisit le comte. Raymond
en le battant de Verges, hors de l'église, à travers une foule innombrable qui
encombrait toutes les avenues. La chronique de pierre de Vaulx-Sernay remarque
que la foule était si grande pour assister à cette cérémonie, que le pénitent
ne pouvant sortir par le grand portail de l'église supérieure, qui donne sur la
place, on fut .contraint de le faire descendre dans l'église inférieure ou
souterraine, ce qui le contraignit à passer devant le tombeau de Pierre de
Castelnau, dont il avait causé la mort.
L'excommunication de Raymond suivit
de près son amende honorable. En 1210, lors du quatrième et dernier concile
tenu à St-Gilles, on mit une condition à son entière absolution : ce fut de
prendre l'engagement de chasser de ses terres, tous les partisans des Albigeois
; sur son refus, l'excommunication fut lancée contre lui.
Louis VIII, fils aîné de
Philippe-Auguste, vint visiter, pendant l'année 1315, l'église- et les reliques
de St-Gilles. Le but de son voyage dans le midi de la France était une croisade
contre les Albigeois. Les comtes de Toulouse, au contraire, se prononcèrent en faveur
de l'hérésie, et Simon de Montfort, qui accompagnait le roi dans sa croisade se
trouva en présence des habitants de St-Gilles, qui ne purent refuser leur appui
aux comtes de Toulouse leurs seigneurs. Ils durent dès cet instant se montrer
hostiles à l'Église romaine. Le pape Honoré III, surpris du parti qu'ils
venaient de prendre, leur ordonna, par lettre datée de Rome, décembre 1217, de
cesser d'opposer de la résistance à Simon de Montfort qui représentait la cause
du roi. Ils persévérèrent dans leur opposition jusqu'en 1336, et il fallut le
retour de Louis VIII dans ces contrées méridionales, et l'exemple de Narbonne,
Marseille, Carcassonne, Beaucaire, etc., pour les déterminer à se soumettre.
St-Gilles, depuis cette époque, est
demeurée fidèle aux rois de France.
La division de St-Gilles en sept
paroisses, sans y comprendre l'église abbatiale, eut lieu en 1231.
Paroisse de : St-Jacques ; St-Nicolas
; St-Privat ; St-Jean-l'Évangéliste ; St-Pierre ; St-Martin ; St-Laurent.
L'abbé de St-Gilles avait été autorisé,
en 1181, à porter l'anneau, la crosse et la mitre ; une bulle d'Innocent IV, en
1246, lui accorda le privilège de porter les sandales, la dalmatique et les
gants.
Louis IX, à son retour de la
Terre-Sainte (1254), passa à St-Gilles et s'y arrêta quelques jours. Il y
rendit une ordonnance par laquelle il appela le Tiers-État à délibérer sur les
matières politiques. Quelques publicistes pensent qu'elle est l'origine des
États du Languedoc. Seize ans après, saint Louis tint une cour plénière à
St-Gilles, et y reçut les ambassadeurs de Michel Paléologue, empereur de la
Grèce.
Le pape Clément IV, successeur
d'Urbain IV, naquit à St-Gilles. Le monastère et la ville elle-même furent
toujours l'objet de sa sollicitude. Il lança plusieurs bulles en leur faveur ;
des reliques et des présents leur furent envoyés de Rome.
Clément IV, avant de s'asseoir sur le
trône papal, était simple jurisconsulte à St-Gilles sous le nom de Gui Fulcodi.
Nous retrouvons, dans les archives de cette ville, un ouvrage star ses lois-et
coutumes, écrit en langue romane et en latin, au commencement du XIIIe siècle.
Il renferme une sentence arbitrale du 14 juin 1257, rédigée par Gui Fulcodi, le
jurisconsulte. Elle contient cinquante pages en vingt-sept pétitions des
syndics, et neuf pétitions de l'abbé et du monastère. Cette sentence donnait le
droit aux habitants de faire construire des tours, des pigeonniers, des
garennes, et leur accordait aussi le droit de chasse. Quant à la pêche de
l'étang de Scamandre, et des marais du Chapitre, ils en avaient la faculté
moyennant une rétribution appelée levade, qu'ils payaient au chapitre.
De la lecture de ce manuscrit sur les
lois et coutumes de St-Gilles (Las
costumas et leys municipales de Sainct Gily) (1) il résulte que l'abbé, seigneur temporel et spirituel, mais non
seigneur foncier de St-Gilles et de son territoire, avait seul le droit de
proposer des lois. Il devait d'abord présenter son projet aux consuls et aux
syndics, qui convoquaient alors une assemblée générale de tous les habitants, et
leur lisaient le projet de loi.
(1) Une partie des archives du monastère et de la ville fut brûlée par
les protestants, en 1582 (mois d'août). Après cet incendie, et le vol
particulier fait au Chapitre, le 11 mai 1663, il ne restait plus qu'une centaine
de bulles originales et des lettres-patentes des rois de France. Ces documents
précieux ont été dispersés pendant la révolution de 1789, et il n'en reste plus
rien de remarquable que les ouvrages sur les lois et coutumes de la ville de
St-Gilles.
Si le peuple l'acceptait, il
manifestait son adhésion en criant : Hoc ! Hoc ! Le projet, dans ce dernier cas
était, et signé : l'abbé et les syndics y apposaient leurs sceaux, et il
devenait, dès cet instant, une loi définitive et obligatoire pour l'abbé et pour
les habitants. Nous prenons pour exemple, et au hasard, dans ce recueil, à la
page 135, un passage rédigé sous l'abbé Hugues II, intitulé :
De justiliâ domini Abbatis.
« Fos
aussy convengut et appointat, sur alcunas demandas que Mgr. l'Abbat fazia alz
syndics, hou homes de St- Gily al tempo advenir aguesson alcuna question, débat
hou alcuna discention au lo dit Abbat, sos successors, hou son monestier, que
lo dit Abbat lor deu donar cort hou juge, davant loqual syan tengutz de
respondre coma davant lo juge donat per la dit Abbat, hou sos sucressors; car
lo dit Abbat a puyssenza de donar la ditcort hou juge, ainsy que costa et appar
par las compositions al temps passat, per los dessus et nomatz, fachas entre
los dits syndics et monestiers, ainsy que des lo dit Abbat, plus emplement
contengut, convengueron et transigeron los dits syndics al nom que dessus et
feyron pacte que lou estessa sur las causas dictas à la ley municipala,
composition hou compositions entre lo dit monestier et la dicta villa fachas al
temps passa per los scuhors dessus dits, la forma laquela hou de lasqualas ont
volgat sya gardada et observata en las causas dellas dictas ».
Une autre loi sur le droit du fisc, de jure fisci, finit par ce cas :
Lorsqu'un étranger mourrait à St-Gilles, ab
intestat, ses biens étaient mis entre les mains d'un homme de probité, et
si après un an et un jour aucun héritier ne s'était présenté pour les réclamer,
l'abbé en faisait deux portions égales, l'une pour le Monastère, l'autre pour
les hôpitaux. Le seigneur n'entrait pour rien dans ce partage.
Nous lisons un peu plus loin une loi
sur le blasphème, dont nous donnons la traduction en français.
De.pcend. ludentium et jurantium.
« Si
quelqu'un, à quelque jeu que ce soit, prononce un blasphème ou se parjure par le
corps, le sang, le foie ou tout autre membre de Dieu et de la Vierge Marie ou
de St-Gilles, pour chaque fois, il sera tenu de payer trois Sols et deux sols
pour les autres saints ».
Cette dernière citation doit faire
apprécier la sagesse et la douceur des lois de St-Gilles, surtout dans une
époque où Philippe-Auguste, dit Rigord, « conçut
tant d'horreur pour les jurements, que si quelqu'un, chevalier ou autre,
venait, par hasard, à en laisser échapper un, en jouant devant, le roi,
aussitôt il était -jeté, par son ordre, dans, la rivière ou dans quelqu'autre
lac ».
Après ce règne, Louis IX faisait
punir par la mutilation de quelque membre ceux qui proféraient des paroles
blasphématoires. Ce fut d'après les conseils et les exhortations du pape
Clément IV que ce roi ne fit plus punir les blasphémateurs que par une amende
pécuniaire.
Après le bannissement des Juifs,
ordonné par Philippe-le-Bel, il s'éleva un différend entre ce roi et l'abbé de
St-Gilles, sur la propriété des terres israélites abandonnées. On passa enfin
un traité par lequel un tiers seulement appartiendrait à l'abbé.
En 1410, l'abbé de St-Gilles se nommait Salvator Guillelmi : d'après
une supplique que ce prêtre adressa à Sigismond, roi de Bohème et de Hongrie,
on pourrait conclure que la population de St-Gilles aux XIIe et XIIIe siècles,
s'élevait à près de cent mille âmes, c'est-à-dire , plus de trente mille feux,
en ne comptant que trois personnes par feu : triginta millia focagia hominum.
En 1423, transaction et accord entre l'abbé de St-Gilles et les
religieux de son monastère pour faire fabriquer une châsse d'argent doré, pour
y placer la tête du patron de St-Gilles. On reconnaît par cet acte, ainsi que
par deux ordonnances de l'évêque de Nîmes, une erreur de Dom Vaissette,
Baillet, Moreri et tous ceux qui les ont suivis, au sujet des reliques de
St-Gilles, lorsqu'ils ont avancé qu'elles avaient été transférées à Toulouse du
temps des guerres des Albigeois. Les Bollandistes, au contraire, affirment
qu'elles furent transportées en 1562, ce qui établit un anachronisme de près de
quatre siècles.
1538. Bulle de
sécularisation donnée par le pape Paul III, le 16 des kalendes de septembre (17
août 1538). Par cette bulle, le monastère de l'ordre de St-Benoit fut changé en
un chapitre de chanoines, et l'abbé régulier en abbé séculier. Le chapitre fut
composé d'un doyen, d'un grand archidiacre, d'un second archidiacre, de
dignités, d'un sacristain, d'un précenteur ou capiscol, d'un trésorier, de
personnats et de douze chanoines. Plus tard, on y ajouta quinze bénéficiers qui
n'avaient point voix au chapitre.
L'abbé séculier devint seigneur
temporel et spirituel de la ville et du territoire de St-Gilles, comme
l'avaient été les abbés réguliers.
La fameuse bataille appelée défaite
des Provençaux, se donna le 27 septembre 1562, entre le Rhône et la ville de
St-Gilles. Les catholiques, battus par les huguenots, y perdirent deux mille
hommes, deux pièces de canon et vingt-deux drapeaux. Depuis ce jour, et dans
l'espace de soixante ans environ, St-Gilles fut pris et repris quatre fois : le
2 juin 1570, par le maréchal Damville, après trois jours de siège ; le 8
décembre 1574, par le même maréchal qui avait abandonné la cause royale et
catholique ; M. de Crussol, duc d'Uzès, l'emporta d'assaut au mois de janvier 1573
; et enfin, le 24 juillet 1622 , le duc, avec un train considérable
d'artillerie, et environ 1500 hommes, s'en empara au nom de Louis XIII. Depuis
cette époque, St-Gilles n'a plus eu de siège à soutenir.
Au temps où les abbés de St-Gilles
avaient la qualité de hauts justiciers, il était perçu par eux un droit appelé Lundi, sur tout ce qui se vendait dans
St-Gilles par des personnes étrangères. Il n'y avait point de halles publiques,
par conséquent, point de droits de bannage (1).
Les droits sur les poids et mesures n'y existaient pas non plus ; il n'y
avait ni fours, ni forges ni moulins publics. Ceux dont on faisait usage
appartenaient à des particuliers. Le roi ne prélevait dans cette ville aucun
droit de Champart (2). C'était donc
le clergé seul, comme autorité locale, qui percevait un impôt.
(1) Bannage, dérive de bannâte, corbeille ou bannette, espèce de panier.
(2) Champart, droit qu'avaient plusieurs seigneurs de fiefs, de lever une
certaine quantité de gerbes dans leurs censives.
Les mœurs et les lois ont subi
depuis, ces derniers temps de grandes modifications, St-Gilles a cessé
d'occuper une position exceptionnelle, en retombant dans la loi commune des
autres villes de France. Quoique entrainée.par le grand système de la
centralisation, cette ville a conservé de nos jours un caractère qui rappelle
son antique origine, et les phases qui l'ont suivie. Sa population, presque
entièrement catholique, a subi une grande diminution, si on la compare aux
temps anciens ; elle ne s'élève pas aujourd'hui à 6 000 âmes. Les accès de
fièvre-chaude y exerçaient de grands ravages, surtout chez les personnes qui
habitaient ce pays depuis peu de temps. Depuis les travaux de dessèchement son
climat s'est amélioré, et St-Gilles n'est plus aujourd'hui, sous le rapport
sanitaire, ce qu'il était autrefois. Son territoire est divisé en deux plaines
dont le sol est de nature différente ; la première est formée par les alluvions
du Rhône ; et se trouvé comprise entre le Rhône et le canal de Beaucaire qui
traverse le territoire du nord au midi ; la deuxième forme le plateau de la
colline, qui s'étend, de Beaucaire à Vauvert. Le sol en est graveleux et
ondulé. L'industrie vinicole est très-importante. Le commerce recherche avec
empressement les vins de St-Gilles, et l'exportation de ce produit est
considérable.
|
Cahier de doléances de la Sénéchaussée de
Nîmes
pour les états Généraux de 1789.
Communauté
de St-Gilles
publié
par E. Bligny Bondurand, 1908 T2 pages 224 à 229.
SAINT-GILLES.
Diocèse de Nîmes.
PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Tiers état de la ville de Saint-Gilles,
pour la convocation des États généraux, authentique. 12 mars 1789.
Six députés : Michel, notaire ; Couderc, apothicaire ; Dugas, marchand ; Gautier, notaire ; Serrier, bourgeois ; Antoine Michel, fabricant
d'eau de vie.
Saint-Gilles est une des
sept villes de la sénéchaussée de Nîmes où les officiers municipaux devaient,
aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 27 février 1789, rendu par le
lieutenant général de la sénéchaussée, et reproduisant les dispositions du
règlement royal du 7 février 1789, tenir des assemblées de toutes les
corporations, corps et communautés, et de toutes les personnes du Tiers état ne
tenant à aucune corporation, avant de procéder à l'assemblée générale de la
communauté. Ces assemblées particulières devaient nommer un ou plusieurs
représentants, chargés de me rendre à l'assemblée du Tiers état de chacune
desdites villes pour y concourir à la rédaction du cahier et à la nomination de
députés, suivant les articles 26 et 27 du règlement du 24 janvier 1789.
Aussi voit-on, dans le
procès-verbal de Saint-Gilles, figurer un député des officiers de justice, deux
députés des avocats en parlement, un député des avocats, deux députés des
notaires , un député, des médecins , deux députés des procureurs, deux députés
des bourgeois, un député des armateurs, un député des marchands de blé ; deux
députés des négociants, un député des salpêtrière, un député des chirurgiens,
un député des apothicaires, un député des marchands drapiers, un député des
orfèvres, un député des ménagers, un député des boulangers, un député des
fabricants d'eau de vie, un député des aubergistes, un député des tailleurs
d'habits, un député des menuisiers, un député des charrons, un député. des
bourreliers, un député des pêcheurs, un député des Maréchaux à forge, un député
des serruriers, un député des maçons, un député des cordonniers, un député des
chapeliers, un député des perruquiers, un député des jardiniers, un député des
meuniers, deux députés des laboureurs, huit députés des travailleurs.
Signatures ; Michel av. et
n. Gautier, Dugas. Serrier, etc.
NOTICE
1180 feux.
Président de l'assemblée :
Pierre Senilhac, maire
syndic clavaire.
Le premier grand prieuré de
Saint-Jean de Jérusalem fondé en Europe le fut à Saint-Gilles, par Raimond IV
de Toulouse. L'abbaye de Saint-Gilles, unie à l'archevêché d'Aix en 1774, (France ecclésiastique, 1789, page 328),
avait la seigneurie, et valait 42 000 L. de rente.
L'abbé et le grand prieur
possédaient, à peu près tout le territoire.
A la séance du 28 mars 1789
(assemblée des nobles de la sénéchaussée), Jacques François Descombiès, ancien
page du Roi, représente M. de Plauchut, seigneur de La Cassagne et de
Sainte-Colombe, commune de Saint-Gilles.
Oliviers, mûriers, vigne,
blé, fourrages, pâtis, marais.
CAHIER authentique.
Cahier des vœux et doléances du Tiers état de la ville de
Saint-Gilles, sénéchaussée de Nîmes.
Le Tiers état de la ville de
Saint-Gilles, sénéchaussée de Nîmes, désirant concourir aux vues bienfaisantes
du meilleur des Rois, consignées dans sa lettre de convocation aux États
généraux, par laquelle il invite tous les sujets de son royaume à lui faire
connaître les souhaits et les doléances de ses peuples, a manifesté ses vœux
ainsi que s'ensuit :
1. - Qu'aux États généraux les suffrages soient comptés par
tête et non par ordre; que lesdits États consentent les impôts nécessaires et
capables de remédier à l'état actuel des finances ; que lesdits impôts
parviennent dans les coffres du Roi par les voies les moins coûteuses ; qu'ils,
soient également répartis, ainsi que les autres charges, tant royales que
locales, sur les trois ordres, en proportion des facultés de chacun ;
2. - Le retour périodique des États généraux ;
3. - La suppression de la constitution des États actuels de la
province ;
4. - Qu'il soit procédé à la réforme du code civil, criminel et
municipal ; à l'abus de la longueur et durée des procès et des frais immenses
qu'ils entraînent, en diminuant la multiplicité des formes et des dépens ;
5. - Le rapprochement des justices souveraines, et qu'il n'y
ait que deux degrés de juridiction, tant en matière civile que criminelle ;
6. - La suppression des justices seigneuriales,
particulièrement celles des seigneurs ecclésiastiques, pour être remplacées par
des justices royales, auxquelles il serait accordé une médioce souveraineté,
jusques à telle somme qu'il plaira à Sa Majesté de fixer ;
7. - Qu'il plaise à Sa Majesté d'ôter toutes les entraves qui
gênent le commerce dans l'intérieur du royaume ; que la circulation des denrées
et des marchandises y soit libre, et que, pour cet effet, la perception de
droits soit fixée aux frontières du royaume ;
8. - La suppression :de tous les péages, leudes, douanes et
courtages, du privilège exclusif qu'a obtenu la ville de Marseille pour faire
le commerce du Levant, afin que tous les négociants du royaume puissent faire
le même commerce ;
9. - Que le taux de la levée de la dime soit uniforme. Que les
villes qui la paient au dix, comme Saint-Gilles, ne soient pas plus surchargées
que celles qui la paient au trente ou au quarante ; que la semence soit
prélevée et exempte d'être dimée une seconde fois ; que les fourrages de toute
espèce soient exempts de la dime, puisqu'ils servent à nourrir le bétail sur le
terroir duquel la dime se perçoit, le décimateur prenant les fruits quittes et
francs de toute culture ;
10. - L'abolition des lettres de cachet, la liberté de la
presse, la suppression de tous les tribunaux d'exception, excepte; les
juridictions consulaires ;
11. - L'uniformité des poids et mesures dans tout te royaume ;
12. - La suppression des levée à des milices, ou la liberté aux
communautés de fournir des hommes ; celle des pêcheurs réduite aux villes
maritimes ; et que les tonneliers ne soient plus soumis aux classes (1) ; que le nombre des inspecteurs des
eaux de vie soit augmenté ;
13. - Que le sel soit déclaré marchandise dans tout le royaume,
et que le produit de cet impôt soit confondu dans les impositions à venir, ne
gagnât-on par ce moyen que les frais immenses qu'occasionnent soixante-mille
commis pour empêcher la contrebande ;
14. - L'augmentation des portions congrues, la suppression du
casuel des curés, et que leurs logements et ceux des vicaires soient à la
charge des décimateurs.
(1) Les tonneliers de Saint-Gilles jugeaient leur art trop essentiel pour
qu'on les inscrivit sur les registres de l'inscription maritime. Ici le sens du
mot classes est très clair, et permet d'entrevoir que l'article 18 de Roquedur,
en parlant de "l'article des classes" visait peut-être les
"marchés pour la Marine et assurances à la grosse aventure sur les
vaisseaux" (Recueil de Néron, t. II, p. 302 et 303).
Vœux
relatifs et particuliers à la ville de Saint-Gilles.
15. - La ville de Saint-Gilles, une des sept principales de la
sénéchaussée, ne jouit d'aucune prérogative des autres villes. Elle n'a point
de consuls, bornée à un syndic clavaire sans marque distinctive ; elle n'a
point entrée aux États de la province, ni aux assiettes diocésaines ; elle n'a
pas même un hôtel de ville, et est obligée de s'assembler dans une salle de
l'hôpital.
16. - Elle supplie qu'il soit accordé à ladite communauté
d'avoir quatre consuls avec chaperon, à sa nomination, avec l'exercice de la
police ; l'entrée aux États de la province et aux assemblées de l'assiette
diocésaine ; la permission d'avoir un hôtel de ville et le droit de s'y
assembler ; et d'être mise en tout à l'instar des autres villes de la
sénéchaussée. Elle supplie encore qu'en attendant que Sa Majesté veuille bien
rendre toutes les justices royales, le seigneur abbé de Saint-Gilles soit tenu
de faire construire des prisons, ne pouvant donner ce nom à celles qui
existent, n'étant composées que d'une seule pièce de huit pieds en carré, fort
malsaine, et plutôt un cachot que des prisons, et où il faut monter par une
échelle.
17. - Elle supplie qu'à l'avenir le seigneur abbé de
Saint-Gilles soit tenu de résider en cette ville, et qu'à cet effet l'abbaye ne
soit donnée à aucun prélat obligé par sa place de résider ailleurs. - L'abbaye
est dotée de 42 000 livres de rente.
18 - Elle fait la même demande à l'égard de M. le grand prieur
de l'ordre de Malte (1), et qu'il
soit tenu de tenir les chapitres et assemblées de son ordre dans la ville de
Saint-Gilles, chef-lieu dudit grand prieuré, portant son nom.
(1) Il résidait à Arles.
19. - La stabilité du chapitre de Saint -Gilles (1) dans cette ville, et la
conservation des bénéficiers dudit chapitre ; on cas de nomination, que les
canonicats et bénéficiatures soient affectés aux enfants de Saint-Gilles, et
les canonicats, par préférence, aux bénéficiers; qu'il soit affecté le revenu
d'une prébende dudit chapitre pour l'entretien des précepteurs chargés de
l'éducation de• la jeunesse ;
(1)Les moines de l'abbaye avaient été sécularisés par Paul III et
formaient un chapitre collégial.
20. - Que les baux à l'orme consentis par les ecclésiastiques
et Messieurs de l'ordre de Malte soient entretenus par leurs successeurs
pendant la durée fixée par leur bail.
Signatures : Troudet, Agnier, Gautier, Michel av1 Senilhac, Serrier, Laganier, J. Ferry, P. Langlois, Fabrègues,
Meirieu, Rus, Couderc, Dugas, Mielle,
Pierron, Armentier, Faucher, Allier, Michel fils, P. Sigaud, Chay, Despox,
Michel, P. Portal, L. Michel, Louis Meirieu serrurier, Rouet, Meirieu, Texier,
Brignan, Roger, Étienne Clavel, Boyer, Mestre, Dr Labigaut, Roussin, Ramade. Ne
varietur : Senilhac, maire, syndic et clavaire.
(Archives du Gard, C. 1196.
District de Nîmes)
|
GRANDE ET PETITE HISTOIRE DE SAINT-GILLES (Gard)
SAINT-GILLES
extrait de Saint-Gilles
par Augustin Fliche, 1925 - page 53 à 59
INTRODUCTION HISTORIQUE
Les origines de l'abbaye de
Saint-Gilles sont, comme celles de Psalmodi, enveloppées d'une certaine
obscurité.
Il y eut primitivement, semble-t-il,
au lieu où devait s'élever au XIIe siècle l'illustre basilique qui attira un
grand concours de pèlerins, un modeste monastère dédié à saint Pierre et à
saint Paul. Au IXe siècle sans doute, ce patronage fut échangé contre celui
d'un saint local, dont le prestige alla grandissant : saint Gilles.
La vie de saint Gilles a été écrite
au Xe siècle, mais ce récit hagiographique, qui fait de saint Gilles le
contemporain à la fois de saint Césaire et de Charlemagne, est totalement
dépourvu de valeur historique, et il ne mériterait même pas une mention, s'il
n'avait contribué à fixer le culte de saint Gilles au lieu qui porte son nom et
où son tombeau était devenu l'objet d'un culte.
Quant au monastère, qui devint le
centre de ce culte, on n'en connaît l'histoire avec quelque précision qu'à
partir des dernières années du IXe siècle. Aux Xe et XIe siècles, le pèlerinage
se développe ; il atteint son point culminant au XIIe siècle. La renommée de
l'abbaye de Saint-Gilles dépasse alors les limites du Languedoc et de la
Provence ; aux bienfaiteurs locaux viennent se joindre d'autres protecteurs
plus haut placés : les rois de France et les papes.
Dès le début du XIe siècle, Benoit
VII (1022-1024) par un privilège d'exemption a soustrait l'abbaye à toute
juridiction séculière. Grégoire VII (1073-1085) la subordonna à Cluny, tout en
laissant aux moines le privilège d'élire librement leur abbé et c'est ainsi que
Saint-Gilles put, comme Vézelay et comme Moissac, garder sous l'hégémonie
clunisienne son titre d'abbaye. Urbain II (1088-1099), au cours de son voyage
en France, visita à deux reprises le monastère, en septembre 1095 et en juillet
1096, époque à laquelle il consacra l'église qui était alors en construction.
Son exemple a été suivi par plusieurs de ses successeurs : Gélase II s'est
arrêté à Saint-Gilles en novembre 1118 ; de même en 1130, Innocent II qui, en
1132, confirma les privilèges accordés par ses prédécesseurs. Clément IV
(1265-1268), qui était originaire de Saint-Gilles, a multiplié les attentions :
au cours de ses trois années de pontificat, douze bulles ont été délivrées en faveur
du monastère à l'ombre duquel il était né ; les présents affluèrent également :
sceau d'argent, ornements de soie, calice d'or.
Les papes ne se sont pas contentés
d'honorer l'abbaye de Saint-Gilles de leur présence ni de lui témoigner leur
générosité. Ils l'ont encore défendue contre ses plus terribles ennemis : les
comtes de Toulouse.
Le monastère était redevable d'une
bonne partie de ses propriétés foncières aux comtes de Toulouse qui, aux Xe et
XIe siècles, s'étaient montrés généreux à son endroit. Pourtant à la fin de
cette période il y a eu un ralentissement notable dans les donations et même
une tentative pour reprendre ce qui avait été antérieurement concédé : au
concile de Nîmes, en juillet 1096, Raymond IV, avant de prendre la croix, dut
restituer à Saint-Gilles quelques biens qu'il retenait indûment. Au début du
XIIe siècle, le fils de Raymond IV, Bertrand, s'empara d'autres biens
appartenant à Saint-Gilles, envahit le bourg et pénétra même dans l'église, ce
qui lui valut d'être immédiatement excommunié par Pascal II. Le conflit
recommença sous le règne d'Alphonse-Jourdain, frère de Bertrand, qui, en 1121,
profitant de ce que l'abbaye traversait une crise d'ordre financier, occupa à
nouveau le bourg et l'église. Calixte II lui enjoignit de se retirer dans un
délai de quarante jours et délia les habitants de Saint-Gilles du serment de
fidélité que le comte leur avait extorqué. Alphonse-Jourdain n'en persévéra pas
moins dans son attitude hostile ; il osa même incarcérer l'abbé Hugues qui
revenait de Cluny. Cette fois il fut excommunié par Calixte II (22 avril 1122).
Alphonse-Jourdain résista quelque
temps encore, puis en 1123 ou 1124, il se décida à faire sa soumission. Une ère
de calme et de prospérité commença aussitôt pour le monastère et elle dura
jusqu'à la fin du XIIe siècle. L'abbaye de Saint-Gilles est alors à l'apogée de
son histoire ; la ville qui s'est créée auprès d'elle se groupe autour de neuf
paroisses dont les églises ont malheureusement disparu par la suite ; le port
où viennent s'embarquer les pèlerins pour la Terre sainte et où affluent les
marchandises venues d'Orient, est un des plus actifs de la Méditerranée
occidentale. C'est à peine si de temps en temps, comme en 1179, des embarras
financiers viennent troubler la quiétude des moines. Avec le XIIIe siècle et
l'extension de l'hérésie albigeoise, à laquelle adhèrent les comtes de
Toulouse, commencé au contraire une période de crise qui sera la première étape
vers la décadence.
Au XIIe siècle, Saint-Gilles avait
déjà subi le contact de l'hérésie. Pierre de Bruis y avait été brûlé en 1143
pour avoir répandu des théories subversives sur l'Eucharistie, plus encore pour
avoir incité ses disciples à briser les croix. Les doctrines albigeoises
provoquèrent des troubles plus graves encore dans les consciences, d'autant
plus qu'elles étaient ouvertement protégées par le comte de Toulouse, Raymond
VI.
Conformément à la tradition de ses
prédécesseurs, Raymond VI, dès le lendemain de son avènement (1194), avait
persécuté les moines de Saint-Gilles. Pourtant, grâce à l'habileté d'Innocent
III, la paix, quoique troublée par moments, fut à peu près maintenue jusqu'en
1207, date à laquelle l'anathème fut lancé contre le comte en raison de la
protection qu'il accordait aux hérétiques. Le légat Pierre de Castelnau fut
chargé de l'exécution de la sentence. Or,
le15 janvier 1208, tandis qu'il quittait Saint-Gilles où Raymond VI
l'avait mandé pour essayer de l'apaiser par de fallacieuses promesses, il fut
assassiné par un écuyer du comte. Son corps fut ramené à Saint-Gilles et déposé
dans la crypte de l'église après de solennelles funérailles.
Dans quelle mesure Raymond VI
était-il complice de cet attentat ? Il est impossible de le déterminer avec
exactitude. Le meurtrier était un familier du comte et il a sans doute cherché
à lui être agréable en supprimant un de ses ennemis. Quoi qu'il en soit,
Innocent III renouvela la sentence d'excommunication qui atteignait Raymond VI
et, comme celui-ci manifestait l'intention de se soumettre, il mit à sa
réconciliation de très dures conditions. Elles furent toutes acceptées et telle
fut l'origine de la scène dramatique, narrée par Pierre des Vaux de Cernay,
dont l'abbaye de Saint-Gilles fut le théâtre le 12 juin 1209.
Ce jour-là, raconte le chroniqueur,
le comte de Toulouse se présenta nu à la porte de l'église et, en présence des
reliques que l'on avait apportées, jura obéissance au pape et à ses légats. Le
légat Milon lui donna alors l'absolution, puis, lui passant l'étole au cou, il
l'attira vers l'église en le frappant de verges. Une telle foule se précipita
dans la basilique que Raymond ne put en sortir par où il était entré et qu'il
lui fallut descendre dans la crypte où il passa « nu et flagellé » près du tombeau de Pierre de Castelnau dont la
dépouille mortelle reposait auprès des reliques insignes de saint Gilles.
La paix ne fut complètement rétablie
à Saint-Gilles qu'après la croisade des Albigeois. L'abbaye, qui s'était en
1226 soumise au roi de France, connut sous le règne de saint Louis une nouvelle
période de prospérité, analogue à celle qui avait marqué le milieu du XIIe
siècle. Pourtant, certains symptômes annoncent une décadence prochaine. Tout
d'abord, les embarras financiers, qui s'étaient déjà fait sentir pendant la
période précédente, vont en s'aggravant au point que l'on n'aura pas les
ressources suffisantes pour terminer l'église abbatiale ; au XVe siècle on
aboutira à une ruine complète.
Le monastère, transformé en
collégiale en 1538 par le pape Paul III, devait connaître au cours des temps
modernes d'autres, épreuves dont l'église abbatiale eut spécialement à
souffrir.
Les luttes religieuses du XVIe siècle
ont eu leur contrecoup à Saint-Gilles. Le 27 septembre 1562, une armée de
catholiques provençaux, qui allait renforcer celle du vicomte de Joyeuse alors
occupée à reprendre Montpellier, fut surprise par les protestants à
Saint-Gilles et jetée dans le Rhône. A la suite de cette bataille, le monastère
fut incendié avec sa bibliothèque et ses archives. De nouveaux combats se
produisirent en 1574 ; à cette date Saint-Gilles subit une attaque furieuse des
réformés, conduits par Damville, qui réussirent un moment à pénétrer dans la
place mais ne purent s'y maintenir. La ville fut reprise, peu de temps après,
par le duc d'Uzès. Cependant, elle finit par rester au pouvoir des protestants
qui l'occupèrent jusqu'en 1622. L'arrivée des troupes royales en Languedoc mit
fin à leur domination. Depuis cette époque la vieille cité a vécu paisiblement
auprès de son église abbatiale bien mutilée, mais qui, avec la maison romane
où, suivant la tradition, naquit Guy Foulque, (Gui Fulcodi) le futur pape Clément IV, reste le seul vestige du
passé. |
Extrait des ANNUAIRES DU GARD
SAINT-GILLES
Historique de la commune
Saint-Gilles a une origine très
ancienne. La situation de cette colline sur les bords d'une branche du Rhône la
désignait naturellement pour être un comptoir des marchands phéniciens. Plus
tard, elle devint une des colonies de la ville grecque de Marseille et s'appela
Port d'Hercule. Au Moyen-âge, elle garda d'abord son ancien nom Héraclée et
prit ensuite le nom du saint fondateur de sa célèbre abbaye. Elle avait par
privilège le droit de commercer librement avec toutes les nations étrangères.
De toute cette ancienne splendeur, elle a gardé son église, un des plus beaux
spécimens de l'architecture romane dans le Midi de la France, et quelques
antiques intéressants, notamment le célèbre escalier dit vis de Saint-Gilles et
une curieuse maison du XIVe siècle. L'église est double ; une vaste crypte
occupe toute la surface souterraine de la nef et forme une église supposée à
l'édifice superficiel. Cette crypte n'avait jamais complètement disparu, mais
avait été rétrécie par des apports successifs de matériaux et de décombres. En
1865, elle fut déblayée et restituée par les soins de M. Révoil. Au cours de
ces travaux, on découvrit le tombeau de Saint-Gilles et d'intéressantes
inscriptions. La vaste étendue de cette église souterraine, les énormes piliers
qui supportent ses voûtes massives sont d'un grand effet.
Les
fondements ont été jetés en 1116 ; la construction en fut sans doute très
lente, comme celle de tous les édifices religieux de l'époque. Ainsi
s'expliquent les différences d'exécution que l'on remarquera dans les voûtes
elles sont, toutes du même système, dit voûte d'arête ; mais les unes sont
merveilleusement appareillées, tandis que d'autres offrent certaines gaucheries
d'exécution. L'église supérieure a été presque entièrement détruite pendant les
guerres de religions. Mais il en reste la façade et surtout un merveilleux
porche, une des gloires de la sculpture méridionale française. Le dessin en
reproduit les lignes générales ; il ne peut montrer la fécondité et la variété
de motifs sculpturaux qui encadrent les trois portes, ornent les tympans et
remplissent toutes les parties des voussoirs. Les grandes figures du portail représentent
les douze Apôtres ; le soubassement est orné de lions de peu de saillie de
relief, mais de bonne exécution d'art très -vivant; le tympan porte un Christ
du type en majestés, nimbé d'une gloire.
La date de
ce splendide morceau de sculpture remonte aux premières années du XIIIe siège.
On y a relevé l'influence de l'école lombarde et des artistes italiens. Elle
est indéniable, mais non complète.
C'est une
école originale et d'une inspiration très personnelle qui a taillé ces pierres.
La profusion des ornements est telle qu'on saisit ici au début la plupart des
motifs et sujets que les artistes de l'école provençale développeront
ultérieurement sur les monuments de la région. Moins solennel et plus divers
que Saint-Trophime, le porche de Saint-Gilles est plus original et plus
précieux au point de vue de l'histoire de l'art. Il est plus vivant ; le ciseau
des imagiers y fut plus souple ; leur imagination plus féconde. À gauche de
l'église, on remarquera les quelques débris de l'ancien cloître et des sculptures
qui l'ornèrent.
SAINT-GILLES
Démographie, liste des maires
Évolution de
la population
: 1793, 5000h ; 1800, 5047h ; 1806, 5212h ; 1821,
5600h ; 1831, 5561h ; 1836, 5797h ; 1841, 5635h ; 1846,
5832h ; 1851, 5985h ; 1856, 6132h ; 1861, 6365h ; 1866,
6804h ; 1872, 6211h ; 1876, 6302h ; 1881, 5268h ; 1886,
5503h ; 1891, 5947h ; 1896, 6110h ; 1901, 6381h ; 1906,
6300h ; 1911, 6258h ; 1921, 5924h ; 1926, 5613h ; 1931,
5833h ; 1936, 5325h ; 1946, 5335h ; 1954, 5789h ; 1962,
6714h ; 1968, 8732h ; 1975, 8679h ; 1990, 11304h ; 1999,
11626h ; 2006, 13234h ; 2010, 13564.
Les maires de St-Gilles
après la révolution (liste affichée à la Mairie)
: Mazer Henri, fév1790/août 1790 ; Duverner Bernardin, août1780/jan1792 ; Baron Jean-Jacques, jan1792/déc1792 ; Gautier Jean, déc1795/mai1795 ; Mazer Henri, oct1793/oct1794 ; Senilhac Pierre, oct1794/mai1795 ; Gautier Jean, mai1795/nov1795 ; Pelautier Pierre, nov1795/juin1796 ; Senilhac Louis, juin1796/août1797 ; Meirieu Pierre, août1797/déc1797 ; Serrier Jean-Antoine-François,
déc1797/mars1799 ; Sénilhac Louis,
mars1799/avril1800 ; Serrier
Jean-Antoine-François, avril1800/août1806 ;
Baron de Calvière Edouard-Nicolas,
août1806/mai1815 ; Perouse Jean-François,
mai1815/juil1815 ; Dugas Pierre,
juil1815/juin1819 ; Mazer Hector,
juin1819/juil1820 ; Constant Raymond,
juil1820/oct1823 ; Baron de Rivière
Louis, oct1823/août1830 ; Nourrit
François, août1830/déc1830 ; Durand
Jean-Jh-Catherine, déc1830/jan1832 ; de
Beaulieu Athanase, jan1832/juin1832 ; Durand
Jean-Jh-Catherine, juin1832/oct1840 ; Jalaguier
Pierre-Claude, oct1840/fév1844 ; Perouse
Jacques-Philippe, fév1844/jan1855 ; Dugas
Pierre-Hr-Jh-Prosper, jan1855/fév1867 ; Hitier André, fév1867/oct1870 ; Soulier Auguste-Adrien, oct1870/nov1870 ; de Plauchut Amédée, nov1870/mai1871 ; Hitier André, mai1871/fév1872 ; Gautier Pierre, fév1872/sep1879 ; Bessière L.-Marie-Auguste, sep1879/mai1880 ; Aptel Emile-Bienvenu, mai1880/déc1880 ; Badin Joseph,
déc1880/fév1881 ; Marignan Jean-Eugène,
fév1881/nov1884 ; de Lapierre
E.-J.-A.-Louis, nov1884/mai1885 ; Brouquier
Antoine, mai1885/juin1885 ; Quet
Léon Maurice, juil1885/sep1885 ; Blanc
Jean-Ernest, sep1885/nov1887 ; Clavel Antoine, nov1887/mai1888 ; Peyron Jacques-Louis, mai1888/déc1917 ;
Vigne Jean, déc1917/déc1919 ; Griffeuille François, déc1919/mars1929
; Vigne Jean, mars1929/mai1929 ; Roussel Louis, mai1929/mai1929 ; Renouard Michel-Pierre, déc1930/jan1931
; Girard Alexandre, jan1931/oct1944
; Clauzel Jean, oct1944/mai1945 ; Bourelly Louis, mai1945/juil1945 ; Grezoux Pierre Henry, juil1945/mai1953
; Brun Jean-Auguste,
mai1953/mars1959 ; Girard Alexandre,
mars1959/mars1965 ; Delord Franc,
mars1965/mars1971 ; Faure Rémy,
mars1971/mars1977 ; Girard Louis,
mars1977/mars1989 ; De Chambrun Charles,
mars1989/juil1992 ; Gronchi Roland,
juil1992/mars2008 ; Lapierre Olivier,
mars2008/oct2010 ; Gaido Alain
oct2010, en cours.
Annuaire du Gard, situation
Saint-Gilles en 1923
SAINT-GILLES-DU-GARD, patrie
du Pape Clément IV.
- A 9 kilomètres de la
Préfecture. - 5899 habitants - Poste, télégraphe, téléphone - Gare de Lunel à
Arles et de Saint-Gilles à Nîmes, par Bouillargues (station) - Superficie : 15
364 hectares, 71 ares, 1 centiare - Produits : Vins renommés, 174000
hectolitres, 'fourrages, Céréales, Bestiaux - Fête : 1er septembre - Foires : ler
septembre et 30 et 31 octobre - Halles, Abattoir.
Caisse d'Epargne :
Gueiraud, sous-caissier.
Maire : Griffeuille
F.
Adjoints : Vigne,
Brun.
Conseillers : Roman,
Boucaud, Allègre, Vigne P, Sève, Coutas, Duport, Drivon, Dourieu, Signouret,
Bruguier M., Rieu, Roubaud, Ménassieu, Moine.
Secrétaires de la Mairie : Gueirard, Favier, Roman.
Receveur Municipal :
Estrata.
Percepteur : Bosc.
Receveurs buralistes
: Dupuy, Castanet.
Instituteurs :
Perrier, René, Delaigue, Furic, Ollivel.
Institutrices :
Perrier, Mazaudier, Delaigue, Raoux, Coste, Méjean.
Appariteur : Bégout.
Gardes champêtres :
Derbès, Bas, Jorri, Coutas.
Juge de paix :
Jouve.
Brigadier de Gendarmerie : Lematte.
Commissaire de police
: Jouves.
Notaire :
Dupont-Lange.
Receveur des P.T.T.
: Rance.
Facteurs : Mourier,
Bertandon. Noël, Douard.
Passage du Facteur à
1 heures.
Chef de Gare :
Finiels.
Docteurs : Clauzel,
Héraud, Salles.
Vétérinaires :
Renouard, Crouzet.
Pharmaciens :
Allègre, Mazards.
Sages.Femmes : Mmes
Défaud, Vally.
Curé : Bouisson.
Pasteur : Radriguez.
Cantonniers :
Mathieu, Alizon, Benoit, Gautier, Moras, Guillaume.
Affenages : Bas,
Albert Victorin.
Assurances : Arnaud,
Meirieu, Rougeron.
Bazars : Gautier,
Durand, Rhoc.
Bois de Construction
: Michel, Gentils.
Bois et charbons :
Charrasse, Broye
Bouchers et charcutiers
: Amar, Soulier, Vve Touzelier, Tousten, Guillaumenq, Brun.
Boulangers :
Dourieu, Riboulet, Thélène, Granot.
Bourreliers :
Maupin, Thélène, Portal.
Cafés : Berthet,
Hérad, Lauret, Boyer, Thélène, Théral, Ferrenq, Seignour.
Chapelier : Boucaud.
Charrons : Couston,
Bonnefoy, Nier, Muratare.
Chaudronnier : Rhoc.
Chaussures : Gachon,
Bovetto.
Chaux et Ciments :
Richaud.
Coiffeurs : Pradier,
Brun, Lesur, Linsolas, Pedro, Liauson.
Cordonniers :
Gachon, Sivaly, Clavel.
Courtiers en vins :
Arnaud-Veyret, Bourgès, Chagnolleau, Chaumette, Rougeron, Sève, Brun.
Couturières :
Lasalle, Renard, Lombard.
Cuves en ciment :
R. Furrer, rue Racine à Nimes.
Cycles : Moïse,
Briatte, Pau, Richaud.
Distillateurs :
Benoit, Bernard, Jozan, Rocquelain.
Electricité :
Guttin.
Engrais : Aube.
Entrepreneurs de Travaux publics : Bégout, Riboulet, Girard, Allègre.
Epiciers : Vve
Riboulet, Ruche du Midi, Reynès, Barbusse, Mieille, Roque, Dentaud, Vve Renard.
Ferblantiers :
Gachon, Paret, Parrazines.
Fourrages :
Poueysègu, Bertrand.
Fruits-Primeurs :
Rosello, Bellivier, Duplissy, Meiffre.
Garage : Blanc.
Horlogers : Caron,
Baral Couffignac.
Hôtels : Carel,
Poitevin, Cauquil, Ceri.
Huiles : Bertrand,
Vigne, Renouard.
Jardiniers :
Meiffre, Langlois, Maubernard.
Journaux : Lèbre,
Durand, Nègre.
Laitiers : Vidal,
Granier, Pascal, Bonnaud.
Librairie : Lèbre.
Maçons : Girard,
Pagès, Blanc, Allègre, Bertrand.
Maréchaux-Ferrants :
Bonnefoy, Coste, Sévénéry.
Mécaniciens :
Guttin, Boudet,
Menuisiers :
Paparin, Roque, Perruchon, Vallat.
Merciers : Rhoc,
Gautier, Lavergne.
Modes : Lasalle,
Renard.
Moulins à huiles :
Soulier, Dreux, Brézé.
Pâtissiers :
Sassenosck, Ricard.
Peintres : Aube,
Bertrand.
Quincaillers :
Honoré, Sève, Germain, Bonnefoy.
Produits œnologiques, engrais : Boucaud Léon, St-Gilles (représentant
de la Littorale).
Représentants :
Arnaud, Veyrat, Linsolas, Brun, Chagnolleau, Chaumette, Poueysègu, Sève,
Rongeron.
Serruriers : Blanc,
Couston, Sanctus.
Tabacs : Valat,
Bourgès, Durand, Dupuy, Linsolas.
Tartres et lies :
Delaye, Pradel, Rongeron, Ranquet.
Tonneliers :
Almairac, Boisset, Arnaud.
Vins (commissionnaires en) : Roux et Cie,
Clavel, Ferrand, Guichard, Etablissements Brunet.
Situation en 1955
ST-GILLES -
Chef-lieu de Canton - Arrondissement : St-Gilles
SAINT-GILLES. (Gard). - Patrie du Pape
Clément IV. - A 19 kilomètres de la Préfecture. - 5789 habitants. - Poste,
téléphone, télégraphe, Gare de Lunel à Arles et de Saint-Gilles à Nîmes, par
Bouillargues (station). - Superficie : 15 364 hectares, 71 ares, 1 centiare. -
Produits : Vins renommés, fourrages, céréales, bestiaux, importantes
distilleries, riz.
Fête : 1er Septembre.
Foires : 1er Septembre et 30 et 31 octobre.
Curiosités : Eglise (monument historique). Vis, maison
romane.
Marché aux olives du 1er Octobre au 31 janvier.
Halles,
Abattoir, Marché : dimanches
et jeudis.
Caisse
d'Epargne.
Maire : Brun Jean.
Adjoints : Vaquette Louis et Chauvet Emile.
Instituteurs : M. et Mme Delord, Mr. et Mme Roque,
Michel, Mr. Mme Mazard Duplissy.
Institutrices
: Allier. Gentils,
Bellivier, Laget, Lagrange, Forestier et Gachon, Mme Plantier, Babilée,
Soulier, Mlles Cazaly, Polge, Noyer, Mmes Raze, Goufard.
Instituteur
libre : Bertrand Gaston.
Curé : Diet.
Docteurs : Clauzel Maurice, Salle Fernand, Clauzel
Jean. Salles Raoul.
Dentistes : Sanche André, Desangle Auguste.
Pharmaciens : Bourry C, rue Porte-des Maréchaux.
Clauzel, 1 rue Hôtel-de-Ville,
Vétérinaire : Crouzet P.
Sage-femme : Mme Montel.
Percepteur : Fanton.
Receveur-buraliste : Baumet.
Notaire : Bordarier.
Cinémas: Fémina, Variétés-Cinéma,
Agriculteurs
principaux : Bessières.,
Clavel, Crouzet, Maroger de Rouville, Bégout, Rabinel, Laugier, Bousquet,
Sabatier d'Epeyran, Meynier de Salinelles, Vernette, Teulon Muzard, Dugas,
Raoux, Corinto, Alcay. Aurillion, Bilhau, Boschi, Bourguet, Brunel Louis,
Cavalier, Brunel Auguste. Brunel Pierre, Champlin Raynaud Rabinel Colomb de
Daunant, Collin, Crouzet Dardé, Delon, Dourira, Emanuel P. Fabre, de Gastine,
Girard Alexandre, V. Guiot, Guibaud, Vve Julien, Layrisse et Clément, Martin,
Michel Jh., Pallier, Pattus, Penchinat, Poirier, Société Civile Sté Civile de
Barjac, Sté de Cavalès, Sté de la Margue Sté industrielle des Pradeaux, Sté
Prouvençol, Société du Mas Sénilhac.
Principaux
maraîchers : Vve Duplissy,
Gras. Sauzet, Massuco, Langlois, Gravier, Foulquié, Barbenson.
Agence
immobilière : Durand Grand
Rue, Bruny Robert Rue Sady-Carnot.
Alcools
en gros : Vve Riboulet.
Alimentations : Balazut A., Papillon.
Armuriers : Moïse, Flandin Emile 6 place Gambetta.
Articles
Funéraires : Emeric,
Pradille, Taulelle.
Assurances : La Providence, Poirier Bertaud, Arnaud,
Biau, P. Bégout, La Nationale, Bourgès Henri, agent Lesur (La Paternelle) ;
Riboulet, Clairion fils, Daumas, l'Urbaine et la Seine.
Autos
réparations : Antheaume
Thélène, M. Basset, E. Crunière, Garabédian Autocars : Sciou, Benoit,
Banques : Société Générale ; Société Marseillaise du
Crédit ; Crédit Lyonnais ; Banque Boissier.
Bars : Français, du Canal, de la Bascule, de la
Gare, du XXe Siècle, Bar Américain gérant (Maudit), Bar des Amis.
Bazars : Rhoc, Pradille, Mme Chauvidan, Allègre.
Bière (entrepôt) : Prone et Taliani.
Bijoutiers : Baral, Tempier Maurice.
Blanchisserie : André J., 3, rue des Templiers.
Bois
et Charpentes : Gentils,
Michel.
Bouchers : Tousten Jean, Tousten Marius, Moulet,
Amard Jean 26 rue Emile-Zola, Mme Veyrié, Amar Marius rue Porte des Maréchaux
Boucherie
chevaline : Lapize.
Boulangers : Thélène, Dourieu, Mulet André, Lautier,
Bourrély Maurice, Valette R. Ravel Roger 7, rue République, Sabatier, Ross R.
Bourreliers : Maupin rue Gambetta, Pezet et Beaulieu.
Cafés
: du Théâtre (Villepinte) ;
de la Gare (Berc), des Arts ; Français ; du Midi ; du Cours ; du Canal ; du
Centre ; des Amis; des Alliés ; du Gard (Michel) ; De l'Avenue (Robert L. A.,
propr.), de la Poste (Girard, propr.) ; Bar Américain.
Cafés-Restaurants : du Cours ; du Louvre ; Prats A. ; du Lion
d'Or ; Claux ; du Centre ; de la Gare.
Charbons : Lebret, Pantel, Landi.
Charcutiers : Guilhaumenq, Bosq.
Charrons-Forgerons : Couston, Bonnefoy L., Bonnefoy J., Coste
P., Gonfiantini, Sarlin, Pouget F.
Chaudonneries
: Robert, Pichi.
Chaussures : Bovetto, Gachon, Sigounios Giovannini, 2,
place de la République, Chauvet, 43, rue Gambetta.
Chaux : Vve Blanc, Faisse, Mlle Fourmand.
Coiffeurs : Lesur, Gaussen, Simon Rouffiac, Favaud,
Gorlier.
Coiffeurs
pour Dames : Mme Portal,
Gaussens, Lesur, Mme Borel. Mme Lamy.
Compositeur
de Musique : Daniel Oranger,
rue Porte des Maréchaux,
Commissionnaires
en vins : Ferrand, Sté
Herman Bousquet.
Confections : Christol-Sérane, Coutas. Pradille.
Confiseur
: Durand L.
Confiseur
d'olives : Contas 32 rue A.
France.
Constructeur-Mécanicien : Antheaume
Coopérative: Cave Coopérative Les Vignerons St-Gillois.
Cordonniers : Clavel. Vernet, Giovannini.
Courtiers : Almeirac, Praliaud L, Leron, Chagnolleau.
Renouart, Blanc.
Courtiers
en fourrage : Brun,
Poueységu, Cerri Massebiau, Mathieu.
Courtier
en propriétés : Levandoski.
Couturières : Mlles Renard, Lassale, Fabre, Lombard,
Mmes Blanc, Manencq, Pallesi, Criquet.
Cycles
et accessoires : Moise 18
rue Gambetta ; Flandin E., 6. place Gambetta ; Rossi rue Sadi Carnot.
Distillateurs
: André et Lesur, Antoine et
Brunel, Renouard, Lesur, Bros et Borne, Sté Alcor.
Drogueries : Brante, Bouchet, Favier Lucien.
Edredons : Bieau-Faucher.
Electriciens : Allègre, Tournaire, Breysse A.
Engrais : Linsolas, Portier. Dourieu, Bouchet,
Riboulet-Estrata.
Entreprise
de battage : Des Portes G.,
25, boul. de Chanzy.
Entrepreneurs de maçonnerie : Linsolas
Praliaud, Teissonnier, Drivon, Veuleuzuela, Valadier, Ravel, Girard, Broye,
Adami, Gamalie A, Fau François,
Sébastianis (Vve)
Epiciers :
Veuve Roque, Ruche du Midi, Abeille, Economat du Centre, Renard, Bieau,
Papillon, Charasse 15 rue Gambetta, Docks Méridionaux, Falque, Vignaud, Vve
Roma, Bani, Dumas, V Reynas, V. Estable, Michel, bd Gambetta, Barbusse,
Armentier-Dentaud Corsini, Guidi, Meirargue, Salvadorini 11 rue Hoche, Benoit
17 Gd Rue, Pélissier Albert 29 rue des Maréchaux.
Ferblantiers : Parret, Chabanis.
Fruits
et primeurs : Michel, Marcel,
Villalonga, Praliaud, Barthélémy 25, Grand'Rue.
Foudriers : Roger Ph. E.
Fourrages (Nég.) : Palési, Sté Roseaux de Languedoc et
Provence.
Garages : Thélène, de la Poste Antheaume, de
Provence, Balazut, Crumière Garabédian, de Camargue 15 rue Berthelot.
Grains
et Fourrages : Poueységu,
Teissonnier, Riboulet, Pagès, Dourieu, Cerri, Grani.
Horlogers : Barral E 1 Gd'Rue, Tempier M., Bosco M. 38
rue Gambetta.
Hôtels
: Marc Berg (Le Globe)
avenue de la Gare ; Claux (Le Centre).
Huiles : Vve Maurel, 6 rue du Château.
Jardiniers : Langlois, Gravier, 'Minaud, Barbenson,
Meynier, Foulquié, Ségura, Raoux, Vve Duplissy, Gras, Sauzet.
Journaux (dépositaires de): André, Durand, Brunel.
Libraires
papeteries : Mme Chauvidan,
Vve Almairac, Durand.
Liquoriste : Berg M.
Maçons : Bieau, Broye, Ségura, Blanc, Valenzuela
Grand'Rue, Valadica.
Maréchaux-ferrants : Coste, Bonnefoy, Méliani, Pouget.
Matériaux
de construction : Faysse
Jeanne, Fourmaud Berthe.
Mécaniciens : Antheaume, Balazut, Bertaudon, Crumière
E., Guyot C., Richaud, Dinholl.
Menuisiers : Perruchon L., Saget, Vallat, Nouet, Rhoc,
Olivier, Peruchon, Gilles.
Merceries : Rhoc L., Chauvidan, Mme Vve André, Mme
Bertrand-Girard, Blanc, Maison Universelle, Vignaud.
Pâtissier : Serret.
Peintres : Aube J., Teissonnier, Favier, Barthés J.,
Bertaudon J.
Photographes : Lesur, Violet.
Photographie (fourn. p.) : Clauzel, Viallat 1 rue
Hôtel-de-Ville, Violet rue Gambetta.
Plâtriers : Barthez, Favier.
Plombier-zingueur : Picchi R.
Poissonniers : Arnaud, Vve Hermet, Soubeiran, Meirieu,
Soullier.
Primeurs : Isoird, Villalongua, Marcel.
Professeur
de Musique : Daniel Oranger.
Produits
agricoles : Bouchets,
Linsolas.
Quincailliers : Honoré Louis, Taulelle R. 27 rue Gambetta,
Piechi R. 13 rue Gambetta, Emeric.
Représentant
: Crumière E. rue Gambetta,
Bruny M. 1 rue Sadi Carnot.
Restaurants : du Lion d'Or (Prats Casenave,
propriétaire), du Centre (Th. Claux propriétaire), du Louvre (Méliani,
propriétaire), du Cours avenue de la Gare.
Scieries
: Michel, Gentils.
Serruriers : Michel, Blanc, Bertrandon.
Sondage-Soudure
autogène : Robert.
Tabacs : Brunet place Gambetta, André rue Gambetta,
Mongrin, Vve Bourgés.
Tailleur : Seveyrac 12 rue République.
Tartres
et lies : Leron, Duport,
Renouard.
Teinturiers
: Bertrand-Girard, rue
Porte-des-Maréchaux, Bertaud-Estrivier.
Tissus
nouveautés : Bertaud, rue de
l'Etoile, Pradille-Coutas, Raynaud rue Gambetta, Vve André, rue Gambetta. « Au
Coin de la Rue ».
Tonneliers : Massebiau, Renon.
Transports : Raymond Louis, Vozza, Pantel, Praliaud,
Cerré Louis, Guyot C., Pallesi, Mme, Sciou, Henri Mialoux Ch.4 rue Neuve.
Travaux
funéraires : Pages A.,
Allègre A., Amphoux.
T.S.F : Flandin Emile 6 place Gambetta, Moyse rue
Gambetta.
Tuyaux
en ciment : Vve Di Vita,
Accornero.
Vins (gros) : Bousquet, quai du Canal ; Sté
Hermann, Ferrand, Laugel-Lanternier, André et Lesur.
Vins
et liqueurs : Durand place
de l'église.
Volailles (marchands de) : Soubeyran, Papillon,
Pallesi F.
Wagons
foudres : Ph. E. Roger.
Châteaux : d'Espéran, Loubes, Pérouse, Lamothe. | GRANDE ET PETITE HISTOIRE DE SAINT-GILLES (Gard)LE CHEMIN DE FER À SAINT-GILLES
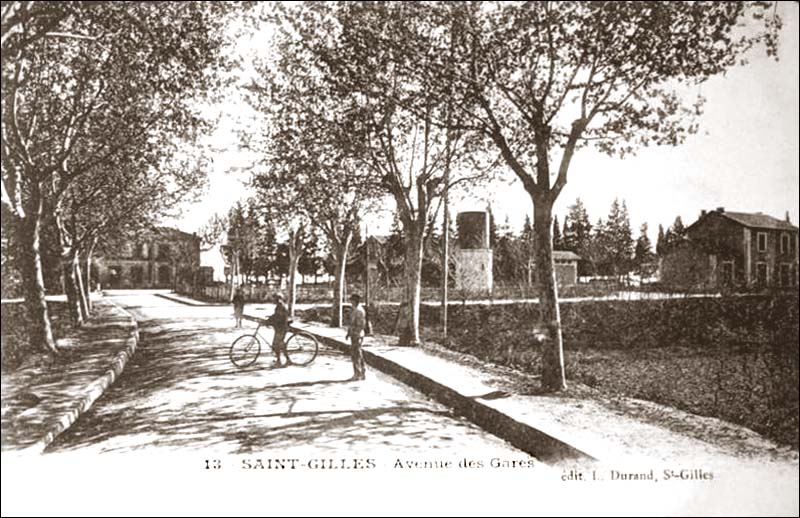
À gauche la gare PLM, à
droite la gare du CDF de la Camargue
LE CHEMIN DE FER PLM
La gare PLM de St Gilles
Indicateur de chemin de fer P.-L.-M. 1915
Ligne, Lunel, Arles :
Les gares : Lunel,
Marsillargues, Aimargues, Le Cailar, Gallician, Franquevaux, Saint-Gilles, La Furanne, Arles.
Gares de Saint-Gilles :
Direction Arles : 8h06
arrivée Arles 8h33 ; 20h53 arrivée Arles 21h30.
Direction Lunel : 6h43
arrivée Lunel 7h43 ; 19h01 arrivée Lunel 20h26.
C'est le 11 juin 1863 que
fut prise la décision, par la société PLM, de construire une ligne de chemin de
fer d'Arles à Lunel. Elle sera inaugurée le 27 janvier 1868. Le pont traversant
le Rhône entre Arles et Trinquetaille sera bombardé par l'aviation alliée en
août 1944. Seuls les 4 lions sculptés par Pierre-Louis Rouillard restent encore
pour marquer les deux piles du pont côté rive droite et rive gauche.
La ligne sera fermée aux
voyageurs en 1938. Après la destruction du pont, les marchandises à destination
d'Arles emprunteront la voie de Nîmes via le Cailar.
A Saint-Gilles, les deux
gares Camargue et PLM avaient un quai commun permettant de transférer les
marchandises d'une ligne à l'autre, les wagons n'ayant pas le même empattement,
métrique pour Camargue et en pouce pour le PLM (4 pieds 8 pouces et demi, soit
1m435).
LE CHEMIN DE FER DE LA CAMARGUE
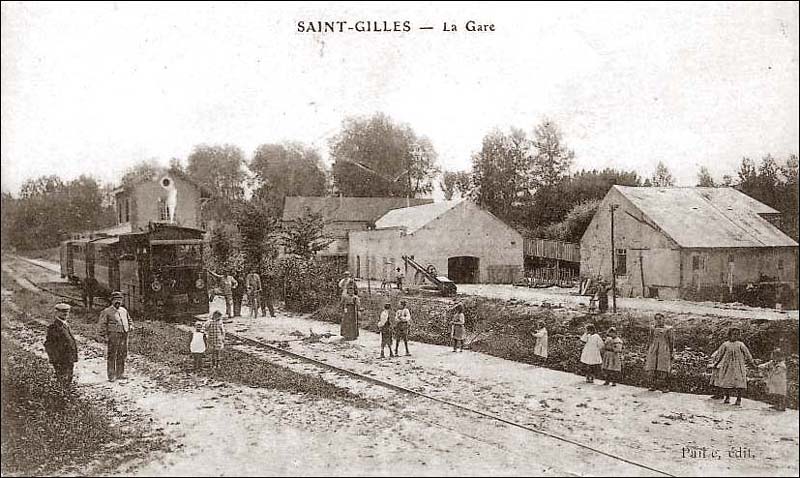 Gare de la Camargue à St Gilles Gare de la Camargue à St Gilles
La Société
anonyme des Chemins de Fer de la Camargue est fondée en 1889.
En 1892,
ouverture d’une ligne de 38 km à voies métriques, Arles-Trinquetaille à
Salin-de-Giraud. Avec pour gare de départ Arles-Trinquetaille cette ligne
desservait, Gageron, Villeneuve-Romieu, Le Sambuc, Salin de Giraud le terminus,
et vice-versa. Cette ligne à été initialement conçue pour le transport du sel.
La même
année ouverture de la ligne Arles-Trinquetaille aux Saintes-Maries-de-la-Mer,
38 km à voies métriques. Avec pour gare de départ Arles-Trinquetaille cette
ligne desservait, Albaron, Maguelone-le-Sauveur, les Saintes-Maries-de-la-Mer
le terminus, et vice-versa.
En 1901,
ouverture de la ligne Nîmes à Arles-Trinquetaille, 33 km à voies métriques.
Avec pour gare de départ, Nîmes Camargue cette ligne desservait, Caissargues, Bouillargues, Bellegarde,
Fourques, Arles-Trinquetaille le terminus, et vice-versa.
Depuis la
gare de Bouillargues, une ligne de 16 km allant jusqu’à St-Gilles sera ouverte
l’année suivante, en 1902. Avec pour gare de départ Nîmes Camargue cette ligne
desservait Caissargues, Bouillargues, Garons, St-Gilles le terminus, et vice-versa.
C’est la
ligne Nîmes St-Gilles qui sera
électrifiée en premier en 1920, les lignes du Delta ne seront électrifiées
qu’en 1932. Le courant d’alimentation était du 6600v/25hz.
Fermetures
des lignes : Nîmes, St-Gilles
en 1950 ; Arles, les Saintes en 1954 et Arles, Salin-de-Giraud en 1957.
La gare de
Nîmes appelée " gare de la Camargue ", était située au sud
ouest de l’Avenue Jean-Jaurès sur l'emplacement de l’actuel Lycée Camargue.
Pour
faciliter la correspondance entre la ligne Camargue et la gare PLM, une voie
sera créée sur le Boulevard Sergent-Triaire avec un terminus sans bâtiment,
juste avant le pont du Boulevard Natoire.
Désaffectée
après 1950, elle servira de caserne des Sapeurs Pompiers de 1955 jusqu'à sa
démolition en 1957, date de la construction du Lycée Camargue.
-oOo-
Extrait de la délibération du Conseil Général du 19 avril 1939,
discussion tendue et colorée, au sujet de la fermeture le la ligne de la Camargue
M le Colonel Blanchard.
- Messieurs, nous venons rendre le rapport fait par notre excellent collègue
M. Député Béchard. Il est le Président de notre Commission des Travaux Publics
et des Routes, je fais moi-même partie de cette Commission, mais vous ne serez
pas étonnés du tout que je ne sois pas de la même opinion que notre sympathique
Président. M. Béchard avait, tout simplement, juré la mort de cette « charmante
vachette qui est la Compagnie de la Camargue. Mais la Cie de la Camargue a la
vie dure et il ne faut pas oublier que les taureaux ou les vaches camargues ne
sont pas espagnols. On ne les tue pas, on se contente de leur enlever leur
cocarde.
Lors
de la réunion de la Commission interdépartementale, j'aurais aimé à pouvoir
être appelé à donner mon avis à ce sujet, mais on m'a fait savoir que cela
n'était pas utile. Comme M. le Préfet est un homme fort courtois et qu'il a
pris toutes sortes de précautions pour me dire cela, je n'ai pas insisté ; mais
il doit se douter que la question m'intéresse toujours et qu'elle m'intéresse
d'autant plus que par le temps qui court, le maintien de la Compagnie de la
Camargue présente un grand intérêt pour la Défense nationale.
Je
suis d'avis que nous n'aurions pas du voter la suppression de la ligne de la
Camargue. D'ailleurs, elle n'est pas tout à fait morte et je crois qu'il faudra
la tuer une troisième fois.
M. le Président. -
N'oubliez pas qu'il s'agit d'un simple donné acte.
M. le Colonel Blanchard.
- Messieurs, tout conseiller général a le droit de parole. Maintenant, si vous
ne voulez pas que je parle, je m'inclinerai devant la force.
M. le Président. -
Il s'agit encore une fois d'en donner acte et vous revenez sur la question du
fond.
M. le Colonel Blanchard.
- Je vous ferai observer, M. le Président, que nous touchons la une question
fort importante : la question des événements extérieurs et de la possibilité
d'une guerre. Tous nous savons les services rendus en 1914-1918 à la Défense
nationale par cette ligne d'intérêt
local. Il me semble que puisque l'existence de la Compagnie de la Camargue
intéresse la Défense Nationale, le Préfet devrait intervenir.
M. le Préfet.
- Permettez-moi de vous dire que lorsque j'ai réuni, dans cette salle même, les
deux Comités Techniques interdépartementaux, l'autorité militaire était
représentée par des Officiers supérieurs et ils ne m'ont fait aucune
observation. Il est très probable également, que les Ministres de l'Air et de
la Guerre, me donnent leur avis. Croyez-moi, M. Blanchard, toutes ces considérations
n'ont pu échapper à l'Administration.
M. le Colonel Blanchard.
- Je ne me permets pas de dire qu'elles ont échappé à l'autorité militaire,
mais, moi aussi, j'ai été militaire dans le temps et alors je sais très bien
que devant les autorités civiles, les militaires n'ont le droit ni de discuter
ni de parler.
Moi,
je suis en vacances éternelles et cela vous explique, mon indépendance de
caractère et de langage.
Dans tous les cas, je tiens essentiellement à ce qu'on
songe aux employés de la Compagnie de la Camargue....
NDLR : Dans ce texte nous sommes
en 1939 le Colonel Blanchard évoque, à juste titre, une menace de guerre, cette
dernière sera déclarée le 3 septembre 1939 et durera jusqu'en 1945. Les
Allemands occupants le Sud de la France, jugeant ces infrastructures
stratégiques (tout comme le Colonel Blanchard, retraité et opposé au quarteron
d'officiers d'active), maintiendront en activité cette ligne, ainsi que celle
d'Arles à Lunel. Le pont sur le Rhône de la ligne Arles Lunel sera détruit par
les alliés en août 1944, il ne sera jamais reconstruit..
La
fermeture des lignes sera effective pour :
- Nîmes,
St-Gilles en 1950 ;
- Arles, les Saintes en 1954 ; - Arles, Salin-de-Giraud en 1957. La gare de Nîmes appelée
gare de la Camargue, située au sud ouest de l’Avenue Jean-Jaurès sur
l'emplacement de l’actuel Lycée Camargue sera désaffectée après 1950. Elle
servira de caserne des Sapeurs Pompiers de 1955 jusqu'à sa démolition en 1957,
date de la construction du Lycée Camargue.
> Texte intégral de la délibération du 19 avril 1939 .
|
Historique du canal d’Aigues-Mortes à Beaucaire
extrait
de "Talabot sa vie son œuvre",
par le Baron Ernouf, 1886
L'amélioration ou
plutôt la transformation du canal d'Aigues-Mortes à Beaucaire, conception
heureuse et originale, a été le grand événement de la jeunesse de Paulin
Talabot. Ce coup d'essai fut un coup de maître. Pour en faire comprendre tout
le mérite, il est nécessaire de rappeler au moins sommairement les antécédents
historiques de ce canal.
La région qu'il
traverse forme sur la rive gauche du petit Rhône une sorte de terrain neutre,
où les alluvions, l'eau salée et l'eau douce sont aux prises avec des succès
alternatifs. Malgré d'assez grands travaux de desséchement, cette contrée offre
encore, dans son ensemble, un aspect heureusement unique en France. Peuplée de
vaches et de taureaux sauvages, de chevaux errant en liberté, de reptiles
venimeux, de myriades d'insecte, elle offre au regard une vaste étendue
d'étangs, de marais, de lisières de sable et de landes humides, parsemés de
rares bouquets de pins.
Le premier projet
de desséchement de ces marais remonte à Henri IV ; la première idée du canal, à
l'année 1645. Mais ce fut seulement en 1780 que les États de Languedoc,
subrogés aux précédents concessionnaires, commencèrent ce grand ouvrage, en
creusant le lit du canal dans la section d'Aigues-Mortes à Saint-Gilles, sur un parcours d'environ 35 kilomètres, à travers
des marécages dont le niveau est à peine égal, et même souvent inférieur à
celui de la mer. Il avait bien fallu établir le canal en contrebas de ce
niveau ; aussi l'eau salée n'aurait pas manqué de refluer dans les terrains
adjacents, et d'y détruire tous les germes de végétation, si elle n'avait été
retenue par des chaussées insubmersibles.
Il y avait déjà
environ 3 millions de dépensés, somme considérable pour ce temps, quand la
Révolution arrêta ces travaux, comme tant d'autres ! Pendant la période
d'anarchie qui suivit, les chaussées furent rompues sur divers points, par
l'effort de la mer ou pour d'autres causes.
L'état déplorable
de la partie commencée de ce canal, et la nécessité de le terminer, fixèrent de
bonne heure l'attention du gouvernement consulaire. Une loi du 25 ventôse an XI
en prescrivit l'achèvement ; et, le 27 floréal suivant (17 mai 1803),
intervint entre le directeur général des ponts et chaussées et la Compagnie
Perrochel un traité par lequel celle-ci prenait à sa charge la réfection et
l'achèvement du canal de Beaucaire à Aigues-Mortes et de ses dépendances,
situées dans le département du Gard (canaux de la Radelle, de Sylvéréal et
Bourguidou), formant un développement total de 77 100 mètres, dont 50 400
pour le canal principal.
En retour,
indépendamment des droits de navigation, et de la jouissance, pendant
quatre-vingts ans, de tous les francs-bords (terrains laissés libres le long
des canaux), le gouvernement concédait à la Compagnie la propriété
incommutable et perpétuelle de tous les marais, étangs et palus situés dans le
département du Gard, entre Beaucaire, Aigues-Mortes et l'étang de Mauguio (1),
appartenant à l'État, et provenant de l'ancien domaine de l'Ordre de Malte, de
tous domaines nationaux, etc.
(1) Étang auquel vient
aboutir le canal de la Radelle, faisant suite au canal principal.
Par la
confiscation, procédé expéditif, sinon équitable, la Révolution avait coupé
court aux procès multipliés en revendication et en délimitation de propriété,
qui avaient retardé l'opération de deux siècles.
La dépense à faire
était évaluée à 2 500 000 fr, et le délai primitivement accordé par le cahier
des charges, pour leur achèvement, expirait le 12 septembre 1806.
La Compagnie
poursuivit avec une grande activité l'exécution du canal jusqu'à Beaucaire, et
les bateaux purent en effet y passer dès 1806. Mais il s'en fallait bien que
tout fût terminé. Les brèches faites pendant la Révolution ne purent être
totalement fermées que dans la dernière année de l'Empire. La disposition de
l'écluse de prise d'eau dans le Rhône, destinée à alimenter la partie
supérieure du canal, prit aussi bien plus de temps et d'argent qu'on ne l'avait
prévu. En définitive, on dépensa 16 millions au lieu de 2 et demi, et la
réception définitive n'eut lieu que le 29 septembre 1828.
A cette époque, les
biefs supérieurs du canal étaient alimentés exclusivement par les eaux dérivées
du Rhône, au moyen de l'écluse de prise d'eau ; de sorte qu'à l'époque de la
réception des travaux, le canal de Beaucaire était un canal d'eau salée
d'Aigues-Mortes à Saint-Gilles,
comme celui d'Aigues-Mortes à Sylvéréal creusé par Vauban ; et un canal d'eau
douce seulement depuis Saint-Gilles jusqu'à Beaucaire.
Il convient
d'ajouter que l'habile ingénieur Bouvier, prédécesseur de Paulin Talabot, avait
exécuté, dans l'intérêt de la Compagnie et des viticulteurs de la région
limitrophe, des travaux qui avaient amené dans les vastes marais de Saint-Gilles et de Vauvert, situés en
aval de la section d'eaux douces du canal, d'autres eaux douces dérivées du
petit Rhône, et dont l'action bienfaisante avait fait renaître la végétation
des plantes palustres, engrais indispensable pour la culture de la vigne, qui
déjà prenait un grand développement dans les alentours (1).
(1) Le Gard était devenu l'un de nos premiers départements
viticoles, avant l'invasion du phylloxera. La superficie des vignobles, qui atteignait
76 000 hectares en 1869, est réduite aujourd'hui à moins de 20 000.
Telle était la
situation quand Paulin. Talabot fut appelé à Nîmes pour remplacer, comme
ingénieur de la Compagnie, M. Bouvier qui rentrait dans le service public. Le
président du conseil d'administration était alors le maréchal Soult, duc de
Dalmatie, l'un des principaux actionnaires. Grâce à ses facultés éminentes, il
comprenait et dirigeait en quelque sorte d'instinct les grandes affaires
industrielles avec la même rectitude de jugement, la même sûreté de coup d'œil
que jadis la grande guerre. C'était lui qui avait choisi pour ingénieur
Talabot, dont il connaissait particulièrement la famille.
Ce fut aussi le
maréchal qui le mit en rapport avec M. Fargeon. Celui-ci venait de succéder à
son père dans la direction des affaires contentieuses de la Compagnie. Cette
première rencontre entre deux jeunes gens bien faits pour s'apprécier, fut le
point de départ d'une intime et constante amitié qui ne fit que s'accroître
avec l'âge. La mort elle-même n'a pas rompu ce lien; aujourd'hui encore le
souvenir de Talabot, l'espérance que tôt ou tard un juste hommage sera rendu à
sa mémoire, est une des grandes préoccupations de son ancien ami. (1)
(1) M. Fargeon ajoute dans ses notes que ses collègues du barreau de
Nîmes, dont plusieurs sont devenus justement célèbres, Boyer, Béchard,
Baragnon, de Sibert (depuis secrétaire
général au ministère de la justice), devinrent aussi et restèrent les
amis de Paulin Talabot et de son camarade Didion.
Voyant l'effet
salutaire produit par le travail de son prédécesseur, Paulin Talabot conçut le
projet d'opérer une amélioration plus radicale, en substituant l'eau douce à
l'eau salée dans la section d'Aigues-Mortes à Saint-Gilles, et dans le canal de
Sylvéréal. A cet effet, il établit près d'Aigues-Mortes une écluse (dite de
garde), à trois entrées et à cinq portes; ouvrage dont le mécanisme
ingénieux laisse un libre passage à l'écoulement des eaux provenant des deux
canaux, quand leur niveau est supérieur à celui de la mer; et, dans le cas
contraire, empêche celle-ci de pénétrer.
Cet ouvrage,
terminé en 1834, atteignit parfaitement son but. Les deux canaux, jusque-là
salés, sont depuis cette époque alimentés exclusivement par les eaux douces
dérivées du grand Rhône à Beaucaire, et du petit Rhône à Sylvéréal, au grand
profit des propriétés riveraines.
L'idée, comme on
voit, était bien simple; seulement il fallait l'avoir ! Ce premier succès fit
le plus grand honneur à Paulin Talabot, et lui valut une confiance que des
travaux ultérieurs, bien autrement considérables, devaient pleinement
justifier. |
GRANDE ET PETITE HISTOIRE DE SAINT-GILLES (Gard)
Le
Monument aux Morts de 1914-1918
1939-1945, Indochine et Algérie
 |
Monument réalisé en 1921 et inauguré le 24 juin 1921.
Architecte, Max Raphel (1863-1943)
Sculpteur, Bouchard Henri (1875-1960)
La sculpture
participa à Paris, au Salon de la Société des Artistes Français. C'est la
municipalité qui contacta l'architecte nîmois. La paire de colonne qui
surmontait l'édifice faisait hommage à la célèbre façade romane de l'abbatiale.
Source : Notice de Palissy, base en ligne du Ministère de la Culture. |
En 1925, une tempête renversa les deux colonnes et le
chapiteau. Jugé trop fragile cet ensemble ne sera jamais restauré, seule la
stèle sera conservée.
Documentation : Alain Choubard, les monuments aux morts sculptés en
France. |  |
Plaques fixées à l'arrière de la stèle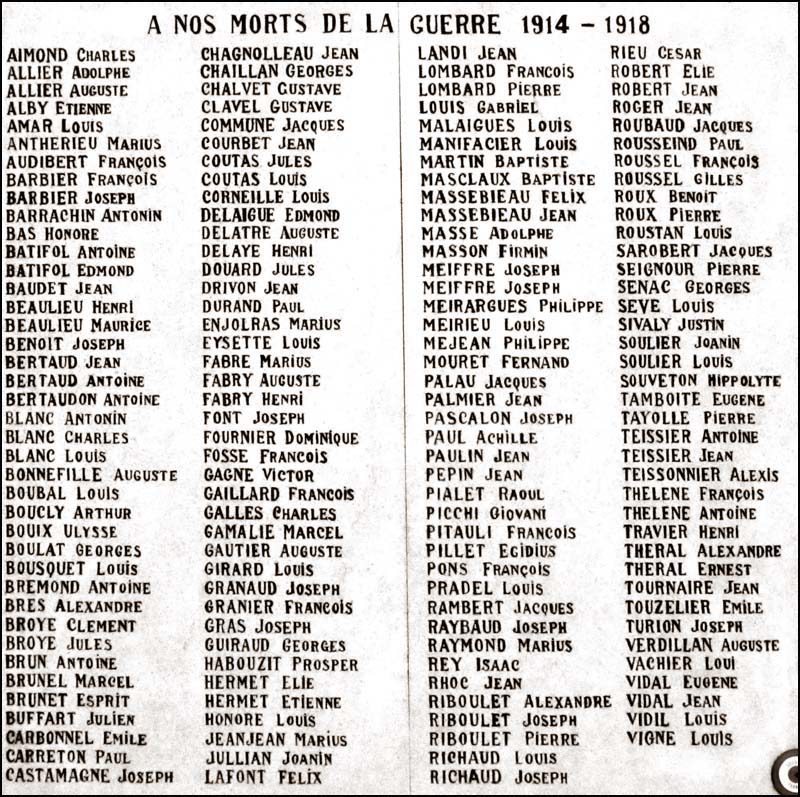 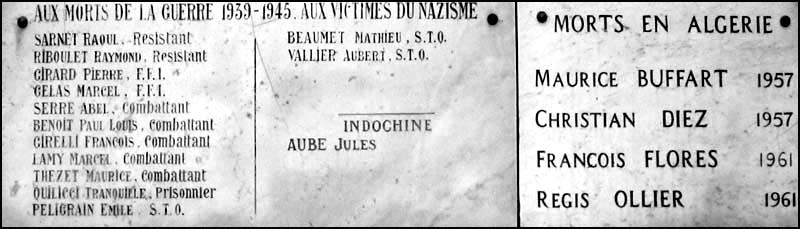
|
St GILLES
Une légende mise à nue
Entre 963 et
980, un moine, Turold, écrit "la
Geste Francor" que nous connaissons comme "la Chanson de Roland".
Cette légende apparaîtra à la fin du XXe siècle ou au début du onzième.
Avant
d'aborder l'histoire de saint Gilles, observons le texte : dans les versets où
il est question de saint Gilles n'apparaissent pas les lettres AOt. Comme ces
lettres marquent le prototype de l'épopée, conservé dans le texte original,
nous devons conclure logiquement que la légende de saint Gilles est née après
la Chanson de Roland et même contre cette épopée déjà célèbre alors.
Les plus
vieux manuscrits parlant de Saint Gilles nous sont parvenus du onzième siècle,
qu'en est-il dans le texte :
- Egidius,
Grec de naissance, serait né à Athènes. Un jour ou il se rendait à l'église, il
aurait, tel saint Martin, donné son manteau à un mendiant malade. Dès que ce
dernier eut jeté le manteau sur ses épaules, il aurait été guéri.
Egidius
distribua ses biens aux pauvres, obtint des guérisons miraculeuses et, comme la
foule se pressait vers lui, il s'en alla et atteignit ainsi la côte. Il sauva
une chaloupe prise dans la tempête. L'équipage était tout disposé, par
reconnaissance, à conduire Egide (Gilles) jusqu'à Marseille. Arrivé à bon port,
Gilles entendit citer le nom de Cesarius qui dirigeait l'église d'Arles. Il
alla vers lui et reçut l'hospitalité de la veuve Theocrita dont il guérit la
fille. Gilles resta deux ans près de Cesarius à Arles. Comme il préférait la
solitude, il quitta Arles en grand secret et parvint près du Gardon où il vécut
en compagnie de l'ermite Veredemius. Gilles partagea avec Veredemius, une
grotte d'un accès très difficile, mais que les malades parvinrent tout de même
à atteindre.
Pendant
l'absence de Veredemius on mena un malade jusqu'à Gilles, qui le guérit, Dans la
crainte d'avoir indisposé son maître, Gilles le quitta une fois encore et il
alla vivre près de l'embouchure du Rhône non loin d'une source.
Il y resta
trois ans, se nourrissant d'herbes sauvages et du lait d'une biche devenue la
compagne de sa solitude.
Au cours
d'une chasse, les chiens poursuivirent la biche, mais ils n'osèrent approcher
de la bête. A la tombée de la nuit, les chasseurs quittèrent le terrain pour y
revenir le lendemain. Ils découvrirent une nouvelle fois la biche, la
pourchassèrent et lui envoyèrent une flèche qui alla frapper Gilles, le
blessant gravement.
Le roi et
l'évêque de Nîmes approchèrent du vieillard en bure d'ermite. A leur demande,
Gilles leur raconta qui il était. Ils lui demandèrent pardon et revinrent
chargés de cadeaux que Gilles refusa. Comment sinon pouvaient-ils dédommager
Gilles? "En construisant une abbaye". - "Volontiers, dit le roi,
si vous acceptez d'en devenir vous-même l'abbé". Après mûre réflexion,
Gilles acquiesça.
Deux églises
furent érigées en ce lieu, l'une en l'honneur de saint Pierre, l'autre vouée à
saint Prisc. Gilles reçut en outre la terre autour des églises, dans un
périmètre de cinq milles. La renommée de Gilles parvint au roi des Francs, qui
le fit venir.
Ici la
légende se dédouble.
En Provence
on raconte que Gilles était né à Athènes en 640, qu'il s'établit près du Gardon
en 670 et qu'il serait mort aux alentours de 720, au temps de Charles le
Martel. Flavius et non pas Wamba aurait été alors roi des Goths. Ce ne serait
pas Charlemagne, mais Charles Martel qui aurait appelé Gilles à Orléans, où il
résidait en ce temps.
Le nord de
la France en tient pour Laon. La dispute entre troubadours et trouvères
continue, même en champ universitaire, alors que tout ceci n'est que pure
invention de clercs. Entre Laon et Orléans, l'Or est de trop...
Lu dans un
dépliant touristique, édité en 1981 : Egidius fut blessé d'une flèche du roi
Flavius Wamba. De quoi concilier les deux points de vue, celui du nord et celui
du sud...
Charles fit
donc appeler Egide-Gilles et pria le saint homme d'intercéder en sa faveur
auprès de Dieu, afin de lui obtenir le pardon d'un péché qu'il n'osa avouer en
confession. Son péché était si horrible qu'il n'osait même pas l'avouer à
Gilles.
Le dimanche
suivant, pendant la messe, alors que Gilles priait Dieu pour le roi, un ange du
Seigneur déposa un parchemin sur l'autel, rappelant en détail le péché dont
Charles s'était rendu coupable. A la fin, on pouvait lire que quiconque en
appellerait à Gilles pour n'importe quel crime, en obtiendrait le pardon, à
condition de ne pas retomber dans le péché. Après l'office, Gilles remit le
parchemin au roi qui reconnut son péché et s'engagea à s'en abstenir à
l'avenir.
Chargé
d'honneurs et de cadeaux, Gilles s'en retourna à son abbaye, mais en cours de
route, à Nîmes, il rappela encore un prince à la vie.
Il se rendit
plus tard à Rome afin de placer son abbaye sous la juridiction du pape et de la
soustraire ainsi à la convoitise des seigneurs laïques.
On conserve
à la Bibliothèque municipale de Laon, un manuscrit 410 bis se rapportant à une
relique de Gilles. Dans le trésor de la cathédrale, on conserve encore dans un
vase en cristal argenté, un doigt de Gilles. En cette même cathédrale on
célébrait précédemment une fête de saint Gilles: Procession à l'autel de saint
Gilles (cet autel était derrière le chœur, côté nord) aux premières vêpres, à
matines et à la messe du jour, avec encensement de l'autel ; on faisait alors
les neuf lectures de la vie de saint Gilles. (Ordinaire d'Adam de Courlandon,
écrit avant 1228, pour garder les coutumes anciennes. Cathédrale Notre-Dame de
Laon, Bibliothèque municipale, manuscrit n° 221).
Nous
connaissons approximativement l'époque de la copie, ou de la naissance, de la
légende de saint Gilles : la fin du dixième ou le début du onzième siècle.
| GRANDE ET PETITE HISTOIRE DE SAINT-GILLES (Gard) Pièces annexes
> Version imprimable PDF
> La vie de St-Gilles par Teissonnier
prêtre, 1862
> La légende de St-Gilles par J. Charles-Roux, 1911
> La légende de St Vérédème et sa rencontre avec St Gilles, texte de 1869
> Découverte du tombeau de St-Gilles par Henri Révoil en 1865
> Notice sur Clément IV (Guy Fulcodi), par M. Mazer de l'Académie de Nîmes, 1808
> Guy Fulcodi né à Saint-Gilles, devenu le Pape Clément IV, par J. Charles-Roux, 1911
> Origine des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem à St-Gilles (Ordre de Malte) par J. Charles-Roux, 1911
> Le Grand Prieuré de Saint-Gilles par Philippe Ritter
> Les anciennes églises du territoire de Saint-Gilles, par l'abbé Goiffon, 1877
> Etude sur l'Abbatiale de Saint-Gilles et sa crypte, par J. Charles-Roux, 1911
> Cartes Postales anciennes de Saint-Gilles - "Saint-Gilles en Sépia"
|
Les 27 communes de NÎMES MÉTROPOLE bientôt en Ligne dans nemausensis.com.
> Bernis,
Bezouce, Bouillargues, Cabrières, Caissargues, La Calmette, Caveirac,
Clarensac, Dions, Garons, Générac, Langlade, Lédenon, Manduel, Marguerittes,
Milhaud, Nîmes, Poulx, Redessan, Rodilhan, Sainte-Anastasie, Saint-Chaptes,
Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gervazy, Saint-Gilles, Sernhac.
> Contact webmaster
|
|



