|
Vie de Jean Cavalier
28 novembre 1681, Ribaute les Tavernes- 14 mai 1740, Chelséa 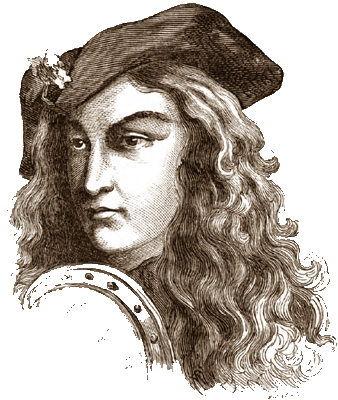 Jean Cavalier (* )NDLR : François Puaux, 1806-1895. Né à Vallon-Pont d'Arc (Ardèche), il fait des études de droit à Montpellier, puis de théologie à Montauban. Pasteur à Luneray, Rochefort, Mulhouse, il fut un partisan très actif du mouvement du Réveil, prenant la défense du courant évangélique et ne se privant pas de polémiquer avec les libéraux. Il rédige également toute une série de brochures hostiles au catholicisme. « Il peut être considéré - écrit le Temps au moment de sa mort - comme le dernier représentant du type d'huguenot d'autrefois... Il aimait la lutte, s'y portant spontanément avec l'allégresse et l'allure d'un franc-tireur. Les armes dont il se servait (...) n'étaient rien moins que savantes, mais il avait le don du style, de l'image populaire, de la répartie brusque... » (Cité par A. Encrevé, dans Les protestants). Son fils Frank Jean Alexandre (1844-1922), pasteur et théologien, peut être considéré comme l'historien officiel du protestantisme français de la fin du XIXe siècle.
NDLR
L’édition originale de 1868 comprend 12 gravures. Il est noté en bas de la couverture : Chez tous les Libraires Protestants de la France et de la Suisse. -oOo-
|
|
Chapitre I Premières années de Cavalier - Il se réfugie à Genève - Son retour dans les Cévennes - Une scène d'intérieur domestique.  La boulangerie de Cavalier près de Carnoulès En 1702, un jeune Français de dix-huit ans gagnait sa vie à Genève, en travaillant de ses propres mains dans la boutique d'un boulanger; il appartenait à la famille de ces nombreux proscrits que la politique, aussi cruelle qu'inintelligente, de Louis XIV, chassait de son royaume, parce qu'ils ne voulaient pas abjurer leur foi. Ce jeune homme, alors ignoré, et qui, quelques jours après, devait avoir un nom célèbre, c'est Jean Cavalier, celui dont nous racontons l'histoire. Jean Cavalier naquit à Ribaute, petit village situé non loin du Gardon d'Anduze, au bas de ces Cévennes toutes remplies, après un siècle et demi; de son souvenir; son berceau fut celui du pauvre, et de lui on peut dire qu'il naquit et grandit dans l'orage des persécutions religieuses. Ses parents appartenaient à la classe de ceux qu'on appelait des nouveaux convertis, mais qui, tout en professant extérieurement le culte catholique, haïssaient mortellement ses cérémonies religieuses. La mère de Jean Cavalier, plus éclairée et plus attachée à sa foi que son mari, l'instruisit secrètement dans les vérités de la foi chrétienne et le mit ainsi en garde contre les enseignements qu'il recevait à l'école catholique. L'enfant, qui avait une intelligence au dessus de son âge, comprenait admirablement sa mère, qui se hasardait quelquefois, à l'insu de son mari, à le conduire dans les assemblées du désert. C'est dans l'une de ces réunions qu'il entendit le célèbre Claude Brousson, dont la parole douce, forte et persuasive, fit sur lui une impression qui ne s'effaça jamais, et le rendit inaccessible à toutes les tentatives qui furent faites plus tard pour lui, arracher une abjuration. Cavalier quitta de bonne heure la maison paternelle et entra comme goujat (valet de berger) chez un nommé Lacombe de Vézenobre. Plus tard, nous le trouvons apprenti boulanger à Anduze. Le jeune ouvrier, qui ne savait pas cacher la haine et le mépris que lui inspirait la religion romaine, attira sur lui l'attention du curé de Ribaute, qui lui intenta deux procès, l'un civil, l'autre criminel; sa liberté, sinon sa vie, courait de grands dangers; il prit la fuite, et, à l'aide d'un guide, il traversa le Rhône, et arriva à Genève, où il se mit à travailler de son état de boulanger pour gagner sa vie. Quelque ravissante que fût la contrée hospitalière où il pouvait servir Dieu en paix, ses regards étaient sans cesse tournés vers les lieux où s'était écoulée sa première enfance ; il n'avait rien oublié, car il y avait laissé son cœur ; le mal du pays s'empara de lui, et à dater de ce moment, il ne pensa qu'à retourner dans ses chères Cévennes ; il hésitait cependant, à cause des dangers qui l'y attendaient. Nul à Genève ne se serait alors douté, en voyant ce jeune ouvrier cévenol, à la figure pâle et souffreteuse, du rôle qu'il était appelé à jouer dans les grands événements qui se préparaient dans le Languedoc. Un jour, Cavalier aperçoit, dans les rues de Genève, l'homme qui lui a servi de guide; il court à lui et lui demande avec anxiété des nouvelles de ses parents. « Ils sont rendus à la liberté, » lui répond le guide. À ces mots, les indécisions du jeune Cévenol cessent; quelques heures lui suffisent pour ses préparatifs de départ, et, bientôt après, il foule de ses pieds cette terre de France où ses frères se voient nier leur droit de servir Dieu selon leur conscience; il ne regagne pas en aveugle le village où s'est écoulée sa première enfance; il sait qu'il y a des bagnes à Cette, à Toulon, à Marseille, et que sa place y est marquée à un banc de forçat, s'il tombe entre les mains des agents de Bâville; mais qu'importe! il ne rebroussera pas chemin ; il reverra les lieux qui l'ont vu naître; il pressera dans ses bras ses chers parents; après, Dieu fera de lui ce qu'il voudra; et il va en avant, marchant la nuit, se cachant le jour ans une caverne ou dans une forêt, supportant avec joie les plus dures privations, et vivant plus, en quelques heures, que d'autres ne vivent en quelques années ; il arrive, enfin, à Ribaute, et se dirige vers la maison paternelle ; il frappe, on ouvre; à sa vue, son père et sa mère poussent un cri de joie : leur enfant chéri leur est rendu ! Leur joie cependant est de courte durée : leur fils est entré dans leur maison au moment où ils vont aller à la messe, la liberté ne leur a été rendue qu'à l'humiliante condition d'abjurer leur foi ! Cavalier, malgré le respect qu'il leur porte, ne peut maîtriser un mouvement de surprise et d'indignation; ils comprennent et rougissent. « Vous n'irez pas à la messe, leur dit-il, Dieu vous le défend; non, vous n'irez pas ! » et de ses yeux jaillissent comme des flammes. Ces paroles, dans lesquelles le jeune Cévenol a fait passer toutes les émotions et les sentiments dont son cœur est plein, font sur ses parents l'impression que le regard de Jésus fit sur Pierre; ils ont honte de leur apostasie et disent à leur enfant : « Nous n'irons plus à la messe. » Cette scène d'intérieur domestique se passait au moment où un drame lugubre venait de s'accomplir à Pont-de-Montvert et donnait le signal de la célèbre et terrible guerre des Camisards. -oOo-
Chapitre II
Bâville ; son caractère. - Il confie à l'archiprêtre Du Chayla la direction de la mission des Cévennes. - Détails biographiques sur Du Chayla. - Insuccès de ses discours. - Moyens de conversion qu'il emploie. - Il devient l'effroi des protestants. - Fuite des demoiselles Sexti ; elles sont arrêtées et conduites à Du Chayla. - Leurs parents supplient Du Chayla de les rendre à la liberté. - Refus du prêtre. - Le prophète Seguier, à la tête d'une bande de paysans, se dirige vers le Pont-de-Montvert. - Mort de Du Chayla ; son oraison funèbre. Depuis la révocation de l'édit de Nantes (1685), les protestants du Languedoc se courbaient sous la main inflexible de l'intendant Lamoignon de Bâville. Cet homme, le type le plus accompli du proconsul farouche et implacable, était né à Paris, en 1650. De bonne heure il attira sur lui l'attention du célèbre Louvois (ministre de la guerre de Louis XIV), qui le jugea plus propre à être un administrateur qu'un légiste ; le protégé ne trompa pas les espérances du puissant ministre de Louis XIV, qui le crut l'homme le plus propre pour apaiser les troubles du Languedoc survenus à la suite de l'exécution de la révocation de l'édit de Nantes. Nommé, en 1690, intendant du Languedoc, Bâville déploya une étonnante activité, et, grâce aux potences qu'il dressa, aux cachots qu'il remplit de femmes, et aux galères qu'il peupla d'hommes, il rétablit, à la manière des Romains, la paix ; mais c'était la paix des tombeaux; il croyait avoir accompli son œuvre et se disposait à retourner à Paris, demander le salaire de ses sanglants services, quand, du feu qui couvait sous les cendres, s'échappa une étincelle qui alluma un incendie; cet incendie dura huit ans ! Bâville avait appelé dans les Cévennes, pour l'aider dans son œuvre de pacification, l'archiprêtre Du Chayla. Cet homme, qui appartenait à la petite gentilhommerie de province, avait, dès ses plus jeunes années, montré un goût décidé pour l'état ecclésiastique; fougueux, ardent, passionné et zélé pour le pape, comme Saul de Tarse pour Moïse, il avait quitté la France pour aller dans le royaume de Siam convertir les païens. Les succès qu'il attendait ne répondirent pas à son attente, et il revint en France, le corps meurtri des mauvais traitements qu'il avait reçus des Siamois. Sa réputation de sainteté, son dévouement, son intrépidité firent croire à Bâville qu'il était, de tous les membres du clergé, l'homme le plus propre à ramener les protestants dans le bercail de l'Église romaine; il lui offrit la direction des missions des Cévennes ; l'archiprêtre accepta et se mit à l'œuvre avec une ardeur digne d'une meilleure cause. Du Chayla habitait, l'hiver, la ville de Mende, renommée par son fanatisme, et, l'été, le Pont-de-Montvert, dans une maison qui avait l'aspect d'un manoir féodal. Il avait sous sa direction de jeunes prêtres qu'il façonnait au rôle de missionnaire et avec lesquels il faisait des tournées dans les paroisses; mais ses succès prédicatoires auprès des protestants étaient si lents que dix siècles de travaux n'auraient pas suffi pour ramener les égarés. Témoin de l'inutilité de ses efforts, il eut recours à la force brutale et demanda à des instruments de torture des résultats qu'il avait vainement demandés à ses discours. Comme un chien limier, il se mit à la piste des huguenots qui cherchaient à fuir leur patrie pour aller chercher, sur la terre étrangère, le repos qu'on leur refusait sur la leur. Quand il parvenait à en faire saisir quelques-uns, il les enfermait dans les caves de son manoir du Pont-de-Montvert, et commençait leur instruction religieuse. Assistons à l'une de ses leçons : aux uns, il donnait une nourriture tellement insuffisante que la faim s'emparait d'eux : ils abjuraient leur foi pour un morceau de pain ; aux autres, il refusait le sommeil et les domptait par des veilles forcées ; à ceux-ci, il faisait administrer des coups de fouet jusqu'à ce que leur corps ne fût qu'une plaie ; à ceux-là, il administrait ses ceps (1). Quand ces moyens de conversion n'opéraient pas au gré de ses désirs, il contraignait ses catéchumènes à tenir dans leurs mains des charbons ardents qu'ils ne pouvaient rejeter qu'après avoir récité l'oraison dominicale ! (1). Les ceps de l'archiprêtre étaient formés d'une poutre fendue par le milieu et qu'on serrait au moyen d'écrous ; elle tenait emprisonnés les pieds des victimes, obligées de se tenir debout ; de fatigue elles tombaient et se cassaient les Jambes. Telle était la méthode de catéchiser de l'archiprêtre. Aussi son manoir était devenu pour les protestants un lieu sinistre dont la vue seule inspirait la terreur et l'effroi. Du Chayla s'applaudissait de son œuvre ; quelques-uns de ses élèves sortirent convertis de ses caves, ce qu'ils n'avaient jamais fait en sortant de ses sermons. À l'époque où nous sommes arrivés de notre récit (1701), les demoiselles Sexti, du village de Moissac, résolurent de quitter les Cévennes et de se réfugier à Genève ; elles partirent de nuit, accompagnées par un guide nommé Massip ; sur le point de traverser le Rhône, elles furent arrêtées et conduites, par les soldats mis à. Leur poursuite, à Du Chayla, qui les fit emprisonner. Leurs parents, en apprenant la fatale nouvelle, coururent se jeter aux pieds de l'archiprêtre, en lui offrant une forte somme d'argent en échange de leur délivrance, mais la tombe eût plutôt rendu sa proie que le prêtre la sienne. Il les repoussa durement ; ils se rendirent alors au sommet du Bouget, où se tenait une assemblée religieuse ; les larmes aux yeux, ils supplièrent les assistants de les aider à délivrer les prisonnières. Un cri de colère s'échappa de toutes les lèvres, et l'un d'eux, le prophète Seguier, se fit l'interprète éloquent de leur juste indignation. « Frères, dit aux assistants ce Cévenol aussi exalté qu'intrépide, arrachons-les des mains de ce prêtre de Moloch ! » « Délivrons-les ! s'écrièrent-ils tous d'une voix, délivrons-les ! » Seguier, sans perdre un instant, descend de la montagne, fait appel à des hommes de bonne volonté. Ils s'arment et se dirigent, en chantant des psaumes, sur Pont-de-Montvert. Il était dix heures du soir. L'archiprêtre, retiré dans son manoir, comme une bête fauve dans son antre, allait se coucher, quand il entend un bruit lointain ; il fait ouvrir une fenêtre et tend l’oreille : « Ce sont, dit-il, ces maudits huguenots qui chantent des psaumes ! » Le son devient de plus en plus distinct et annonce l'arrivée des huguenots. L'archiprêtre ordonne à un soldat d'ouvrir la fenêtre et de faire feu ; il obéit; un coup part, et un compagnon de Seguier, mortellement atteint, tombe baigné dans son sang. À la vue de leur frère qui s'affaisse, les huguenots se précipitent vers la porte du manoir, en poussant des cris terribles ; à coups de pieux ils l'enfoncent et pénètrent dans la cour. L'archiprêtre, avec l'instinct que donne le danger, fait barricader la porte de son repaire ; en quelques instants, elle est enfoncée et les assaillants se ruent sur les gens de Du Chayla ; celui-ci conserve son sang-froid, gravit la montée d'escalier, et, étendant les mains, donne la bénédiction à ceux qui, à ses yeux, sont déjà de saints martyrs, puisqu'ils vont tomber sous les coups des hérétiques. Ceux-ci s'élancent vers l'archiprêtre, qui se dérobe à leur poursuite et se réfugie dans une mansarde ; on le cherche, mais vainement ; on croit qu'il s'est échappé. Une voix du milieu du tumulte fait entendre ces mots : « Brûlons la maison de ce prêtre de Bahal. » Aussitôt on ramasse du bois sec et de la paille ; la flamme brille et pétille et en longues spirales monte comme un serpent enflammé ; la fumée arrive jusqu'à l'archiprêtre et menace de l'étouffer; au moyen d'une corde il se laisse glisser dans le jardin; elle se rompt ; il tombe, se casse une jambe, et va en rampant se blottir dans une touffe d'arbustes; pour la seconde fois il a disparu; les huguenots sont furieux de voir leur proie leur échapper, quand, tout à coup, à la lueur de l'incendie, ils aperçoivent le prêtre et se précipitent vers lui ; mais ils n'osent le frapper sans en avoir reçu l'ordre du prophète Seguier. « Grâce ! grâce ! » s'écrie Du Chayla. « Pas de grâce ! » répond le prophète, et il ordonne qu'on le conduise sur la place publique de Pont-de-Montvert ; là, à la lueur blafarde de l'incendie du manoir, se passe, au milieu de la nuit, une scène terrible, étrange, unique dans l'histoire. Seguier s'avance le premier vers l'archiprêtre, un poignard à la main ; il le frappe et passe son poignard à un autre, qui le passe à un troisième. « Voilà, dit l'un en le frappant, pour mon père que tu as envoyé aux galères. » - « Voilà, dit un autre, pour ma sœur que tu as déshonorée. » Quelques moments après, l'archiprêtre n'était plus qu'un cadavre percé de cinquante-deux coups de poignard. Jusqu'à l'aube du jour, les compagnons de Seguier psalmodièrent autour du corps de Du Chayla, et quittèrent, en chantant, le théâtre sanglant de leurs exploits. La terrible guerre des Camisards était commencée ! Nous racontons les faits sans nous faire l'apologiste du drame de Pont-de-Montvert. Nous avons toujours préféré voir les protestants mourir martyrs de leur foi que de les voir exercer de terribles représailles sur leurs persécuteurs ; mais, quant à l'archiprêtre, il reçut le juste salaire de ses crimes, et, aux yeux de tout homme impartial, il ne sera qu'une bête fauve dont des chasseurs ont délivré la contrée. Il eût certainement évité la mort s'il n'avait pas ordonné de faire feu sur les huguenots, et s'il eût rendu à la liberté les prisonniers qu'on venait lui réclamer. La nouvelle de la mort tragique de Du Chayla se répandit dans les Cévennes avec la rapidité de l'éclair. Bâville, étonné de l'audace de Seguier, se rendit, à marches forcées, avec son beau-frère, de Broglie, à Pont-de-Montvert, et aurait fait incendier le village s'il ne se fût assuré que les habitants étaient complètement étrangers au meurtre de l'archiprêtre. Louvreleuil, curé de Saint-Germain de Calberte, fit, dans son église bâtie par Urbain V, de splendides funérailles à Du Chayla. Le cadavre du défunt, revêtu de ses plus riches habits sacerdotaux, fut exposé sur un catafalque brillamment illuminé et entouré par un grand nombre de prêtres. La foule immense qui remplissait la vieille basilique, écoutait avidement Louvreleuil, qui faisait l'oraison funèbre du défunt, quand tout à coup la nouvelle se répand que Seguier arrive. Une terreur panique s'empare d'elle ; c'est à qui le premier trouvera une issue pour sortir ; les prêtres préposés à la sépulture de l'archiprêtre prennent également la fuite, après avoir jeté précipitamment son cadavre dans une tombe qu'ils ne se donnent même pas la peine de refermer. La nouvelle de l'arrivée de Seguier était fausse ; mais le prophète, qui avait déjà incendié quelques églises, aurait probablement brûlé celle de Saint-Germain de Calberte, si, au moment où il se dirigeait vers cette petite ville, il n'avait pas appris l'arrivée des troupes royales. -oOo-
CHAPITRE III Le capitaine Poul. — Détails historiques sur ce personnage ; il se met à la poursuite de Seguier. - Combat de Font-Morte ; Seguier est fait prisonnier. - Son interrogatoire, sa mort.  Le lieutenant général Victor-Maurice de Broglie Bâville, nous l'avons dit, ne perdit pas un instant, et chargea son beau-frère, de Broglie, de poursuivre les meurtriers de Du Chayla. Il voulait, en les exterminant, inspirer une terreur telle aux Cévenols qu'ils n'eussent pas, même à l'avenir, l'idée d'une prise d'armes. De Broglie ordonna au capitaine Poul de lui amener Seguier mort ou vif. L'homme auquel il donnait cette commission était un soldat de fortune, un vrai troupier français, qui s'enthousiasmait au son du clairon et s'enivrait à l'odeur de la poudre ; se battre était sa vie; il avait tour à tour guerroyé en Allemagne, en Hongrie, et, en dernier lieu, contre les Vaudois des vallées du Piémont. Cette dernière guerre avait développé ses mauvais instincts et l'avait préparé au rôle qu'il était appelé à jouer dans les Cévennes, où sa réputation de bravoure le fit appeler par M. de Broglie. Il ne trompa pas son attente ; car peu de temps après son arrivée il était devenu la terreur des populations cévenoles ; elles savaient qu'il était sans quartier, et que nul mieux que lui ne savait, d'un revers de sabre, abattre une tête, couper un bras. Poul brûlait du désir de rencontrer Seguier ; après plusieurs jours de recherche, il le trouva, un matin, en sortant de Barre, à Font-Morte. Le prophète, plus calme, mais non moins intrépide que Poul, l'attendit de pied ferme à la tête de sa troupe et lui ordonna de faire feu sur les milices royales, qui s'élancèrent sur les insurgés avec une ardeur extraordinaire. Poul, emporté par sa fougue belliqueuse, se jeta au milieu de la mêlée, étonna les Cévenols par les coups terribles qu'il leur porta ; le désordre se mit dans leurs rangs; ils fuyaient, Poul les poursuivit avec l'ardeur d'un limier. Parmi les fuyards, il chercha de l'œil Seguier, il le reconnut aux efforts qu'il faisait pour les rallier et les ramener au combat; il lança son cheval au galop, l'atteignit et le fit, de sa propre main, prisonnier ainsi que deux de ses Cévenols; il les chargea de chaînes et les conduisit en triomphe à Florac. Pendant le trajet il dit à Seguier : « Maintenant que je te tiens, après les crimes que tu as commis, comment t'attends-tu à être traité ? » « Comme je t'aurais traité si je t'avais pris, » lui répondit froidement le prophète. Seguier comparut devant ses juges, il était calme et fier, son interrogatoire commença « Votre nom ? - Seguier. - Pourquoi vous appelle-t-on Esprit ? - Parce que l'esprit de Dieu est avec moi. Votre domicile ? - Au désert, et bientôt au ciel. - Demandez pardon au roi, - Nous n'avons, nous, d'autre roi que l'Éternel. - N'avez-vous pas, au moins, un remords de vos crimes ? - Mon âme est un jardin plein d'ombrages et de fontaines. » Ses juges le condamnèrent à avoir le poignet coupé et à être brûlé vif à Pont-de-Montvert. Il écouta son arrêt de mort avec son calme habituel ; sur son bûcher il fut superbe et vit tomber son poignet sous le tranchant de la hache du bourreau comme si c'eût été celui d'un étranger ; il regarda, sans que son visage trahît la moindre émotion, la flamme qui, en spirale, montait vers lui. « Frères, dit-il aux protestants témoins de son supplice, attendez, espérez-en l'Éternel ! le Carmel désolé reverdira, le Liban solitaire refleurira comme une rose. » Il se vit mourir sans pousser un cri, domptant ses souffrances par sa volonté de fer. Il eût dompté la mort, si la mort eût pu être domptée. Ainsi périt, le 12 avril 1701, le prophète de Magestavols, dont la grande figure, dit l'historien du désert (1), ouvre magnifiquement le soulèvement des Cévennes. (1). Napoléon Peyrat. -oOo-
CHAPITRE IV. Après la mort de Seguier, Laporte est nommé chef des insurgés cévenols. - Portrait de Laporte. - Courage dé ses soldats. - Description des Cévennes ; leur champ de bataille. - Caractère des montagnards cévenols. Après la défaite de Seguier, ceux de ses compagnons qui s'étaient échappés se réunirent, au nombre environ de trente, et délibérèrent sur les mesures à prendre pour sauver leur vie. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun quartier à attendre de Bâville ; les uns opinaient pour qu'on cherchât un refuge sur les âpres sommets de l'Aigoâl, les autres, et c'était le plus grand nombre, croyaient que leur seul moyen de salut était la fuite à l'étranger. Lorsque les opinions se furent fait jour, un Cévenol, qui jusque-là avait gardé le silence, se leva et dit : « Le parti que vous voulez prendre n'est pas praticable. Pourquoi aller sur la terre étrangère, celle-ci n'est-elle pas à nous ? Où dorment nos pères, n'avons-nous pas le droit d'avoir nos tombeaux ? Délivrons nos frères opprimés ; nous n'avons pas d'armes, l'Éternel nous en donnera ; nous sommes peu nombreux, il nous enverra des aides ; s'il faut mourir, mieux vaut mourir par l'épée que par la corde du bourreau. » L'homme qui tenait ce langage était né à Mas Soubeyran et s'appelait Laporte, il avait quarante ans; ses traits fortement accentués et sa parole vibrante indiquaient, chez lui, l'habitude du commandement ; sa taille était haute, sa contenance martiale, son regard imposant ; jeune, il avait servi dans les armées françaises, et depuis qu'il avait quitté le service, il était maître de forges à Collet-de-Dèze. Témoin des cruautés des prêtres, il avait pris en horreur l'Église romaine et ses cérémonies ; tel était l'homme qui donnait à ses compagnons le conseil d'opposer la force à la force. Sa parole convaincue fit sur eux une impression profonde, rendue plus forte, quand un prophète, Abraham Mazel, se levant, dit sentencieusement, en terminant son discours : « J'ai vu en songe des bœufs noirs gros (des prêtres) qui broutaient dans le jardin ; Dieu m'a dit de les chasser. » A ces mots, les compagnons de Laporte se lèvent, et tous d'une voix s'écrient : « Sois notre chef ! - J'accepte, » leur dit Laporte, et il prit le titre de colonel des enfants de Dieu, et appela son camp le camp de l'Éternel. De l'ombre d'où ils sont sortis, des paysans lèveront fièrement la tête devant celui en présence duquel des millions de têtes se courbent. Dans un siècle d'oppression et de brillante servitude, ils combattront pour la liberté des libertés, la liberté de conscience ; ils suppléeront à leur infériorité numérique par leur courage qui sera égalé, mais jamais dépassé; ils étonneront, par la tactique de leurs chefs improvisés, des maîtres dans l'art de la guerre, et par leur bravoure, des soldats qui ont combattu sur les bords du Rhin sous les ordres de Turenne et de Gassion. Suivons-les sur leurs champs de bataille; mais avant, jetons un coup d'œil rapide sur les Cévennes, ce théâtre sacré et sanglant de leurs exploits. Les Cévennes se divisent en hautes et basses Cévennes et courent dans la direction du nord au midi, des Boutières à la Méditerranée; leur aspect offre des points de vue très-variés, tantôt riants, mais le plus souvent tristes et sévères ; ici, ce sont des forêts épaisses, là, des rochers nus; les gorges et les torrents y abondent ; on dirait que la Providence les y a jetés pour en faire le refuge de la liberté opprimée. Quand les Albigeois, traqués comme des bêtes fauves, s'enfuirent devant le glaive de leurs exterminateurs, ils se réfugièrent dans les Cévennes et y entretinrent cet esprit d'indépendance particulier aux montagnards, et, lorsque, au seizième siècle, ce cri : Réforme ! Réforme ! retentit dans ces contrées, les prédicateurs de la bonne nouvelle y trouvèrent les esprits admirablement disposés ; de nombreuses et florissantes églises s'y fondèrent et résistèrent merveilleusement aux efforts des Valois pour les déraciner. Nîmes, Anduze, Alès, Saint-Hippolyte, devinrent de grands centres protestants. Les montagnards cévenols étaient industrieux, actifs, attachés à leur foi, mais plus propres encore au rôle de soldats qu'à celui de martyrs , quoiqu'ils eussent de glorieuses pages dans le martyrologe protestant. Vifs, emportés même, ils avaient donné de grands exemples de patience. Depuis vingt ans, ils vivaient sous le régime de la plus cruelle et la plus odieuse oppression, et quand ils recoururent à la force pour se défendre contre la force, la coupe était comble. Habitants d'un pays de plaine, Laporte et ses compagnons eussent dit : Fuyons ; à la vue de leurs montagnes sauvages, abruptes, ils s'écrièrent : Restons ! ! -oOo-
CHAPITRE V Exploits de Laporte. - Deux de ses lieutenants, Castanet et Catinat. - Détails biographiques sur ces deux personnages. - Le capitaine catholique Poul ; sa bravoure. - Il se met à la poursuite de Laporte. - Combat de Champ-Doumergues. -Combat de Sainte-Croix. - Mort de Lapone. Laporte ne demeura pas oisif : quelques jours lui suffirent pour armer sa troupe et la fournir de poudre et de balles ; il désarma les villages de Mandagout et de Freyssinet, et jeta, par la rapidité foudroyante avec laquelle il exécutait ses coups de main, la terreur parmi les villages catholiques. Chaque jour, il voyait accourir sous son drapeau insurrectionnel de jeunes montagnards, et bientôt il se vit à la tête d'une compagnie de cent hommes, pleins d'une ardeur belliqueuse, admirablement disposés à toutes les terribles éventualités de l'avenir. Au nombre de ceux qui les premiers se joignirent à lui se trouvait un montagnard disgracieux de corps et de visage, mais au cœur intrépide ; il s'appelait Castanet ; il était né à Massavaque, et avait quitté le service militaire après la paix de Ryswick ; il était rentré en France en 1700, et depuis cette époque, il était garde forestier dans la contrée de l'Aigoâl et étudiait avec ardeur l'Écriture sainte qu'il expliquait â ses frères persécutés ; il le faisait avec une grande puissance ; en l'entendant, on oubliait sa laideur. Le montagnard, en apprenant la nouvelle de la prise d'armes de Laporte, n'avait pas hésité un seul instant ; il était descendu de l'Aigoâl avec quelques jeunes gens disposés, comme lui, à vaincre ou à mourir. Quelques jours après l'arrivée du garde forestier, un nouvel auxiliaire se joignit au colonel des enfants de Dieu ; on l'appelait Abdias Morel, connu dans l'histoire des Camisards sous le nom de Catinat. Abdias Morel était un paysan du village du Cailar ; jeune il avait servi en Italie dans un régiment de dragons sous le commandement du célèbre et probe Catinat. Morel s'éprit d'un tel enthousiasme pour le maréchal qu'il avait sans cesse son nom sur ses lèvres ; ses camarades lui donnèrent par dérision le nom de Catinat. Catinat, nous lui donnerons à l'avenir ce nom, était un homme de haute taille, chez lequel tout dénotait la force ; il était, dans toute l'acception du mot, un brave, le danger n'existait pas pour lui, car il ne le voyait jamais, ou, s'il le voyait, il le dédaignait. Se battre était sa joie. Son regard, à la fois martial et farouche, imposait la terreur ; mais cet homme, lion dans un jour de combat, était doux comme un agneau dans le commerce ordinaire de la vie. Témoin journalier de la froide cruauté des prêtres, il leur avait voué une haine mortelle et les regardait comme des bêtes fauves dont il est permis de débarrasser la contrée ; mais il y avait un homme qu'il haïssait plus encore que les prêtres ; cet homme était le trop célèbre baron de Saint-Cosme. Ce gentilhomme, après la révocation de l'édit de Nantes, apostasia et devint le persécuteur acharné de ses frères qu'il avait lâchement abandonnés ; il les dénonçait à Bâville, dispersait, à la tête d'une compagnie de dragons, leurs assemblées, et conduisait à l'intendant, dont il était l'un des pourvoyeurs, ses prisonniers, destinés, les uns, aux galères, les autres, à la potence. A la vue de ces indignes et froides cruautés, Catinat, aidé de quelques paysans, rencontra (13 août 1702), sur le chemin de Codognan à Vauvert, l'apostat, et le tua. Ce meurtre, commis presque sous les yeux de Bâville, l'irrita au plus haut degré. Ne pouvant saisir Catinat et ses complices, il fit périr un innocent. Bosanquet fut roué vif à Nîmes, le 7 septembre 1702, et son cadavre, exposé sur la voie publique, apprit aux populations protestantes le sort qui les attendait ; la terreur s'empara d'un grand nombre d'hommes, qui coururent se joindre à Laporte, en disant : « Mieux vaut périr sur un champ de bataille que par la main du bourreau. » Le colonel des enfants de Dieu ne tarda pas à se trouver en présence des milices royales. Poul, qui brûlait du désir d'attacher à son char de triomphe Laporte comme il y avait attaché Seguier, rencontra le chef cévenol dans la petite plaine de Champ-Doumergue.s. Des deux côtés le choc fut rude; mais quand Laporte vit que la lutte était inégale, il donna habilement à sa troupe le signal de la retraite, qui se fit en bon ordre. A dater de ce jour, on cessa de mépriser ces hommes qu'on traitait de misérables pâtres ; ils s'étaient battus en lions, et s'ils avaient laissé plusieurs des leurs à Champ-Doumergues, ils avaient fait payer chèrement à Poul sa victoire. Après que Laporte eut rallié sa troupe, il se prépara à de nouveaux combats ; quelques semaines suffirent, par ses hardis coups de main, à donner à son nom une célébrité retentissante ; de tous les côtés, il voyait arriver sous son drapeau victorieux une foule de pâtres et de paysans, attirés vers lui autant par le prestige de son nom que par la haine de leurs persécuteurs. Ces soldats improvisés avaient la bravoure des vieux et un instinct militaire qui suppléait à leur inexpérience. Poul, qui ne le cédait nullement en courage à Laporte, se mit avec ardeur, après le combat de Champ-Doumergues, à la recherche du colonel des enfants de Dieu. Celui-ci, qui connaissait parfaitement la contrée, ne cédait pas à la vaine gloire de se battre, et évitait habilement toute rencontre dans laquelle la lutte eût été trop inégale. Il se transportait d'un lieu à un autre avec une rapidité qui tenait du prodige et désespérait Poul qui, au moment où il croyait le rencontrer, apprenait qu'il avait décampé la veille ; il apprenait en même temps que tel village avait été désarmé, telle église incendiée, tel couvent pillé. Il eut, enfin, la joie de rencontrer le chef cévenol, le 22 octobre, sur une hauteur formée par le vallon de Sainte-Croix, entre le château du Mazel et le chemin de Temelac. Laporte, à la vue des soldats de Poul, eut l'instinct du danger qui le menaçait ; fuir était impossible, la bravoure seule de sa troupe pouvait le sauver; il donna aussitôt ses ordres et le combat commença ; malheureusement la poudre de ses soldats était mouillée ; trois coups de fusil seulement partirent; chacun tua un homme. Poul, qui s'aperçut de l'état de détresse des insurgés, ordonna à ses soldats de s'élancer sur eux et de ne tirer qu'à bout portant ; ceux -ci obéirent. Laporte, qui comprit la manœuvre du capitaine, donna le signal de la fuite et indiqua à ses compagnons les rochers où ils pourraient se retirer : « Suivez-moi ! » leur cria-t-il, et avec l'agilité d'un cerf il décampa; mais au moment où il franchissait un rocher, une balle l'atteignit ; il s'affaissa sans pousser un soupir, il était mort. Ainsi périt, après deux mois de commandement, le chef de l'insurrection cévenole. Quelques semaines lui avaient suffi pour acquérir un ascendant si irrésistible sur ses soldats que les populations catholiques l'attribuaient à des sortilèges. Si la mort l'eût épargné, il eût été jusqu'à la fin de la guerre le chef incontesté de tous ces hommes inconnus hier, aujourd'hui célèbres, qui ont laissé leurs noms inscrits, en caractères ineffaçables, sur les rochers des Cévennes teints de leur généreux sang. -oOo-
CHAPITRE VI Les insurgés donnent pour successeur à Laporte son neveu Roland. - Portrait de Roland. - Poul fait exposer sur le pont d'Anduze la tête de Laporte et celles de huit Cévenols. - Cavalier, suivi d'une trentaine de jeunes gens, se joint à Roland. - Scène du pont d'Anduze. - L'insurrection prend de nouvelles forces.- Étonnement et colère de Mille. Laporte laissa pour héritier de son pouvoir, de son courage et de son habileté, un jeune homme dont le nom brille au premier rang des chefs cévenols ; on l'appelait Laporte dit Roland ; il était né, en 1671, à Massoubeyran, et avait servi dans un régiment de dragons. Après la paix de Ryswick, il était rentré en France et s'était joint à son oncle, quand celui-ci avait donné le signal de l'insurrection. Roland avait une figure belle, intelligente, martiale ; sa parole était à la fois éloquente et grave ; il parlait peu ; mais tout ce qu'il disait était marqué au coin de la sagesse et du bon sens. Brave parmi les braves, son courage était plus celui d'un Anglais qui réfléchit que celui d'un bouillant Français qui ne réfléchit pas ; il ne courait pas après le danger, mais le danger le trouvait prêt à le braver ; toujours victorieux là où il pouvait vaincre, et quelquefois vainqueur là où il aurait dû être vaincu. Son mérite s'imposa de lui-même, et à la mort de son oncle, il fut élu à l'unanimité général des enfants de Dieu. Le choix de ces derniers ne tomba pas sur une tête incapable ; nul plus que Roland n'était digne de succéder au brave Laporte ; il avait toutes les qualités d'un chef courageux et prévoyant ; la cause à laquelle il s'était dévoué, il l'aimait en vrai huguenot ; à elle il s'était donné corps et âme ; en tirant l'épée, il avait jeté le fourreau. (1) (1). Histoire de la Réformation française, t. VI, p. 234. Après sa victoire, Poul fit couper la tête de Laporte et celles de huit de ses compagnons ; on les promena triomphalement dans les principales villes des Cévennes, et on les cloua, le 25 octobre 1702, sur le pont d'Anduze. Quelques jours après, dix-huit Cévenols, conduits par un jeune homme à la figure enfantine, débouchaient par le pont d'Anduze, quand tout à coup, frappés de terreur, ils s'arrêtent à la vue de la tête de Laporte et de celles de ses huit compagnons ; ils allaient rétrograder, quand le jeune homme élevant la voix, leur dit : « Frères, au lieu de reculer, ces têtes nous crient : En avant ! » Celui qui parlait ainsi était Jean Cavalier. Peu après son retour dans la maison paternelle, il avait appris la nouvelle du meurtre de Du Chayla et la prise d'armes de Laporte. Tout ce qu'il voyait agissait fortement sur sa jeune imagination, et il se sentait atteint par cet esprit mystérieux qui alors. transformait tant de natures, et instinctivement, sans pouvoir s'en rendre raison, il se sentait poussé vers les choses grandes et extraordinaires, et souffrait cruellement de l'oppression sous laquelle il voyait ses frères. Nature ardente, vive, généreuse, il n'était pas de ceux qui se cachent pour laisser passer le danger ; né soldat, il aimait la guerre; huguenot, il détestait l'oppression cléricale; aussi tous ses instincts militaires s'éveillèrent au premier coup de fusil qui retentit dans les Cévennes pour la cause sacrée de la liberté de conscience. Dans une réunion, convoquée près de Ribaute, il engagea quelques jeunes Cévenols à se joindre aux insurgés et se mit à leur tête ; c'était à eux qu'il disait sur le pont d'Anduze : « Ces têtes nous crient : En avant ! » Sa voix, dans laquelle il avait fait passer tout le bouillonnement d'un cœur indigné, vainquit leur indécision ; ils s'inclinèrent devant la tête de Laporte et poursuivirent leur chemin. A dix heures du soir, ils entrèrent dans le petit village de Saint-Martin près Durfort, s'emparèrent des armes cachées dans le presbytère ; mais ils épargnèrent la vie du curé; bientôt après ils se joignirent à Roland. Bâville, auquel la tête de Laporte fut apportée à Montpellier, après son exposition sur le pont d'Anduze, la salua comme un gage assuré de la fin des troubles ; son erreur ne fut pas longue ; il apprit bientôt après par ses agents que les insurgés étaient plus nombreux que jamais et moins que jamais disposés à déposer les armes. -oOo-
CHAPITRE VII Organisation de l'insurrection cévenole. - Ses cinq chefs. - Les insurgés en face de la royauté. - Exploits des insurgés. - Terreur des prêtres. - Fléchier, évêque de Nîmes. - Détails biographiques sur ce prélat. Le nombre des insurgés, de trente hommes, s'était rapidement élevé à trois mille, qui formaient cinq compagnies, commandées chacune par un chef sous les ordres de Roland. Castanet, Cavalier et Joany commandaient chacun une compagnie. Ce dernier, natif du village de Genolhac, était un homme de quarante ans ; il avait servi, bien jeune encore, dans le régiment des dragons d'Orléans, et s'était distingué par sa bravoure et son intrépidité. Il était hardi jusqu'à la témérité, entreprenant jusqu'à l'impossible ; il savait si bien électriser ses soldats que leur cœur était inaccessible à la crainte, les rendait capables de tout oser. L'une des cinq compagnies était commandée simultanément par deux prophètes, compagnons de Seguier, Salomon et Abraham Mazel. Ces deux chefs avaient l'un pour l'autre une amitié fraternelle; âmes fortement trempées, ils inspiraient une confiance sans bornes à leurs soldats, et leur montraient le ciel à travers un champ de bataille; à leurs yeux, ils étaient deux Samuel, deux envoyés du Dieu des armées, chargés de frapper Moloch et Bahal. Ce qui au commencement avait paru à Bâville une émeute était devenu une véritable insurrection. Des sujets osaient désobéir à leur roi, à celui qu'ils avaient regardé jusqu'alors comme l'oint du Seigneur et son représentant sur la terre ! Mais n'oublions pas que ces hommes n'ont pris les armes qu'à la dernière extrémité, lorsqu'ils y ont été contraints par leurs implacables persécuteurs. Leur roi, celui qui aurait dû les protéger, lâchait sur eux ses dragons et méconnaissait, à leur égard, les droits les plus élémentaires de la justice ; comme le profane Saül, il avait cessé d'être leur roi légitime le jour où de père il était devenu tyran. Ils ne lui contestaient pas cependant son titre de roi; mais ils croyaient avoir le droit de ne pas se laisser assassiner sans opposer la moindre résistance ; ils résistèrent et firent bien. Sans doute, si, au lieu d'être soldats, ils avaient eu le saint courage des martyrs, la cause qu'ils défendaient eût été sanctifiée par leur sang versé ; mais qui oserait leur faire un crime, après vingt ans de souffrances imméritées, d'avoir fièrement relevé la tête devant le maître implacable, qui voulait l'abjuration de leur foi ou leur anéantissement et celui de leurs familles ! Bâville, qui avait cru, à la nouvelle de la mort de Laporte, apprendre au cabinet de Versailles la fin des troubles des Cévennes, fut effrayé, quand il vit les Cévenols à l'œuvre. Leurs cinq chefs lui donnaient chaque jour de leurs nouvelles par leurs hardis coups de main : ils pillaient des villages, interceptaient des convois, sabraient des compagnies, et répandaient, au milieu des populations catholiques, la terreur et l'effroi. Le clergé se faisait surtout remarquer par sa frayeur : il se barricadait dans ses presbytères, d'où il implorait le secours de Bâville ; l'évêque de Mende, la cité catholique, faisait fortifier les portes de sa ville épiscopale ; celui de Nîmes, Fléchier, exhalait ses douleurs et ses craintes dans ses mandements et ses lettres pastorales, académiquement écrites. Ce prêtre, dont le nom est inséparable des temps orageux dans lesquels il vécut, naquit, en 1632, à Pernes (Vaucluse). Il appartenait à une famille pauvre, qui le fit entrer, à l'âge de seize ans, dans la congrégation des Pères de la doctrine chrétienne. Le jeune Provençal attira sur lui l'attention de son supérieur par son aptitude au travail et une rare facilité d'élocution, qui le plaça au premier rang des prédicateurs du comtat Venaissin. Il alla à Paris, où il eut pour protecteur l'austère duc de Montausier, qui le chargea de prononcer l'oraison funèbre de la célèbre Julie d'Angennes, son épouse ; il s'en acquitta à la grande satisfaction du duc, et quand, en 1675, il fit celle de Turenne, l'admiration publique lui assigna une place à côté de Bossuet. Louis XIV lui donna, en 1685, l'évêché de Lavaur, qu'il quitta deux ans après pour occuper celui de Nîmes.  L'évêque Fléchier Jusqu'au jour où Fléchier devint évêque, il n'avait été qu'un abbé de cour, se faisant distinguer dans la chaire par quelques brillants discours, et dans les salons, par son esprit et son amabilité auprès des grandes dames de la cour. « Il avait, c'est lui-même qui nous l'apprend, un caractère d'esprit net, aisé, capable de tout ce qu'il entreprenait ; il faisait des vers français et latins fort heureusement et réussissait dans la prose; les savants étaient contents de son latin, la cour louait sa politesse, et les dames les plus spirituelles trouvaient ses lettres ingénieuses et délicates. » (1) (1). Portrait de Fléchier tracé par lui-même. Voyez le Dictionnaire Dézobry et Bachelet, art. FLÉCHIER, page 1044. Tel était l'homme qui, après avoir vécu au milieu des délicatesses et des plaisirs de Versailles, se trouvait transporté au milieu d'une nombreuse population protestante. L'abbé de cour, devenu évêque, prit au sérieux ses fonctions sacerdotales, et, à l'exemple de Louis XIV, il voulut expier sa vie un peu trop mondaine en se faisant convertisseur. -oOo-
CHAPITRE VIII Exploits de Cavalier. - Prise du château de Servas. - Bataille du Mas de Cauvi. - Heureuse tentative à Sauve. - Parate et Julien. - Combat de Nages. - Mort de Poul. - Terreur que les insurgés inspirent aux catholiques. Les Camisards faisaient expier durement au clergé ses froides cruautés. Cavalier, entre tous leurs chefs, se distinguait par ce coup d'œil prompt, juste, qui est le génie du capitaine ; audacieux dans l'attaque, il déployait une habileté admirable dans la retraite. Quelques jours avaient suffi pour faire de lui l'idole de ses soldats, qui oubliaient sa jeunesse et subissaient avec orgueil la supériorité de ce jeune pâtre né général et orateur, qui les étonnait, sur un champ de bataille, par la sûreté avec laquelle il donnait ses ordres ; et, dans une assemblée religieuse, quand, prédicateur inspiré, il atteignait, sans les rechercher, les hauteurs de la véritable éloquence. Sa troupe était plus nombreuse que celle des autres chefs. La jeunesse cévenole se sentait tout particulièrement attirée vers lui. De bonne heure la gloire lui avait mis l'auréole au front, et son nom, volant de bouche en bouche, était devenu l'espoir des protestants et la terreur des catholiques. Chaque jour, ces derniers apprenaient un fait d'armes du jeune chef cévenol ; trois événements, qui survinrent presque coup sur coup, mirent le sceau à sa réputation. Entre Alais et Uzès était situé le château de Servas, occupé par une garnison qui faisait de fréquentes sorties sur les Camisards et se montrait sans pitié pour les prisonniers qu'elle leur faisait. Avec les moyens d'attaque que possédait Cavalier, le château était imprenable ; mais ce que la force ne pouvait faire, la ruse le fit. Le chef camisard, qui calculait les difficultés d'une entreprise et rarement ses dangers, fit charger de chaînes six de ses soldats et les confia à la garde de trente autres habillés comme les troupes royales, se mit bravement à leur tête, revêtu d'un uniforme d'officier général, et suivi de sa troupe, qui avait l'air de le poursuivre, il arriva aux portes du village et demanda le consul. A la vue du brillant officier, le consul s'incline : « Je suis, lui dit Cavalier, le neveu de M. de Broglie; j'ai fait ces six prisonniers aux insurgés qui s'avancent pour les enlever ; allez demander au commandant du château de me permettre de les faire coucher dans ses prisons. » Le consul s'incline de nouveau et court prévenir le commandant, qui, fier de recevoir le neveu de M. de Broglie, lui offre des rafraîchissements et un lit pour la nuit. Cavalier refuse, le commandant insiste, il refuse encore et finit par accepter l'invitation, et suivi de ses trente hommes, il entre dans la cour. Pendant qu'on prépare le dîner, le commandant conduit son hôte sur la plate-forme du château d'où il lui fait admirer ses moyens de défense ; ensuite on se met à table, on cause des événements qui, dans ce moment, sont l'objet des préoccupations de tous les esprits. Cavalier intéresse vivement son hôte par les détails circonstanciés qu'il lui donne et par la manière vive et brillante avec laquelle il le fait. Le commandant prête une oreille attentive ; pendant ce temps-là, les soldats de Cavalier, pour ne pas éveiller les soupçons, se glissent dans le château, le fusil en bandoulière. À les voir rôder çà et là, on dirait des étrangers qui n'ont d'autre but que de contenter leur curiosité. Ils s'avancent vers la salle à manger pour être vus de Cavalier ; celui-ci fait semblant de ne pas les voir, et continue de causer avec le commandant, dans l'esprit duquel il n'est pas monté le plus léger soupçon, et qui continue à l'écouter avec le même intérêt. Quand Cavalier croit le moment venu, il se lève, et d'une voix forte, il donne le signal convenu; ses Camisards se jettent sur le commandant, l'immolent, passent au fil de l'épée sa petite garnison, et se retirent, chargés d'un riche butin, à la lueur de l'incendie du château, et vont camper à une lieue du théâtre de leurs exploits. Quelques jours après (c'était le jour de Noël 1702), Cavalier se trouvait au Mas de Cauvi, non loin de la belle et riante prairie d'Alais ; il y célébrait la sainte cène avec sa troupe, quand ses vedettes l'avertirent de l'approche de l'ennemi, qui arrivait en force, sous les ordres du chevalier de Guines, commandant d'Alais. Sa troupe se composait de la garnison de la ville, de six cents milices bourgeoises et de cinquante gentilshommes. Le chevalier, qui ne doutait pas de la victoire, avait eu soin de faire une ample provision de cordes portées par un mulet : elles étaient destinées à pendre ses prisonniers aux carrefours d'Alais. Cavalier fit cesser immédiatement le service religieux et congédia les fidèles qui étaient venus des bourgades voisines ; il resta seul avec sa troupe. Fuir était le parti que lui indiquait la prudence, vu le petit nombre d'hommes qu'il avait à opposer à ses nombreux ennemis. Il allait donc décamper et s'enfoncer dans le bois, quand, sur des indications qui lui furent données de l'état des lieux, il fit habilement ses dispositions et se prépara à recevoir le choc du commandant d'Alais ; celui-ci, contrairement aux premiers éléments de l'art de la guerre, lança sa cavalerie contre les Camisards, qui la laissèrent approcher, tirèrent sur elle à bout portant, et mirent en un clin d'œil le désordre dans ses rangs. Ce fut à qui des cavaliers tournerait bride et chercherait son salut dans la fuite. Les milices bourgeoises l'imitèrent, et, pour mieux courir, elles se débarrassèrent de leurs sabres, de leurs fusils et de leurs manteaux. Les Camisards les poursuivirent, l'épée dans les reins, et jonchèrent la prairie d'Alais de leurs morts. Dans leur ardeur, ils auraient couru le risque d'être faits prisonniers, si le chevalier de Guines, qui dut sa vie à la vitesse de son cheval, n'eût ordonné de fermer les portes pour empêcher les vainqueurs d'entrer dans la ville. Cavalier fit un riche butin : il trouva sur le champ de bataille, qui s'étendait de Cauvi à Alais, des sabres, des fusils, de la poudre, et des morts en grand nombre, qu'il dépouilla de leur costume militaire pour en revêtir ses soldats. Il rendit grâces à Dieu de cette grande journée, et ses Camisards, d'une voix forte et martiale, entonnèrent des psaumes. Cavalier, après sa victoire, se dirigea du côté de Sauve, où l'attendait Roland, qui désirait s'emparer de cette place forte dont la garnison l'inquiétait par ses sorties continuelles. Le faire par la force, c'était tenter l'impossible ; le tenter par la ruse, c'est ce que le général et son lieutenant essayèrent. Après s'être concertés, ils affublèrent Catinat d'un habit de lieutenant-colonel et le mirent à la tête d'une compagnie de Camisards qui avaient échangé leurs habits rustiques contre les costumes des vaincus de Cauvi. L'intrépide Catinat, suivi de loin par les troupes de Cavalier et de Roland, arrive tambour battant, avec ses gens, vers midi, aux portes de Sauve. « Qui vive ? crie la sentinelle. - Ami ! » répond Catinat, et il ajoute : « J'ai poursuivi toute la matinée les incendiaires de l'église de Monoblet ; je suis fatigué et mes gens ont besoin de se rafraîchir. Entrez ! » dit la sentinelle. Catinat entre avec sa troupe, qui reste sous les armes sur la place de la ville ; lui, il se fait conduire vers le gouverneur, M. de Pibrac, nouveau converti. Ce seigneur allait se mettre à table ; il invite le faux lieutenant-colonel et deux de ses capitaines à dîner. Ils acceptent ; Catinat est gai, jovial ; il fait même le galant auprès de la jeune et belle Mme de Pibrac, qui s'amuse d'abord de ses propos, et puis s'en étonne : l'habit de son hôte est celui d'un gentilhomme, mais son langage est celui d'un rustre. Elle pressent qu'elle a à sa table trois Camisards ; elle dissimule habilement ses craintes, cherchant comment elle pourra se débarrasser de ses terribles convives ; au dessert, on annonce qu'une grosse troupe s'avance vers Sauve. A ces mots, Mme de Pibrac dit à Catinat : « De grâce, Monsieur, courez aux portes, ce sont peut-être les Camisards qui arrivent. - J'y vais, Madame, » dit fièrement Catinat, qui se lève de table suivi de ses deux lieutenants ; à peine ont-ils franchi les portes du château, que Mme de Pibrac, d'une voix dans laquelle elle a fait passer toute sa terreur, dit à son mari: « Faites tomber la herse ! » Il le fit; ils étaient sauvés. Catinat, qui n'a pas entendu Mme de Pibrac, descend sur la place publique ; les bourgeois effrayés se pressent autour de lui ; il les rassure. « Si les Camisards viennent, je saurai les recevoir, » leur dit-il; pendant ce temps-là, Roland et Cavalier s'approchent de Sauve. Quand ils en sont à une portée de fusil, ils entonnent avec leur troupe un psaume : c'est le signal qu'attend Catinat. « Bas les armes ! crie-t-il d'une voix tonnante, et vivent les enfants de Dieu ! » À ces mots, la troupe couche en joue le peuple qui, saisi de terreur, ouvre les portes à Roland et à Cavalier. Ceux-ci s'emparèrent, sans coup férir, de la ville et rançonnèrent les habitants, qui furent épargnés, à l'exception de trois curés et d'un capucin, qui furent passés par les armes. Les Camisards se retirèrent, -à la lueur de l'incendie de l'église, chargés d'un riche butin. Ces hardis coups de main, tentés presque sous les yeux de Bâville et réussis au-delà de toute espérance, l'exaspéraient. La cour, à laquelle il transmettait ces mauvaises nouvelles, ne comprenait pas qu'après les grandes et glorieuses batailles gagnées sur les bords du Rhin, une poignée de paysans n'eût pas été écrasée le jour même de leur insurrection. Elle envoya de nouvelles troupes dans les Cévennes et mit à leur tête de Parate et Julien, qui devaient servir comme lieutenants sous les ordres de de Broglie. Julien était un gentilhomme protestant qui avait échangé sa foi contre un brevet de brigadier ; il était brave, hardi, et il haïssait ses anciens coreligionnaires avec la haine dont un renégat seul a le secret ; il se mit à la tête des troupes dont le commandement lui avait été confié et se dirigea vers les Cévennes. Pendant qu'il était en chemin, le brave capitaine Poul trouvait la mort sur un champ de bataille. Depuis quelques jours, il était avec de Broglie à la recherche des Camisards, quand il les rencontra tout à coup au val de Bane ; Ravanel les commandait. L'intrépide Camisard se mit en bon ordre de bataille et reçut bravement le premier choc de la compagnie de Poul. « Feu ! » dit-il à sa troupe dont les rangs furent aussi promptement reformés qu'éclaircis ; elle obéit, tira à bout portant avec tant de précision que chaque coup porta ; la peur se mit dans les rangs de l'ennemi, qui, saisi d'une frayeur panique, prit la fuite. Poul, monté sur son cheval de bataille, fit des efforts inouïs pour ramener ses soldats au combat. Un jeune Camisard, un enfant, nommé Samuelet, vit Poul, qui lui apparut comme autrefois Goliath au jeune David ; il courut vers lui, un caillou à la main, et l'atteignit au front. Le guerrier catholique chancela et tomba de son cheval ; l'enfant se précipita vers lui, saisit son sabre, le lui plongea dans le cœur, s'empara de son cheval et se mit bravement à la poursuite des fuyards, qui ne se crurent en sûreté qu'aux Devois des Consuls. La nouvelle de la défaite des troupes catholiques arriva promptement à Nîmes. « Poul et Broglie ont été tués, » disaient les bourgeois saisis de terreur, et ils fermèrent leurs portes. Profitant de la frayeur des Nîmois, Cavalier pénétra, à la faveur d'un déguisement, dans la ville ; il y vit quelques amis, qui, sous le prétexte de s'en servir contre les Camisards, firent pour lui des achats de poudre. La défaite de Broglie terrifia Fléchier et exaspéra Bâville, qui convoqua une assemblée d'officiers à laquelle Julien assista ; celui-ci, oubliant qu'il était soldat, proposa qu'on passât sans distinction au fil de l'épée tous ceux qui seraient soupçonnés de favoriser les insurgés. Cette proposition barbare trouva des partisans. Moins par humanité que pour ne pas léser les intérêts de l'État, en faisant un désert des Cévennes, Bâville la fit rejeter ; mais on résolut de poursuivre, l'épée dans les reins, les Camisards, et de ne leur laisser ni trêve ni repos. On se mit vivement à l'œuvre, et, dès lors, chaque jour fut marqué par une attaque, une retraite, une victoire, une défaite. Roland, Cavalier, Catinat, Ravanel, Joany, Castanet, sans cesse sous les armes, se portaient sur tous les points des Cévennes et faisaient des prodiges d'audace et de valeur, qui étonnaient leurs ennemis et frappaient de stupéfaction et de terreur les catholiques et donnaient aux protestants l'espérance d'un meilleur avenir. C'est à cette époque qu'eut lieu la célèbre expédition de l'Ardèche. -oOo-
CHAPITRE IX Fermentation dans le Vivarais. - Roland envoie Cavalier dans le Vivarais. - Cavalier défait le comte du Roure. - Bataille de Vaguas. - Défaite complète de Cavalier. - Ravanel et Catinat sauvent par leur bravoure et leur sang-froid les débris de l'armée camisarde. - Mort d'Espérandieu. - La vie de Cavalier court de grands dangers. - Merveilleuse délivrance du chef camisard. - La fièvre et la vieille huguenote. - Joie de Roland en apprenant que son lieutenant n'est pas mort. - Rastalet est fait prisonnier. - Son exécution. - De Broglie, reconnu incapable, est remplacé dans son commandement par un maréchal de France. Les protestants du Vivarais, qui n'avaient pas pris part au soulèvement de leurs frères cévenols, commençaient à s'émouvoir de toutes les nouvelles qui leur arrivaient du bas Languedoc, une certaine fermentation se faisait sentir parmi eux. Roland crut le moment propice pour appeler ses frères vivaraisiens aux armes, et chargea Cavalier de cette mission importante. Celui-ci, avec plus d'ardeur que de prudence, quitta les environs de Nîmes, franchit le Gardon et la Cèze, et rencontra à Vagnas, petit village situé à une lieue au nord de Barjac, le jeune comte du Roure et le vieux baron de Lagorce, chacun à la tête d'une compagnie. Le combat s'engagea : pris entre deux feux, Cavalier, avec son sang-froid ordinaire, fit face à l'ennemi, le culbuta et le poursuivit jusqu'aux bords de l'Ardèche. Parmi les morts se trouva le baron de Lagorce, dont les restes furent portés dans son manoir de Salavas. Cavalier fut obligé de ramener sa troupe à Vagnas parce que le passage de l'Ardèche était, dans ce moment, impraticable à cause d'une crue extraordinaire survenue la veille. Il attendait le moment propice pour revenir sur ses pas, quand Julien, que le comte du Roure avait appelé à son secours, accourut de Lussan à marches forcées et contraignit Cavalier à accepter la bataille. La position du jeune chef était des plus critiques : ses soldats étaient fatigués, la retraite impossible ; combattre vaillamment contre des troupes fraîches et supérieures en nombre était la seule ressource qui lui restait ; il donna donc ses ordres en homme qui a mesuré le danger qu'il court et qu'il ne peut conjurer que par une audace surhumaine ; le choc commença, il fut rude des deux côtés; les Camisards soutinrent leur réputation de bravoure ; mais vains efforts ! ils luttaient contre l'impossible, leur défaite fut complète. Ils laissèrent sur le champ de bataille tous leurs bagages et plus de deux cents de leurs vaillants compagnons. Julien se débarrassa de ceux qui furent faits prisonniers, en leur faisant casser la tête. Une forêt servit de refuge aux vaincus ; Ravanel et Catinat sauvèrent à grand'peine les débris de l'armée camisarde, qu'ils conduisirent, à travers mille périls, sur les bords de la Cèze, qu'ils traversèrent à la nage vis-à-vis de Rochegude. Le brave Espérandieu, le lieutenant le plus expérimenté de Cavalier, se noya. Catinat et Ravanel le regrettèrent vivement ; mais ils pleurèrent plus encore leur jeune chef : ils l'avaient cherché dans la forêt et appelé par son nom ; il n'avait pas répondu ! nul de leurs compagnons de fuite ne pouvait donner de ses nouvelles, ils l'avaient vu seulement combattant dans les rangs pressés des ennemis ; plus de doute, il était mort. Quand ils eurent passé la Cèze, grossie par la fonte des neiges, de nouveaux périls les attendaient. Les milices royales occupaient toute la contrée qui s'étend de Rochegude à Bouquet ; il fallut, en quelque sorte, se frayer un passage à travers une forêt d'ennemis ; mais ces deux hommes ne craignaient rien, ne redoutaient rien ; ils ne pensaient pas au danger qui les attendait à chaque pas qu'ils faisaient en avant, mais à leur jeune chef qu'ils regrettaient comme ils auraient regretté leur fils le plus tendrement aimé. « En avant ! » criait Ravanel à ses braves compagnons chaque fois qu'un nouvel ennemi se présentait, et, à sa voix, on se précipitait sur les milices royales, à travers lesquelles on se frayait un passage. Vingt fois il se trouva en leur présence et vingt fois il les culbuta. Ce ne fut qu'à Bouquet qu'il fut en sûreté ; il crut que Cavalier était mort ! et transmit à Roland la fatale nouvelle. Le chef des enfants de Dieu pleura son jeune lieutenant comme David Jonathan. Trop grand pour être jaloux de l'homme dont la gloire éclipsait presque la sienne, il ne vit que la perte immense que sa mort allait faire à la cause qu'ils servaient tous les deux avec tant de désintéressement. Il le pleurait donc, quand il apprit que son jeune ami n'était pas mort. Roland laissa éclater sa joie; il ne pensa plus à la victoire de Julien ; son jeune ami lui était rendu ! Pendant le combat de Vagnas, la vie de Cavalier courut de grands dangers, et il n'évita la mort que par des traits d'audace inouïs ; poursuivi dans la forêt par deux grenadiers acharnés à sa poursuite comme deux limiers, il sent qu'il est perdu, quand tout à coup il s'arrête et brûle d'un coup de pistolet la cervelle à l'un, l'autre, épouvanté, prend la fuite et le laisse continuer sa route dans le bois. Après quelques moments de marche, il rencontra quatre de ses soldats qui le croyaient mort ; avec eux, il s'entoile dans la forêt battue en tout sens par les soldats de Julien ; il entendit le bruit de leurs pas; il était perdu, si, dans ce moment, il n'eût pas découvert, au fond d'une touffe de buissons, une caverne dans laquelle il se blottit avec ses Camisards. La neige qui tombait devait, à vues humaines, les faire découvrir, elle fut leur salut ; elle avait effacé la trace de leurs pas, quand ceux qui les poursuivaient passèrent devant la caverne. Le lendemain, un peu avant le jour, ils sortirent de leur retraite et cherchèrent à s'éloigner de Vaguas ; quel ne fut pas leur étonnement, ils s'en étaient rapprochés ! Arrivés à la lisière du bois, ils aperçurent les ennemis qui dépouillaient et ensevelissaient les morts ; tout aussitôt ils rebroussèrent chemin et trouvèrent à quelque distance une métairie où ils entrèrent en demandant à la fermière de leur donner un guide pour les conduire à Barjac ; celle-ci les regarda d'un air étonné et dit à voix basse quelques mots à un jeune garçon ; celui-ci jeta un regard significatif sur Cavalier et sur ses compagnons et partit comme un éclair. Cette scène muette n'échappa pas à Cavalier. « Partons ! dit-il à ses camarades, il y a là- dessous une trahison ,» et ils sortirent de la ferme. Cavalier, qui jusqu'à ce moment de sa vie avait regardé vingt fois la mort sans que son cœur battit une pulsation de plus, en eut peur ; cette mort qui l'effrayait n'était pas celle qu'on trouve sur un lit de douleur ou sur un champ de bataille, mais celle qu'on reçoit par la main du bourreau sur un échafaud ; son imagination vive, prompte, lui retraça en traits brûlants la fin ignominieuse qui l'attendait ; il tremblait de tous ses membres ; mais il eut assez de force d'âme pour cacher ses terreurs à ses compagnons. « Frères, leur dit-il d'une voix solennelle et mélancolique, si Dieu veut que nous mourions, mourons ; mais, en mourant, consolons-nous par la pensée de la justice de notre cause ; nous avons combattu pour la liberté contre le despotisme, pour Dieu contre les hommes. » A la fin de cette journée pleine d'anxiétés, ils aperçurent, à la nuit tombante, une lumière qui brillait dans l'obscurité; ils se dirigèrent vers elle et se trouvèrent en face d'une pauvre masure isolée. « Ouvrez ! » cria Cavalier d'un ton impérieux. Un vieillard se présenta à la porte. « Nous avons faim, lui dit Cavalier; donne-nous à manger. » Le paysan lui donna ce qu'il avait : du pain noir, des œufs, des châtaignes. Nos Camisards firent un repas délicieux. Le vieillard prit son bâton noueux et les conduisit jusqu'à Saint-Jean de Marvejols. Cavalier le remercia cordialement ; solda royalement son hospitalité, et se dirigea vers la Cèze. Il traversa avec ses compagnons le torrent à la nage, trouva sur les bords trente hommes, débris de son armée, et continua avec eux sa route dans la direction de Bouquet ; il était épuisé de fatigue, ses pieds étaient ensanglantés ; il se traînait plutôt qu'il ne marchait. « Frères, dit-il à ses soldats, poursuivez votre route, quant à moi, je ne puis aller plus loin ; je connais à Bouquet une femme qui me donnera l'hospitalité. » Il leur dit adieu et se dirigea vers sa demeure ; à sa vue, la vieille huguenote poussa un cri de joie : elle le croyait mort. Heureuse et fière de recevoir sous son humble toit le vaillant défenseur de son peuple opprimé, elle alluma un bon feu, pansa ses plaies et lui servit un excellent repas. Bientôt après Cavalier goûtait, dans le lit qui lui avait été préparé, un sommeil profond, quand, vers le matin, son hôtesse, en ouvrant sa porte, trouva un soldat qui montait la garde devant sa maison ; effrayée, elle la ferma, et, s'approchant du lit de Cavalier : « Frère, lui dit-elle d'une voix basse et tremblante, vous êtes découvert, » et elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Cavalier, une seconde fois, ressentit toutes les angoisses de la mort. Dans ce moment, le commandant des milices royales poussa la porte. A sa vue, la vieille huguenote se mit à trembler de tous ses membres. « Qui vous fait trembler ? - La fièvre, Monseigneur. - Pauvre femme ! » dit le commandant en se retirant. Cavalier était sauvé ! le soir du même jour il partait et arrivait à Vézenobres, chez son ancien maître Lacombe, d'où il envoyait à Roland un émissaire pour lui apprendre sa merveilleuse délivrance. Moins heureux que lui, Rastalet, l'un de ses plus braves lieutenants, fut fait prisonnier à Vagnas par Julien, qui le livra au bourreau ; il fut rompu vif à Alais, le 4 mars. Il mourut en vrai Camisard, sans orgueil ni faiblesse. Bâville, qui s'était réjoui de la défaite de Vagnas et en attendait les plus heureux résultats pour la fin de l'insurrection, fut trompé encore une fois dans son attente. Les chefs camisards, hardis comme des lions, devenaient de jour en jour plus menaçants : vaincus la veille, ils étaient vainqueurs le lendemain. Les catholiques, épouvantés, poussèrent un cri de détresse qui retentit jusqu'à Versailles ; la cour rappela Broglie et lui donna pour successeur un maréchal de France.  La tour de Belot, près Bagars CHAPITRE X
Arrivée du maréchal de Montrevel à Nîmes. - Combat du Mas de Serrières ; défaite et bravoure de Ravanel. - Montrevel et ses mesures de répression. - Leur inutilité. - Roland et Cavalier. - Prodiges de valeur et d'habileté des deux chefs. - Les cadets de la croix. - Leur origine; leurs cruautés. - L'Hermite, leur chef. - Détails sur ce scélérat. - La bulle du pape ; elle pousse les catholiques à de nouveaux excès. - Représailles terribles des Camisards. - Mariage de Castanet. - Massacre d'une assemblée religieuse à Nîmes. - Froide cruauté de Montrevel. - Indignation des protestants. - Combat de la Tour de Bellot. - Courage et défaite de Cavalier. Le militaire qui succédait à M. de Broglie appartenait à l'illustre et noble famille de la maison La Baume Montrevel ; il naquit, en 1546, dans la Franche-Comté, et se voua à la carrière des armes, où il fit rapidement son chemin, moins par son habileté que par son tact de parfait courtisan. Montrevel aimait son métier, mais il était plus soldat que capitaine ; et là où la cour aurait dû envoyer un diplomate fin et délié, elle envoya un dragon ; au lieu d'éteindre l'incendie, elle l'attisa. Montrevel fut reçu avec transport par le clergé, qui ne douta pas de la défaite des Camisards, quand à la tête des troupes royales il vit un maréchal de France résolu d'étouffer l'insurrection dans le sang des insurgés. Montrevel, en arrivant dans le Languedoc, ne s'était pas fait rendre un compte exact des causes de la révolte et de la disposition des esprits. Son mépris des chefs cévenols, dans lesquels il ne voyait que de misérables pâtres, braves sans doute, mais inexpérimentés dans l'art de la guerre, était si grand qu'il regardait comme un déshonneur de les rencontrer sur un champ de bataille. Il devait cependant apprendre à ses dépens que ces pâtres des Cévennes ne le cédaient en rien aux premiers soldats du monde, et que leurs chefs avaient un coup d'œil que les maîtres dans l’art de la guerre auraient admiré. Peu de jours après son arrivée, Ravanel était campé près de Nîmes, au Mas de Serrières, où il espérait faire reposer deux jours ses soldats fatigués. À peine campés, ils aperçurent le maréchal, à la tête d'une forte compagnie, qui s'avançait à pas accélérés vers eux. « Enfants ! » leur cria Ravanel, « à vos armes et en avant » et donnant lui-même l'exemple, il s'élança, suivi de sa troupe, sur les milices royales, dont il fendit les rangs, et qui, témoins de cette charge brillante, admirèrent le guerrier camisard qui joncha la terre de leurs morts. La lutte, malgré le courage surhumain des enfants de Dieu, n'était pas possible ; Ravanel le vit, et avec un sang-froid admirable, il donna le signal de la retraite ; il recula, mais comme recule le lion. Montrevel comprit, après sa victoire si chèrement achetée, qu'il ne détruirait pas les insurgés aussi facilement qu'il l'avait pensé, et désespérant peut-être de les vaincre sur un champ de bataille, il demanda à des mesures d'extermination ce qu'il aurait dû demander à son habileté. La cour, qui désirait voir la fin de cette guerre qui l'affaiblissait au dedans et la déconsidérait au dehors, accorda à Montrevel une partie des pouvoirs qu'il lui demandait, mais pas tous ; ce qu'il voulait, c'était le régime de la terreur, le seul moyen, à ses yeux, d'éteindre l'insurrection dans son foyer. La guerre était partout dans les Cévennes ; les insurgés, qui avaient une parfaite connaissance des lieux, savaient profiter des moindres accidents de terrain, soit pour une attaque, soit pour une retraite. Disséminés en petites bandes, la défaite d'un chef n'avait qu'une importance secondaire, et Montrevel devait le lendemain recommencer le travail de la veille. Les Camisards qu'il tuait étaient aussitôt remplacés ; quand l'un tombait, un autre prenait sa place, heureux, comme ses devanciers, de mourir pour la même cause. Cavalier et Roland étaient l'âme du mouvement insurrectionnel ; le premier lui donnait l'élan, le second lui imprimait l'ordre; vainqueurs ou vaincus, ils ne désespéraient jamais ; chaque jour était marqué ou par un combat, ou par une surprise, ou par une escarmouche ; aujourd'hui tel village ouvrait ses portes aux Camisards, tel autre les chassait de son enceinte. Montrevel faisait pendre les Cévenols sans forme de procès, brûler leurs fermes ; les Camisards brûlaient des clochers, incendiaient des églises, et tuaient quelquefois des prêtres ; c'était une guerre de guérillas, rendue, des deux côtés, cruelle par le fanatisme religieux, le pire de tous. Dans cette lutte, petite eu égard au nombre des combattants, mais grandiose par leur bravoure, la noblesse protestante joua un rôle honteux ; elle n'eut pas le courage de combattre pour la sainte cause pour laquelle des pâtres et des laboureurs versaient leur sang sans pousser un murmure; barricadée dans ses châteaux, elle voyait passer le danger et maudissait ces paysans qui troublaient son repos. Montrevel la redoutait ; il avait tort, car elle n'eut jamais le courage de brûler une amorce. Si cela eût été en son pouvoir, elle lui aurait livré, comme gage de sa fidélité, la tête des chefs camisards. Nous sommes peut-être sévère à son égard ; mais les faits sont là pour proclamer hautement que, si le protestantisme n'avait eu pour le défendre que l'épée de ses gentilshommes, la foi huguenote eût été extirpée du sol français. Gloire donc aux hommes grossiers qui nous l'ont conservée; c'est à eux que nous devons le bonheur de n'être pas des descendants de nouveaux convertis. Au point où nous sommes arrivé de nos récits, nous voyons apparaître quelques figures sinistres, produits ordinaires des temps où les droits sociaux, religieux et politiques sont foulés aux pieds. Des bas-fonds de la société bouleversée monte alors une vase qui vient à la surface et se transforme en écume impure ; c'est l'heure de ces hommes à physionomie sinistre, destinés à jouer pendant quelques heures un rôle dans le grand drame de la vie humaine, hommes qui s'appellent, aux jours de la Ligue, Maillard, Boucher, Jacques Clément ; à ceux de 1793, Hébert, Chaumette, Marat ; à ceux de 1815, Trestaillon ; ils s'appelaient, à l'époque de la guerre des Camisards, les cadets de la croix. Les cadets de la croix étaient des paysans catholiques qui, heureux de profiter de l'état d'anarchie dans lequel était le Languedoc, se livraient au meurtre et au brigandage. Ils tiraient leur nom d'une croix qu'ils portaient cousue à leur habit ; ils avaient quatre chefs, dont l'un, connu sous le nom de l'Hermite, est demeuré célèbre dans l'histoire des Camisards : c'était un gentilhomme dauphinois, nommé Fayolle ; après avoir vécu longtemps dans la débauche, il s'était retiré dans un désert, près de Sommières, pour y faire pénitence ; il y vivait en odeur de sainteté sous le nom de frère François-Gabriel, lorsque éclata l'insurrection cévenole, les Camisards brûlèrent son ermitage. A la vue des flammes qui consumaient sa retraite, saisi d'une violente colère, il dit : « Je me Vengerai ! » Sans perdre un instant, il se rendit auprès de Fléchier, qui l'encouragea dans ses desseins; il se mit à la tête d'une bande de paysans qui infestaient la contrée et offrit à Montrevel ses services. Le maréchal qui, dans une vie de débauche, avait perdu tout tact moral, les accepta, et bientôt après, frère Gabriel, à la tête de sa bande, se mit à parcourir les villages protestants et fit la guerre en assassin et en voleur de grand chemin. Ses cruautés révoltèrent même les catholiques; les états du Languedoc rougirent de ses services, et des voix accusatrices s'élevèrent contre lui ; Fléchier seul osa prendre la défense de ce bandit fatigué, mais jamais lassé d'assassiner. Un nouvel auxiliaire, le pape, se joignit à Montrevel pour raider à exterminer les protestants cévenols. Le pontife ne voulut voir dans, les Camisards que des meurtriers et des incendiaires, indignes de la commisération de Dieu et des hommes ; oubliant l'exemple donné par le Christ, du haut de la croix, il ne laissa tomber, du haut de son Vatican, que des paroles de malédiction ; trop fidèle à l'esprit intolérant et persécuteur de son Église, il lança une bulle dans laquelle il ordonnait aux catholiques d'exterminer les Camisards et leur promettait le ciel en échange de leurs sanglants exploits. « Nous ne pouvons exprimer, disait le pontife, de quelle douleur nous avons été pénétré quand nous avons appris, par l'ambassadeur du roi très-chrétien, que les hérétiques des Cévennes, sortis de la race exécrable des anciens Albigeois, ont pris les armes contre l'Église de leur souverain. C'est pourquoi, dans le dessein d'arrêter, autant qu'il est en nous, les progrès si dangereux et toujours renaissants de l'hérésie, à laquelle il semblait que la piété de Louis le Grand eût porté le dernier coup dans ses États, nous avons cru devoir nous conformer à la conduite de nos prédécesseurs dans de pareils cas. À ces fins, et pour porter à engager les fidèles à exterminer la race maudite de ces hérétiques et de ces méchants ennemis de tous les siècles de Dieu et de César, en vertu du pouvoir de lier et de délier, accordé par le Sauveur des hommes au prince des apôtres et à ses successeurs, nous déclarons et nous accordons, de notre pleine puissance et autorité, la rémission absolue et générale de leurs péchés à tous ceux qui s'engageront dans la sainte milice qui doit être formée, et destinée à l'extirpation de ces hérétiques et de ces rebelles à Dieu et au roi, et qui auraient le malheur d'être tués dans le combat ; et afin que nos intentions à ce sujet soient connues et rendues publiques, nous ordonnons que notre bulle, donnée sous le sceau du pécheur, soit imprimée et affichée aux portes de toutes les églises de votre diocèse. Donné à Rome, le 1er mai de l'an de notre Seigneur 1703, et le premier de notre pontificat. » (1) (1). Mémoires de Cavalier. - Nap. Peyrat. - Court. Les évêques du Languedoc firent parvenir la bulle à leurs curés. « Vous ne donnerez aux fanatiques, leur disaient-ils, ni assistance, ni secours ; vous ne leur fournirez ni vivres, ni provisions ; vous les poursuivrez par le feu et par l’épée ; ceux qui s'acquitteront de ce devoir, comme il convient à des soldats de l'Église et du roi, recevront indulgence plénière, comme est il porté dans la bulle. » Quand la bulle parvint, par l'intermédiaire de Fléchier, aux curés, la lutte entre les deux partis était engagée avec un acharnement qui avait atteint ses dernières limites ; néanmoins, les curés, comme s'il n'y avait pas assez de sang répandu, s'empressèrent à l'envi de la lire du haut de leur chaire; interprètes trop fidèles de la haine du pontife romain, ils prêchèrent la guerre sainte, et firent, à leur manière, un tableau des plus hideux de ces Cévenols que leurs froides cruautés avaient jetés dans l'insurrection, et ces mêmes hommes qui tenaient un si horrible langage, le faisaient sans que leur conscience s'élevât en accusateur contre eux ; dans leur aveugle fanatisme, ils croyaient servir la cause de Dieu, et du sang versé de leurs frères dissidents, se composer une rançon pour leurs péchés ! Les Camisards répondirent aux malédictions du pape en volant à de nouveaux combats ; chaque jour apprenait aux catholiques qu'il était plus facile de les maudire que de les vaincre. Avec la rapidité de la flèche, Cavalier et les autres chefs se transportaient partout où il y avait un convoi à saisir, un bourg à prendre, un détachement à détruire ; leurs succès leur donnaient une audace extraordinaire ; une poignée de paysans tenait en échec un maréchal de France. Montrevel était furieux ; il s'agitait dans son impuissance ; ses adversaires étaient partout, et nulle part il ne trouvait un champ de bataille pour les écraser et en faire le tombeau de l'insurrection. Au milieu de ces scènes qui se renouvelaient chaque jour et ensanglantaient le sol de la patrie, nous sommes témoins d'un événement qui ne manque pas de poésie. Castanet, le garde forestier de l'Aigoâl, épris d'une grande affection pour une jeune Cévenole d'une rare beauté, l'avait demandée en mariage ; celle-ci, séduite par la bravoure de l'intrépide lieutenant de Cavalier, n'avait pas hésité à accepter pour époux un homme dont la vie était sans lendemain et qui paraissait fatalement destiné à périr sur un champ de bataille ou sur un échafaud. Leurs noces se célébrèrent avec beaucoup de solennité ; les soldats et les amis de l'époux assistèrent au mariage : on but, on s'égaya, on chanta des psaumes, on alluma des feux de joie. Le lendemain de son mariage, le chef camisard était debout sous les armes, et lui qui jusqu'à ce moment avait frappé sans pitié ses prisonniers catholiques, pour la première fois les épargna. Vingt-cinq d'entre eux, à leur retour de la foire de Beaucaire, avaient été faits prisonniers ; tremblants, ils attendaient la mort, quand Castanet leur dit : « Je vous donne la vie ; mais rappelez-vous que ce n'est pas à moi que vous la devez, mais à ma femme. » L'amour qu'il avait pour elle le rendait heureux ; quand on est heureux, on est rarement cruel. L'épouse de Castanet s'appelait Mariette ; les catholiques, par dérision, la surnommèrent la princesse de l'Aigoâl. Montrevel ne traitait pas ses prisonniers comme Castanet, rarement ils échappaient de ses mains ; des cachots de Bâville à ses potences il n'y avait qu'un pas. Les huguenots mouraient avec courage et ajoutaient quelques confesseurs de plus à la liste glorieuse de leurs martyrs. Ils pleuraient sous la croix ; mais un jour ils poussèrent un cri de colère à la vue d'un assassinat dont Nîmes a conservé et conserve encore le douloureux souvenir. Le besoin de prier en commun est une nécessité si impérieuse de notre nature religieuse qu'elle faisait braver aux Cévenols protestants les dangers qui les menaçaient quand il s'agissait d'assister à une assemblée. Ce fut le besoin de s'édifier, qui conduisit, le dimanche des Rameaux (1703), des protestants nîmois dans une maison du faubourg des Carmes. La réunion se composait de femmes, de vieillards, d'enfants, tous inoffensifs ; leur seul crime était d'avoir osé former une assemblée contre l'ordre exprès du roi. Ils étaient réunis depuis à peine quelques instants, quand la nouvelle en arriva à Montrevel ; furieux, il se leva de table, et suivi d'une compagnie de soldats, il se dirigea vers la maison où les protestants célébraient paisiblement leur culte. Au signal qu'il donna, les dragons enfoncèrent la porte, et alors commença une affreuse boucherie : c'est en vain que femmes, enfants, vieillards tendent leurs mains suppliantes vers les assassins, ils sont sans pitié; comme ils ne fonctionnaient pas assez vite au gré du maréchal, il leur cria : « Mettez le feu au moulin ! » en un instant l'abattoir devient bûcher ; les victimes remplissent l'air de leurs cris douloureux, et celles qui cherchent à s'échapper de cette fournaise ardente, tombent immolées à la porte par le glaive d'un dragon préposé à cet office sinistre. Une jeune fille, aidée par le valet de chambre de Montrevel, s'échappe. Le maréchal ordonne immédiatement qu'on la saisisse et qu'on la mette à mort, ainsi que son libérateur ; les cris, les larmes, les supplications de la jeune huguenote ne touchent point Montrevel, elle tombe percée de coups sous ses yeux; son valet de chambre va subir le même sort ; il n'échappe à une mort certaine que grâce à l'intervention de religieuses qui intercèdent pour lui; mais le maréchal le chasse de sa maison : il ne veut pas pour serviteur un homme qui ose montrer de la compassion pour une misérable huguenote rebelle à son roi. La Vapeur du sang grise comme celle du vin. Montrevel était ivre : il ne savait ni ce qu'il faisait, ni ce qu'il disait ; il entend du bruit, non loin de son sanglant champ de bataille : il croit que ce sont des huguenots échappés du massacre : « Tuez ! » dit-il à ses soldats; ceux-ci obéissent, le massacre commence. « Nous sommes catholiques ! » s'écrient les victimes ; cris impuissants, elles sont immolées. C'étaient des catholiques qui s'étaient rendus dans un jardin pour se divertir pendant que les huguenots avaient pris le chemin du moulin pour s'édifier ; on reconnut l'erreur, c'était trop tard. Après son expédition, Montrevel regagna son hôtel et reprit tranquillement son repas interrompu. Le lendemain, la maison qui avait servi de lieu de réunion fut démolie jusque dans ses fondements : de dessous de ses décombres fumants on retira quatre-vingts cadavres ! Fléchier, qui aurait pu entendre, du fond de son palais épiscopal, le cri des victimes, ne trouva pas une seule parole pour flétrir un acte qui marquait au front, du signe de Caïn, son Église; il les insulta. « Ils ont osé même, dit-il dans une lettre pastorale, se réunir le dimanche des Rameaux pendant que nous chantions vêpres ! » Faire un prêche et chanter des psaumes était, aux yeux de l'évêque, un crime digne de mort ; Montrevel l'assassin lui apparut comme un nouveau Macchabée. Ce crime, aussi lâche qu'inutile, porta des fruits sanglants et donna lieu à de terribles représailles. Les Camisards poussèrent un cri de fureur et firent expier durement aux catholiques les atrocités du maréchal ; ce n'était plus la guerre comme elle se fait entre nations civilisées, c'était, des deux côtés, le meurtre, le massacre, la tuerie ; protestants et catholiques étaient sous le poids de la terreur ; rien à l'horizon n'annonçait la fin de cette guerre sauvage. Cavalier, en apprenant le massacre de Nîmes, frappa plusieurs villages à la façon de l'interdit : il rendait à Montrevel œil pour œil, dent pour dent; il voulait le forcer, par des représailles qui n'étaient pas dans sa nature généreuse, à faire la guerre en soldat et non en assassin. Alarmé des succès du jeune chef, le maréchal mit Julien à sa poursuite; celui-ci le surprit entre Anduze et Alais, dans un moulin dit la Tour de Belot, où il se reposait avec ses soldats de ses fatigues. Au premier coup de feu, signal de l'attaque, Cavalier et sa troupe se réveillent en sursaut et sautent sur leurs armes ; le danger est grand : Cavalier le mesure d'un regard calme et froid; il donne ses ordres avec netteté et précision ; il sait que chaque Camisard fera son devoir et que le salut de chacun dépendra de son audace. La nuit couvre de son voile funèbre cette scène terrible, mais grandiose. Si les assiégés font des prodiges de valeur en se défendant, les assaillants en font en attaquant ; ils savent que Cavalier est dans la tour : quelle gloire pour Julien s'il peut l'amener mort ou vif â Montrevel ! Du geste et de la voix, il indique à ses soldats l'endroit par lequel il faut pénétrer dans la tour ; ils s'y précipitent, malgré un feu meurtrier qui éclaircit leurs rangs. Des deux côtés ce sont des cris confus qui troublent d'une manière terrible le calme imposant de la nuit. Au milieu de ce tumulte indescriptible, Cavalier conserve, avec toute son ardeur, tout son sang-froid. Il veut, comme un flot impétueux, sortir avec toute sa troupe, par la porte de la tour, et se frayer un passage à travers les rangs pressés de ses ennemis; mais la porte est trop étroite, si étroite que ce serait courir à une mort certaine que de le tenter. C'en était fait de lui et de ses braves Camisards, s'ils ne fussent parvenus à renverser un mur en pierres sèches. Un passage étroit d'abord, mais qui rapidement s'élargit, offre aux assiégés une issue ; ils s'y précipitent, le sabre à la main, et se font jour à travers des masses pressées d'ennemis. Cavalier était sauvé, mais il avait perdu plus de deux cents hommes. Julien, maître de la tour, avait acheté chèrement sa victoire : en quelques heures, plus de quatre cents de ses soldats étaient tombés frappés mortellement par les Camisards, et Cavalier, qu'il avait cru un moment prendre mort ou vif, s'était échappé. Montrevel, dont la joie eût été complète, si on lui eût amené, chargé de chaînes, le jeune chef, augura cependant bien de l'avenir. De plus en plus cruel, il rendit la position des protestants cévenols intolérable, et il fut à la lettre l'exacteur implacable de Louis XIV. CHAPITRE XI
Montrevel quitte Nîmes et fixe sa résidence à Alais. - La guerre recommence avec plus de violence. - Le baron de Salgas. -Détails biographiques sur ce célèbre personnage. - Son arrestation ; sa condamnation aux galères à perpétuité. - Salgas sur son banc de forçat. - Lâche et cruelle curiosité des évêques de Montpellier et de Lodève. - Leçon méritée que leur donne le commandant .de la galère. - Délivrance de Salgas. - Sa mort. - La condamnation de Salgas suivie d'autres condamnations. - Exaspération des Camisards. - La guerre est une guerre d'extermination. - Clary. - Scène étrange et extraordinaire qui se passe dans le camp de Cavalier. - Elle donne aux Camisards une grande confiance dans la protection de Dieu. - Mariette, l'épouse de Castanet, est faite prisonnière. - Douleur de Castanet. - Moyen violent et ingénieux de délivrer son épouse. Montrevel, qui avait cru que sa seule présence mettrait fin à l'insurrection, quitta Nîmes au mois de juin 1703, et fixa sa résidence à Alais. De cette ville, il lançait ses troupes dans toutes les directions à la poursuite des Camisards. Un jour elles conduisirent devant lui un vieillard : c'était le célèbre et infortuné baron de Salgas ; il n'avait pas pris part à l'insurrection ; renfermé dans son vieux manoir des Rousses, il regardait passer l'orage, soupirant après le moment où les Camisards déposeraient les armes. Les insurgés aimaient le baron, malgré sa pusillanimité, et quoiqu'il eût, à l'époque des dragonnades, abjuré sa foi religieuse. Homme de race noble et antique, il ne s'était pas montré, comme beaucoup d'autres gentilshommes cévenols, arrogant, dur, hautain envers ses vassaux ; bon, généreux, humain, son seul défaut était la faiblesse de son caractère, qui une première fois le rendit apostat, et une seconde fois le porta à offrir à Montrevel ses services contre ses coreligionnaires. Il avait été invité à faire cette honteuse démarche, après avoir été contraint à assister, le 11 février 1703, à une assemblée religieuse ; il craignit d'être dénoncé. Le maréchal le remercia de ses services et l'engagea à retourner dans ses domaines et à user de son influence auprès des Camisards pour les ramener à l'obéissance. Le baron obéit, et grâce à ses efforts, deux de leurs chefs déposèrent les armes. Bientôt après, il fut mandé à Nîmes par Montrevel. La crainte de tomber dans un piège le retint dans son manoir ; le maréchal le fit arrêter et jeter en prison. Ce gentilhomme, qui jusqu'alors n'avait pas eu le courage de sa foi, devint tout à coup un autre homme ; esclave, quand il était libre, il devint libre quand il eut les fers aux pieds. Il releva noblement la tête et ne songea pas, par la lâcheté d'une nouvelle apostasie, à racheter ses jours en danger. Assis sur la sellette des accusés, il présenta sa défense, et eût infailliblement gagné sa cause, si dans chacun de ses juges il n'avait pas eu un accusateur. Montrevel aurait bien voulu le faire décapiter sur un échafaud ; il ne le put ; mais il fit rendre à Alais, le 27 juin 1703, un arrêt, par lequel l'infortuné gentilhomme était dégradé de sa noblesse, privé de ses biens, et condamné aux galères à perpétuité. Les Camisards, qui avaient suivi avec un vif intérêt la marche du procès, touchés du courage du baron, résolurent de l'enlever de vive force à ses bourreaux. Montrevel découvrit leur projet et le déjoua. Sous bonne escorte il fit conduire Salgas à Cette. À peine arrivé, on le dépouilla de ses habits et on le revêtit de la casaque des forçats ; pour demeure, on lui donna une galère, et pour lit, un banc auquel il était attaché par une chaîne. Le vieillard ne poussa pas une plainte, il se laissa faire, et, retrempant son âme dans le malheur, il porta ses regards plus haut que cette terre, et fit la douce expérience que Dieu ne tient pas rigueur aux cœurs repentants, et que de tous les honneurs qu'il peut leur faire, le plus grand est celui de souffrir pour son saint nom. Franchissant par la pensée les jours qui le séparaient de celui où, traversant le Jourdain, il apercevrait le Canaan céleste, il tressaillait de joie ; comme saint Paul, il sentait que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui est à venir. Le vieillard sanctifiait par sa présence les galères, alors la demeure d'un grand nombre de confesseurs de Jésus-Christ ; ses geôliers, que l'habitude de voir souffrir et de faire souffrir avait rendus insensibles, se sentirent émus à la vue d'une si grande infortune si noblement supportée, ils ne lui parlèrent qu'avec respect et le dispensèrent du travail rude et pénible de la rame. Deux prélats, l'évêque de Montpellier et celui de Lodève, étant venus à Cette, voulurent se donner la joie de voir le vieillard faire l'exercice. « Faites-le ramer, » dirent-ils au capitaine de la galère. Celui-ci fait un signe au baron qui comprend; silencieusement il saisit une rame, et, de ses bras défaillants, il en frappe trois fois les eaux; les prélats rient aux éclats en se montrant l'infortuné galérien. C'est fête à eux de voir un gentilhomme huguenot, qui n'a pas voulu abjurer sa foi, ramer comme le plus vil forçat. Le capitaine, justement indigné de leur froide cruauté, dit à haute voix : « Assez ! baissez les armes.» La manière dont il prononça ces mots fut comprise ; la leçon était rude, mais elle était méritée : le plaisir que s'étaient voulu donner les deux évêques était celui des lâches. Salgas vieillit sur son banc de douleur ; il y serait mort probablement si la vie de Louis XIV s'était prolongée de quelques mois ; la mort seule du despote sonna l'heure de sa délivrance (1er sept 1715). Après treize ans de souffrances, Salgas vit rompre ses chaînes, et se rendit à Genève, où il retrouva son épouse. L'année suivante il mourut, laissant en héritage à ses frères, qu'il avait abandonnés aux jours de sa prospérité, le souvenir de son héroïque constance dans le malheur. La condamnation du baron fut suivie d'un grand nombre d'autres ; elles exaspérèrent les Camisards et jetèrent la consternation au milieu de la petite noblesse et de la bourgeoisie protestantes. Le Languedoc était hors la loi ; on attentait à la liberté individuelle sans raison ; on condamnait sans entendre ; les haines se ravivaient au lieu de s'apaiser, et pendant que les prêtres maudissaient les insurgés comme des démons vomis de l'enfer, ceux-ci les regardaient comme des prêtres de Bahal et se croyaient le peuple de Dieu. Un grave événement qui se passa à cette époque les fortifia dans cette assurance et leur donna des forces pour lutter contre leurs ennemis si supérieurs en nombre. Un jour, (raconte Maximilien Misson dans son Théâtre sacré des Cévennes), que Cavalier avait tenu une assemblée, joignant les Tuileries de Cannes, proche de Serignan, après les exhortations, la lecture et le chant des psaumes, Clary (1), qui avait, reçu des grâces excellentes et dont les révélations fréquentes étaient, avec celles de Cavalier, les guides ordinaires de la troupe camisarde, fut saisi de l'Esprit au milieu de l'assemblée. (1). MM. Haag écrivent Claris ; A. Court écrit Clary. - Prophète, né à Quissac, mort sur la roue à Montpellier, le 25 octobre 1710. Ses agitations furent si grandes que tout le monde en fut ému. Lorsqu'il commença à parler, il dit plusieurs choses touchant les dangers auxquels les assemblées des fidèles se trouvaient ordinairement exposées, ajoutant que Dieu était celui qui veillait sur elles, et qu'il les gardait. Ses agitations augmentèrent, l'Esprit lui fit prononcer à peu près ces mots : « Je t'assure, mon enfant, qu'il y a deux hommes dans cette assemblée qui n'y sont venus que pour vous trahir ; ils ont été envoyés par vos ennemis pour épier tout ce qui se passe entre vous, et pour en instruire ceux qui leur ont donné cette commission ; mais je te dis que je permettrai qu'ils soient découverts et que tu mettes toi-même la main sur eux. » Tout le monde était fort attentif à ce qu'il déclarait, et alors ledit Clary, étant toujours dans l'agitation de la tête et de la poitrine, marcha vers l'un des traîtres, Jacques Durand, du lieu de Saint-Théodorite, et mit la main sur lui. Cavalier, ayant vu cela, ordonna à ceux qui portaient des armes d'environner l'assemblée de telle manière que personne n'en pût échapper. L'autre espion, Bos, dit le Chasseur, du lieu de Serignan, qui était à quelque distance, fendit la presse et vint auprès de son camarade, se jeter aux pieds de Cavalier en confessant sa faute et en demandant pardon à Dieu et à l'assemblée. L'autre fit la même chose, et tous deux dirent que leur extrême pauvreté avait été la cause qu'ils avaient succombé à la tentation, mais qu'ils s'en repentaient et qu'ils promettaient qu'avec l'assistance de Dieu, ils seraient à l'avenir fidèles, si on voulait leur donner la vie. Cependant, Cavalier les fit lier et commanda qu'on les gardât. Alors, l'inspiration de Clary continuant avec de grandes agitations, l'Esprit lui fit dire, à fort haute voix, que plusieurs murmuraient sur ce qui venait d'arriver, comme si la facilité et la promptitude avec lesquelles les deux accusés avaient confessé étaient une marque qu'il y avait eu de l'intelligence entre Clary et lui pour supposer un miracle. 0 gens de petite foi, dit l'Esprit, est-ce que vous doutez encore de ma puissance, après tant de miracles que je vous ai fait voir ? Je veux qu'on allume tout présentement un feu, et je te dis, mon enfant, que je permettrai que tu te mettes au milieu des flammes, sans qu'elles aient de pouvoir sur toi Sur cela, le peuple cria, et particulièrement les personnes qui avaient murmuré : - Seigneur, retire-nous le témoignage du feu! Nous avons éprouvé que tu connais les cœurs. Mais comme Clary insistait avec des redoublements d'agitation de tout son corps, Cavalier, qui ne se pressait pas trop dans une affaire de cette conséquence, ordonna, enfin, qu'on allât chercher du bois sec pour faire promptement un feu. Comme il y avait tout auprès de là des fourneaux à tuiles, on trouva dans un moment quantité de branches sèches de pin et de cet arbrisseau épineux qu'on appelle dans les Cévennes argealas. Ce même bois, mêlé de grosses branches, fut entassé au milieu de l'assemblée, dans un endroit un peu bas, de sorte que tout le monde était élevé tout autour. Alors Clary, qui avait ce jour-là une camisole blanche, se mit au milieu du tas de bois, se tenant debout, et levant les mains jointes au-dessus de la tête ; il était toujours dans l'agitation et parlait par inspiration. Toute la troupe en armes environnait l'assemblée entière, qui était en pleurs et en prières, les genoux en terre, faisant un cercle à l'entour du feu. La femme de Clary était là qui faisait de grands cris. Chacun vit Clary au milieu des flammes qui l'enveloppaient et qui le surmontaient de beaucoup. Il ne sortit du milieu du feu que quand le bois eut été tellement consumé qu'il ne se leva plus de flammes. L'Esprit ne l'avait point quitté pendant ce temps-là, qui fut d'environ un quart d'heure, et il parlait encore avec sanglots et mouvements de poitrine quand il fut sorti. Cavalier fit la prière générale pour rendre grâces à Dieu de la grande merveille qu'il avait daigné faire pour fortifier la foi de ses serviteurs. Je fus le premier, ajoute l'auteur auquel nous avons emprunté ce récit, à embrasser de digne frère Clary et à considérer son habit et ses cheveux que le feu avait tellement respectés qu'il était impossible d'en apercevoir aucune trace. Cet événement que nous rapportons moins en juge qu'en historien, donna à l'insurrection une force irrésistible; de tous les côtés on se rendait sous les drapeaux des chefs camisards; mourir en se défendant était mourir pour la plus juste et la plus sainte des causes; on courait aux combats comme aujourd'hui dans la Vaunage on court aux courses des taureaux. C'était une fête, et cependant quelle fête ! Sur un champ de bataille, on pouvait rencontrer la mort, jamais des fers. Les lois de la guerre étaient suspendues : on ne gardait pas ses prisonniers, on les passait par les armes ; le plus souvent on les pendait. Il n'était donc jamais, entre les parties belligérantes, question d'échange ; une fois seulement on fit exception à la règle. Mariette, celle que les catholiques appelaient par dérision la princesse de l'Aigoâl, tomba au pouvoir des soldats de Montrevel. À la nouvelle de sa capture, Castanet, qui avait pour Mariette la plus tendre affection, fut pris d'un violent désespoir. Il ne pouvait douter du sort qui attendait son épouse bien-aimée ; en effet, Montrevel se disposait à la livrer au bourreau pour qu'il la pendit, quand le chef cévenol, sans perdre une minute, réunit autour de lui ses braves Camisards. « Frères, leur dit-il, aidez-moi à sauver Mariette, » et au pas de course il les dirige sur Valleraugue, force ses portes et enlève une jeune femme, l'épouse d'un gentilhomme, familier de Bâville. Il lui dépêche en toute hâte un messager, porteur d'une lettre, dans laquelle Castanet lui apprend que sa femme est sa prisonnière, et qu'elle sera traitée comme le sera Mariette. Le gentilhomme va trouver l'intendant et le supplie, les larmes aux yeux, de rendre à Castanet son épouse, s'il veut que la sienne ne soit pas pendue ; ce n'est qu'à force d'instances qu'il obtient qu'on rende Mariette à la liberté. Ce fut le premier et le dernier échange de prisonniers qui eut lieu. CHAPITRE XII. Projet sinistre de Baville. - Dévastation des hautes Cévennes. - Exaspération des Camisards. - Exploits de Cavalier. - Caractère de la guerre des Camisards. - Les Camisards noirs. - Assassinat de Mme de Miraman. - Cavalier punit ses meurtriers. Bâville, voyant que l'insurrection prenait chaque jour de nouvelles forces, prit une résolution désespérée et digne de lui. « Faisons, dit-il, un désert des hautes Cévennes, et forçons, par la famine, les Camisards à descendre dans la plaine. Forts, quand ils se retranchent derrière leurs torrents et leurs montagnes, ne pourront affronter, en rase campagne, les milices royales. » Pour atteindre son but, il fallait dévaster quarante lieues de terrain et détruire de fond en comble 669 villages et 608 hameaux ! leur seul crime était de servir de retraite aux Camisards. Bâville demanda à la cour la permission d'exécuter son projet ; elle hésita, puis consentit. L'œuvre de destruction commença, le 20 septembre 1703, sous la direction de Julien : on vit alors monter des bords du Vistre et du Gardon, des milices royales, armées de pioches, de leviers, de marteaux ; à leur aspect, les montagnards épouvantés descendirent dans la plaine ; c'était navrant : la mère portait son nourrisson dans ses bras, le vieillard, appuyé sur son bâton, disait un dernier adieu aux lieux qui l'avaient vu naître; les mules portaient des infirmes, des meubles, de la literie, des vêtements de rechange ; sur toutes les figures on lisait un morne désespoir; les enfants, insouciants de ce qui se passait, regardaient d'un air étonné, parfois ils souriaient. Les démolisseurs étaient à l'œuvre, mais leur travail avançait lentement : les maisons, bâties solidement, résistaient au marteau, au levier, à la pioche. « Nous n'en finirons jamais, dit Julien impatienté ; l'hiver approche, la neige va tomber,» et il demanda la permission d'user du feu ; elle arriva. On vit alors les soldats royaux, armés de torches, courir comme des furies, de maison en maison, et la nuit, pendant deux mois, présenta un spectacle unique, étrange : à la lueur des flammes, qui projetaient leur sinistre clarté sur les montagnes, les torrents et les précipices, on suivait la marche et les progrès de l'incendie ; on n'entendait pas un seul cri, mais seulement le craquement des poutres, l'éboulement des murs et des combles des toits ; les clochers des églises étaient des phares enflammés qui éclairaient ces scènes lugubres et grandioses ; pas une seule cabane ne fut épargnée, les arbres mêmes furent condamnés, on les coupa tous. Julien triomphait : en moins de trois mois, il avait dévasté quarante lieues de pays, et vingt mille infortunés, privés de tout, avaient fui aux approches de l'hiver. Julien avait accompli dignement sa tâche : Du Chayla était vengé ! il lui avait fait de magnifiques funérailles. Ce Pont-de-Montvert, qui fut à la fois son tombeau et le berceau de l'insurrection camisarde, se trouvait parmi les villages proscrits par la justice inexorable de Bâville. Le proconsul fut trompé dans son attente : tous les montagnards en état de porter les armes, se voyant sans asile, se joignirent aux Camisards et agrandirent les cadres de leur armée: soldats improvisés, ils furent à la hauteur de leurs aînés ; comme eux, ils volèrent aux combats la rage au cœur ; leurs adversaires avaient cessé d'être des soldats, ils n'étaient que des assassins. Il se passa dans ce moment quelque chose de terrible : les Camisards, exaspérés de la dévastation des hautes Cévennes, d'où ils retiraient en partie leur subsistance, descendirent intrépidement dans la plaine, afin d'y trouver du pain. Nîmes, Beaucaire, Vauvert, Lunel, Aigues-Mortes, les virent à l'œuvre. Ils massacraient des compagnies, s'emparaient des convois, pillaient les villages et les maisons de campagne, faisaient main-basse sur tout. Castanet, Catinat, Ravanel, Roland, Joany, tous les chefs étaient en mouvement. Entre tous, Cavalier se distinguait par ses hardis coups de main ; il écharpa une compagnie du régiment de La Fare : pas un seul homme n'échappa pour en porter la nouvelle à Bâville. A Fon, près Lussan, il mit en déroute un détachement de milices royales. Les catholiques étaient épouvantés; Fléchier laissait éclater ses gémissements dans ses lettres pastorales, et lançait ses malédictions épiscopales sur ceux qu'il appelait des meurtriers et des incendiaires, et réservait ses bénédictions pour les cadets de la croix, qui, sous le commandement de l'Hermite, se vautraient dans le sang. Témoin des excès de l'Hermite, Cavalier écrivit à Montrevel : « Si vous ne faites pas cesser les massacres de ce scélérat, je fais passer au fil de l'épée tous les catholiques qui tomberont entre mes mains. » Le maréchal comprit ; il donna des ordres, et l'Hermite fut momentanément contraint de se modérer. Dans cette guerre des Camisards, à la fois si connue par son nom et si peu par ses détails, tout est tragique ; on croirait lire un roman, dans lequel l'écrivain, lâchant la bride à son imagination, se serait appliqué à trouver des situations, si nous pouvons ainsi nous exprimer, hors nature ; en effet, on marche d'étonnement en étonnement, tant les hommes y sont différents de ce qu'ils sont ordinairement; ici ce sont des prophètes, à la voix puissante et convaincue, et dont le regard plonge dans ce profond abîme qu'on appelle le cœur humain. Là ce sont des guerriers intrépides qui ignorent jusqu'au mot danger ; des chefs qui n'ont jamais appris la guerre et qui étonnent les lieutenants de Louis XIV, moins encore par leur audace que par leur tact militaire. Des lieux, jusqu'alors inconnus, prennent un nom dans l'histoire, soit parce qu'ils rappellent une charge brillante, une grande défaite ou une grande victoire. Tout est vivant sur le théâtre sacré des Cévennes, avec son Seguier, son Du Chayla, son Cavalier, son Roland, son Bâville, son Fléchier, ses cadets de la croix et ses Camisards noirs ; le bien s'y trouve confondu avec le mal, la foi la plus vivante avec un enthousiasme qui touche au délire, la générosité la plus chevaleresque avec la plus froide cruauté; l'on y combat au nom du despotisme le plus absolu ; on s'y défend au nom de la plus sainte des causes, la liberté de conscience. Dans cette grande épopée, chacun s'y révèle tel qu'il est : Cavalier personnifie le génie militaire, Roland le courage réfléchi, Montrevel la brutalité, Bâville la volonté inflexible comme le destin ; Fléchier et ses prêtres, l'esprit inquisitorial du moyen âge; Catinat, Ravanel, Castanet, l'audace ; Joany, la témérité; les prophètes, l'enthousiasme religieux ; l'Hermite, la cruauté ; les cadets de la croix, le vol et le meurtre; la gentilhommerie protestante, la poltronnerie et l'égoïsme ; la cour, l'insensibilité ; le peuple, la souffrance. A la vue de ce spectacle, l'historien se sent impuissant pour rendre dignement ces scènes qui attendent un grand génie poétique pour que la France ait son épopée, qui sera la plus belle de toutes parce que, chez elle, le merveilleux se trouvera, non dans l'imagination du poête, mais dans les faits historiques dont il sera le chantre immortel. Nous avons nommé les Camisards noirs, c'était un ramassis d'aventuriers, gens sans aveu, voleurs de grands chemins échappés des bagnes et des prisons, ennemis nés de tout ordre établi, formés en bandes sous le commandement d'un boucher d'Uzès ; ils dévalisaient les voitures, arrêtaient les passants, versaient le sang sans nécessité, par plaisir. Pour n'être pas reconnus, vrais soldats de l'enfer, ils se barbouillaient le visage avec de la suie ; de là leur nom de Camisards noirs. Ces scélérats, également odieux aux catholiques et aux protestants, répandaient partout l'horreur et l'effroi. Autant que les circonstances le permettaient, on leur faisait la chasse, comme à des bêtes fauves; mais il était difficile de les atteindre dans les repaires où ils se cachaient. Un jour ils en sortirent et rencontrèrent, entre Saint-Ambroix et Uzès, la jeune et belle marquise de Miraman, qui allait rejoindre son mari ; ils la dépouillèrent de son or et de ses bijoux, et malgré ses larmes et ses bras suppliants tendus vers eux, ils l'assassinèrent. La femme de chambre qui l'accompagnait échappa miraculeusement à une mort certaine. Voici le récit naïf et touchant qu'elle nous a laissé de ce drame lugubre : « Ces malheureux nous obligèrent de marcher dans le bois pour nous écarter du chemin ; ma pauvre maîtresse se trouva si lasse, si fatiguée, qu'elle pria le bourreau qui la conduisait, de permettre qu'elle s'appuyât sur son épaule. Nous n'irons guère plus loin, lui répondit-il. On nous fit asseoir sur un lieu où il y avait du gazon et qui devait être celui de notre martyre. Là, ma chère maîtresse dit à ces barbares les choses les plus touchantes, et d'une manière si douce, qu'elle aurait fléchi un démon ; elle leur donna sa bourse, sa ceinture d'or et un beau diamant qu'elle sortit de son doigt ; mais rien n'adoucit ces tigres. Un d'eux lui dit : Je veux tuer tous les catholiques et vous tout à l'heure. Et que vous reviendra de ma mort ? lui dit-elle, accordez-moi la vie. - Non, c'en est fait, lui répondit ce brutal, vous mourrez de ma main, faites votre prière. Alors ma pauvre maîtresse, se mettant à genoux, pria Dieu tout haut de lui faire miséricorde et à ses meurtriers, et comme elle continuait sa dévotion, elle reçut un coup de pistolet à la mamelle gauche, qui la jeta par terre, un coup de sabre à travers le visage et un coup de pierre sur la tête. Un autre scélérat tua la nourrice d'un coup de pistolet, et, soit qu'ils n'eussent plus d'autres armes chargées, ou qu'ils voulussent épargner les munitions, ils se contentèrent de me percer de plusieurs coups de baïonnettes. Je contrefis la morte, ils crurent que je l'étais en effet, et ils se retirèrent. Quelque temps après, je me traînai auprès de ma maîtresse, je l'appelai, elle me répondit d'une voix basse : Ne me quitte point, Suzon, jusqu'à ce que j'aie expiré. Elle ajouta : Je meurs pour ma religion et j'espère que le bon Dieu aura pitié de moi ; dis à mon époux que je lui recommande notre petite. Après cela, elle ne s'occupa que de Dieu, par des oraisons courtes et tendres, jusqu'à son dernier soupir, qu'elle rendit à mes côtés, à l'entrée de la nuit. » (1) (1). Mémoires de Cavalier, p. 229 et suiv. Brueys. - Louvreleuil. - Nap. Peyrat. - Court. Ce crime causa une horreur profonde; les catholiques voulurent rendre les huguenots odieux en essayant de les rendre solidaires de ce lâche assassinat. Ils protestèrent énergiquement, Cavalier s'empara de trois de ces scélérats et les fit pendre dans la forêt d'Euzet, montrant par là que, entre ses braves Camisards et les Camisards noirs, il y avait toute la distance qui sépare un soldat d'un assassin. La guerre continuait avec un acharnement extraordinaire; rien n'en faisait prévoir la fin, et Montrevel était de plus en plus convaincu que terroriser était le plus court et le plus sûr moyen d'en finir ; mais ce général de cour, léger, immoral, profane, était incapable de soupçonner la puissance des convictions religieuses. II allait donc de l'avant, destiné à faire la honteuse expérience que son bâton de maréchal de France s'inclinerait devant celui des paysans cévenols. Mais avant de nous engager plus avant dans nos récits, pénétrons dans le camp des insurgés, et nous serons témoins d'un spectacle unique dans les annales militaires, impossible à croire, si l'histoire, qui ne ment pas, ne nous l'attestait. La plus grande union régnait entre eux; du simple soldat au chef, il n'y avait pas de distance. L'un n'était pas plus humilié d'obéir que l'autre orgueilleux de commander; tous, ils combattaient pour la même cause : que leur importait donc d'être à la première ou à la dernière place ? Les soldats donnaient à leurs chefs le nom de frère; ils disaient : Frère Roland, frère Cavalier, frère Ravanel ; cette familiarité ne nuisait pas à l'obéissance, et Napoléon, l'idole de sa vieille garde, ne fut jamais mieux obéi de ses vieux grognards que les chefs cévenols de leurs Camisards. Ils ne discutaient jamais un ordre, jamais une plainte ne sortait de leurs lèvres ; leur confiance ne connaissait pas de bornes; au-dessus de leurs chefs ils avaient leurs prophètes ; on les consultait sur tout, soit qu'il fallût aller en avant, soit qu'il fallût fuir; quand l'Esprit avait parlé, Dieu avait parlé ; s'il leur ordonnait le combat, ils se jetaient dans la mêlée comme s'ils eussent été vêtus de fer et que leurs ennemis eussent eu des bras de laine. Des enfants de troupe, de jeunes Cévenols de dix à douze ans combattaient comme des hommes ; tout était arme pour eux. Le sifflement des balles ne les effrayait pas plus que le bourdonnement d'un moucheron. L'incrédulité railleuse qui, dans son fol orgueil, sacrifie les faits à ses vaines théories, pourra, si elle veut, attribuer à une maladie cérébrale le courage héroïque des Camisards ; quant à nous, tout en faisant une large part à l'exaltation, produit nécessaire des froides cruautés de Bâville et du clergé romain, nous voyons la main de Dieu dans la guerre des Camisards, couvrant de sa puissante protection un peuple opprimé, combattant pour la plus précieuse des libertés et donnant au monde, par sa résistance à Louis le Grand, un exemple plus noble que celui de la tourbe de ses courtisans, misérables valets sous leurs dentelles et leurs habits brodés d'or et de soie. A vues humaines, la résistance des Cévenols était impossible, et il semble que le roi puissant, qui avait pour généraux les plus grands capitaines du monde, n'aurait eu qu'à dire un mot pour disperser une bande de paysans ignorants dans l'art de la guerre. Eh bien! ces pays lui résistent; et là où quelques gendarmes paraissent plus que suffisants pour rétablir l'ordre, il faut envoyer des milices qui ont souvent vaincu les Impériaux sur les bords du Rhin; il faudra mettre à leur tête des généraux, même des maréchaux de France ! Dans un livre très-remarquable, le Théâtre de la guerre des Cévennes, nous trouvons le secret de cette énigme; écoutons un témoin oculaire : « Ce sont, dit Élie Marion, nos inspirations qui nous ont mis au cœur de quitter nos proches et ce que nous avions de plus cher au monde pour suivre Jésus-Christ et pour faire la guerre à Satan et à ses compagnons. Ce sont elles qui ont donné à nos vrais inspirés le zèle de Dieu et de la religion pure, l'horreur de l'idolâtrie et de l'impiété, l'esprit d'union et de charité, de réconciliation et d'amour fraternel qui régnait parmi nous, le mépris pour les vanités du siècle et pour les richesses iniques ; car l'Esprit nous a défendu le pillage, et nos soldats ont quelquefois réduit des trésors en cendres avec l'or et l'argent des temples et des idoles, sans vouloir profiter de cet interdit. Notre devoir était de détruire les ennemis de Dieu, non de nous enrichir de leurs dépouilles, et nos persécuteurs ont diverses fois éprouvé que les promesses qu'ils nous ont faites des avantages mondains n'ont point été capables de nous tenter. C'est uniquement par les inspirations et par le redoublement de leurs ordres que nous avons commencé notre sainte guerre. Comment un petit nombre de jeunes gens, simples, sans éducation et sans expérience auraient-ils fait tant de choses, s'ils n'avaient pas eu le secours du Ciel ? Nous n'avions ni force ni conseil ; mais nos inspirations étaient notre appui. Ce sont elles qui ont élu nos chefs et qui les ont conduits ; elles ont été notre discipline militaire ; elles nous ont appris à essuyer le premier feu de nos ennemis à genoux et à les attaquer en chantant des psaumes pour porter la terreur dans leur âme. Elles ont changé nos agneaux en lions et leur ont fait faire des exploits glorieux ; et quand il est arrivé que quelques-uns de nos frères ont répandu leur sang, soit dans des batailles, soit dans le martyre, nous n'avons pas lamenté sur eux. Nos inspirations ne nous ont permis de pleurer que pour nos péchés et pour la désolation de Jérusalem. Ce sont elles qui nous ont suscités, nous la faiblesse même, pour mettre un frein puissant à une armée de plus de 20,000 hommes d'élite, qui ont animé nos prédicateurs et qui leur ont fait proférer en abondance des paroles qui repaissaient solidement nos âmes. Ce sont elles qui ont banni la tristesse de nos cœurs, au milieu des plus grands périls, aussi bien que dans les déserts et les trous des rochers, quand la faim et le froid nous pressaient et nous menaçaient. Nos plus pesantes croix ne nous étaient que des fardeaux légers, à cause que cette intime communication que Dieu nous permettait d'avoir avec lui nous soulageait et nous consolait ; elle était notre sûreté et notre bonheur. Ce sont nos inspirations qui nous ont fait délivrer plusieurs prisonniers de nos frères ; reconnaître et convaincre des traîtres ; éviter des embûches, découvrir des complots et frapper à mort des persécuteurs. Si les inspirations de l'Esprit saint nous ont fait remporter des victoires sur nos ennemis par l'épée, elles ont fait triompher plus glorieusement nos martyrs sur les échafauds. C'est là que le Tout-Puissant a fait des choses grandes ; c'est là le terrible creuset où la fidélité et la vérité des saints ont été éprouvées. Les paroles excellentes de consolation et les cantiques de réjouissance du grand nombre de ces bienheureux martyrs, lors même qu'ils avaient les os brisés sur les roues, ou que les flammes avaient déjà dévoré leur chair, ont été sans doute de grands témoignages que leurs inspirations descendaient chacune de tout don parfait. » Ces paroles d'Élie Marion ont un cachet de droiture et de sincérité tel, qu'elles ont le droit d'être crues : quand l'exaltation et l'imposture parlent, elles ont d'autres allures. À côté de leurs prophètes, les Camisards avaient leurs prédicants ; aucun d'eux n'avait été régulièrement consacré ; plusieurs d'entre eux avaient une éloquence entraînante : Castanet et Cavalier étaient prédicants ; le premier se faisait remarquer par sa connaissance de la Bible ; le second par ses talents oratoires. C'étaient ces pasteurs improvisés qui avaient renoué la chaîne du passé de leur Église, brisée par le despotisme brutal de Louis XIV. Ils tenaient des assemblées, prêchaient, baptisaient, mariaient, administraient la sainte Cène ; aimés et vénérés de leurs fidèles affamés de prêches et vivant d'une vie religieuse dont Cavalier nous a laissé le tableau dans ses mémoires : « Ni les querelles religieuses, dit le jeune chef, ni les inimitiés, ni les calomnies, ni les larcins n'étaient point pratiqués parmi nous; tous nos biens étaient en commun ; nous n'étions qu'un cœur et qu'une âme ; tout jurement, toute imprécation, toute parole obscène étaient entièrement bannis de notre société, et les inspecteurs que nous avions établis parmi nous, afin que tout se fit avec ordre et décence, prenaient un soin particulier de nos pauvres et de nos malades et leur fournissaient toutes les choses nécessaires : heureux temps, s'il avait toujours duré ! » Les Camisards avaient, dans les Cévennes, leur désert, et dans la voix de leurs prophètes, leur colonne de feu ; au signal qu'ils donnaient, on décampait ; quand l'ennemi arrivait, la place était vide, il n'avait rien à butiner ; les Camisards étaient si pauvres qu'ils vivaient, au jour le jour, de razzias ; mais semblables à la fourmi qui travaille en vue de l'hiver, ils avaient soin de mettre leur superflu à l'abri d'un coup de main, ils l'entassaient dans des cavernes qui leur servaient à la fois de magasins d'approvisionnements, d'hôpitaux et d'arsenaux. Le zèle qui avait fait de quelques pauvres pâtres des prédicants, en avait fait des infirmiers, des pharmaciens, des chirurgiens. « Roland, qui, au génie du capitaine, joignait celui d'administrateur, avait, dit M. N. Peyrat, échelonné la hiérarchie selon le mode décimal. Il y avait des chefs de dix, des chefs de cinquante, des chefs de cent. Ce mode est le plus naturel et le plus antique. On le retrouve dans les armées de Tamerlan, de Romulus, de Moïse. La ressemblance est encore plus frappante avec l'organisation de la cité de Lycurgue. Sparte était composée de cinq tribus. Chaque tribu donnait à l'armée une mora commandée par un polémarque; chaque mora renfermait quatre lochos ou centaines ; chaque lochos deux pentéchostys, deux énomoties ou pelotons de vingt-cinq hommes. L'insurrection cévenole était composée des peuples de cinq cantons. Chaque canton fournissait une division commandée par un brigadier-général. Chaque division renfermait, terme moyen, quatre brigades ou centaines, chaque brigade deux cinquantaines, chaque cinquantaine deux pelotons de vingt-cinq hommes ou cinq dizaines. Leur camp était une Sparte errante ; la discipline la plus sévère y régnait; malheur à celui qui l'enfreignait. Il était frappé sans miséricorde surtout s'il dérobait, et plus encore, s'il se rendait coupable de meurtre ou de trahison. Ils étaient livrés aux exterminateurs ou bourreaux, après que les prophètes, leurs juges, avaient prononcé la sentence. Le surnom de Camisard, donné aux insurgés, a, comme celui de Parpaillot et de Huguenot, exercé la sagacité des historiens ; quelques-uns ont prétendu qu'il leur fut donné parce qu'ils changeaient leurs chemises sales contre des blanches dans les lieux dont ils s'emparaient. À Ganges, un plaisant dit à ceux qui en avaient été dépouillés et qui se plaignaient amèrement : « De quoi vous plaignez-vous? vous êtes bien heureux qu'on n'ait pas pris votre peau au lieu de vos chemises. » Alors l'un des plus irrités se mit à vomir des injures contre les insurgés et les appela des Camisards ou des voleurs de chemises. (1) - D'autres ont cru que le mot camisard venait de Camis (2), parce que les protestants se tenaient sur les chemins. D'autres ont vu l'origine du mot dans celui de camis que Morin, dans son Dictionnaire, donne à une idole du Japon ; or, comme les protestants brûlaient les images et les statues, et que ces mots languedociens ardre. Les camis signifient brûler les idoles, ils en ont conclu que de ces mots camisards, idoles brûlées, vient le mot camisard ou brûleur d'idoles. (1) En patois le mot chemise est rendu par celui de émise. (Mémoires de Cavalier.) (2) Mot languedocien qui signifie chemin. L'origine la moins problématique vient de camisade, attaque faite de nuit à l'improviste pendant que l'ennemi est au lit ; or, comme les protestants cévenols, au début de l'insurrection, firent la plupart de leurs expéditions de nuit, on comprend comment ce surnom de Camisard a pu leur être donné ; mais quelle que soit l'origine de ce mot, on peut tenir pour certain qu'il servit à désigner les protestants à la fin de l'année 1702. Fléchier et quelques écrivains les désignèrent plus souvent par l'épithète de fanatique ; mais celui de Camisard leur est resté dans l'histoire. (1) (1). Histoire de la Réformation, p. 253, vol. VI. CHAPITRE XIII
Nouvelles rigueurs de Montrevel. - Cruautés de Planque et du capitaine Laplace. - Exaspération des Camisards. - Le baron d'Aigaliers et ses projets. - La gentilhommerie protestante. - Ses lâchetés. - Commencement d'une nouvelle insurrection dans le Vivarais. - Cavalier remporte une brillante victoire à Saint-Chaptes.- Rappel de Montrevel. - Le maréchal prend sa revanche; il défait Cavalier à Nages. - Montrevel part pour Paris. - Le maréchal de Villars lui succède. Montrevel, dans son impatience d'en finir avec les insurgés, à ses rigueurs passées en ajouta de nouvelles. Il fit abattre tous les fours de campagne, détruire tous les moulins, ordonna aux bourgs et aux villages, de fermer leurs portes et de ne recevoir aucun étranger dans leur enceinte; sans forme de procès, il arracha les protestants inoffensifs de leur demeure. Malheur à qui n'obéissait pas, la mort suivait de près. Plus de six cents huguenots furent fusillés. À Saint-André de Valborgne il se passa une scène étrange, horrible. Un grand nombre de protestants, dont les maisons avaient été incendiées, s'étaient retirés à Aussilargues, paroisse de Saint-André; la faim leur fit franchir les barrières qu'on leur avait prescrites. Planque l'apprit, les fit surprendre au lit et conduire à l'église. Quelques moments après, cinq femmes ou filles franchirent le seuil de l'église. « Faites votre devoir, » dit Planque à ses soldats. Ceux-ci portèrent la main à la poignée de leur sabre. Deux jeunes filles, l'ainée n'avait pas huit ans, s'écrièrent en jetant des cris perçants : «Grâce ! Grâce ! pour notre mère, ne la tuez pas ! au nom de Dieu, ne la tuez pas ! » La pauvre mère jeta sur ses enfants un regard de tristesse indicible. « Grâce ! grâce ! » crient les enfants. Planque n'est pas touché, mais importuné ; à ses soldats qui hésitent, il dit brutalement : « Dépêchez-vous. » Un officier et des soldats emmènent la mère ; les deux enfants se jettent alors sur eux, furieuses comme des lionnes, en criant : « Non, vous ne la tuerez pas ! nous vous l'arracherons ! » Une bête sauvage eût compris leurs cris de douleur, Planque ne les comprit pas ; la mère fut assassinée sans pitié sous les yeux de ses pauvres enfants. Quelques moments après, cinq cadavres gisaient parterre, baignés dans leur sang. On ne daigna pas même leur donner un coin de terre pour y reposer en paix ; s'eût été trop de peine et d'honneur; on les jeta, comme des chiens immondes, dans le Gardon, qui les emporta dans sa course rapide et les déposa le long de ses bords, où ils furent rongés par des oiseaux de proie et dévorés par les bêtes sauvages (1). (1). Mémoires de Cavalier, page 189. — Court, tome II, page 177. Planque avait, dans l'art d'assassiner, un émule qui l'égalait, s'il ne le surpassait, le capitaine Laplace. Ce militaire, si toutefois il est permis de lui donner ce nom, avait accordé à quatre Cévenols qui s'étaient réfugiés à La Salle, la permission d'aller chez eux pour des affaires qui touchaient â leurs intérêts privés, sous la condition de revenir le même jour. Ils partirent, accompagnés d'une jeune fille, parente de l'un d'eux. Ils ne revinrent que le lendemain, un orage étant survenu. Ils expliquèrent au capitaine la cause de leur retard. « Liez-moi ces hommes, dit Laplace à ses soldats; conduisez-les hors de la ville et fusillez-les. » Les soldats obéissent et emmènent la jeune fille, qui doit partager leur sort. Sa jeunesse, sa beauté excitent un attendrissement général. Des cris de grâce se font entendre. « Qu'on se dépêche, » dit Laplace. Quatre décharges consécutives ont lieu et quatre cadavres tombent à terre baignés dans leur sang. C'est le tour de la belle huguenote, qui, les yeux levés au ciel, demande à Dieu de la soutenir dans cette heure suprême de sa vie. Des religieuses étaient présentes, peut-être pour veiller à la funèbre toilette des morts.... Leur cœur est ému d'une tendre compassion; elles s'approchent de la jeune fille, et lui disent tout bas : « Déclarez que vous êtes enceinte; » elle rougit ; et, les éloignant de la main : « Jamais, » leur dit-elle. Les soldats, le doigt posé sur la détente de leur fusil, attendent que les religieuses se soient retirées. Celles-ci insistent. « Jamais, » répéta l'huguenote. « - Eh bien! nous mentirons pour vous. » « Cette jeune fille est enceinte, dirent-elles au capitaine ; si vous ne voulez pas l'épargner, ayez au moins compassion de son enfant. » Celui-ci, sans s'émouvoir, dit : « Qu'on aille chercher une sage-femme. » La sage-femme vint; elle comprit et dit : « Cette jeune fille est enceinte. » « C'est bien, dit Laplace à la sage-femme. Vous allez demeurer avec elle en prison, et si d'ici à trois mois il n'y a pas signe de grossesse, au lieu d'une victime on en immolera deux. » À ces mots la sage-femme, saisie d'une frayeur mortelle, s'écria : « Non seulement elle n'est pas enceinte, mais elle est encore une pure jeune fille ! » Le capitaine fait un signe... et bientôt après on entend une détonation : la jeune et belle vierge, frappée mortellement, tombe au milieu des quatre cadavres encore palpitants de ses compagnons d'infortune. (1) (1). Court, tome II, page 179 et suivantes. Ce n'est que dans les guerres civiles et religieuses que la vase du cœur humain, s'agitant jusque dans ses dernières profondeurs, révèle l'abîme de misères où le péché d'Adam jeta sa malheureuse postérité. La nouvelle de ces sanglantes exécutions et les excès commis par les cadets de la croix exaspérèrent au plus haut point les Camisards, qui usèrent de représailles ; et de part et d'autre la guerre ne fut plus la guerre, mais une tuerie. C'est la rougeur au front que nous déchiffrons ces pages tachées de sang et de boue. Mais soyons justes et renvoyons-en aux premiers auteurs de cette guerre fratricide la plus grande partie, si ce n'est toute la responsabilité. Au moment où nous sommes arrivé de nos récits, nous voyons apparaître sur la scène sanglante des événements un personnage dont la physionomie ne manque pas d'originalité, et qui y joua un rôle tragi-comique. Du fond de son antique manoir, le jeune baron Rossel d'Aigaliers gémissait de voir ses coreligionnaires (il était huguenot) aux prises avec les catholiques et n'entrevoyait pas le moment où la lutte cesserait.  La bastonnade à bord des galères Le baron appartenait à cette gentilhommerie protestante accoutumée de bonne heure à croire au droit divin des rois et qui avait pour ceux de la terre une fidélité qui allait trop souvent jusqu'à renier celui du Ciel. Elle ne le montra que trop, car dans l'espace de moins de trente ans, plus de trois cents familles nobles du midi de la France renièrent leur foi; telle par peur, telle par courtisanerie, telle pour des places et des pensions. Ah! si le protestantisme n'avait eu, après la révocation de l'édit de Nantes, pour soutien que des nobles, notre glorieuse réforme serait aujourd'hui si bien déracinée du sol français, que les protestants n'y seraient guère plus connus que les béguins, ces rares débris du jansénisme. - Revenons au baron d'Aigaliers. Il fit le voyage de Paris, proposa à Chamillart d'ordonner à Bâville de faire cesser les persécutions. « Si après cela, ajouta-t-il, les rebelles se refusent à déposer les armes, je me mettrai à la tête des protestants bien pensants et nous courrons sus sur les rebelles ; Sa Majesté pourra alors se convaincre que la masse de la population lui est demeurée fidèle, et qu'il ne faut pas la rendre responsable des excès de quelques brouillons. » Le ministre de Louis XIV parut goûter le projet du baron ; celui-ci, plein d'espérance, retourna dans les Cévennes, pour mettre ses plans à exécution. Pendant que d'Aigaliers faisait son voyage de Paris, Julien battait les Camisards dans le Vivarais, que ces derniers avaient essayé une seconde fois d'insurger, ayant à leur tête Dortial de Chalancon et le capitaine Abraham Charmasson d'Arc (1), dont les descendants existent encore. Battus dans le Vivarais, les Camisards prenaient une éclatante revanche près de Saint-Chaptes. Voici le récit de cette belle journée, tel qu'il se trouve dans mon Histoire de la Réformation française : Montrevel venait d'Assions à Uzès, lorsqu'il apprit que Cavalier était à Saint-Chaptes. (1). Le pont d'Arc sur l'Ardèche, près Vallon, est une des plus belles merveilles du monde Il ordonna à La Jonquière d'aller à la poursuite du chef camisard avec six cents hommes d'élite de la marine. Ce chef, plein de confiance en lui-même, fit rebrousser chemin à un renfort de cent hommes que le maréchal lui avait envoyé. Cavalier, prévenu de son arrivée, battit en retraite et ne s'arrêta qu'au devois de Martignargues, lieu qui lui parut propice pour attendre le choc des troupes royales. Pendant que celles-ci arrivaient sur lui, il fit ses dispositions pour les bien recevoir. Lorsque La Jonquière fut à une portée de fusil des Camisards, il commanda le feu; au moment où les coups partaient, Cavalier fit un signe; ses gens se couchèrent par terre. Le commandant catholique, les croyant tous morts ou blessés, cria à ses soldats : En avant ! La baïonnette au bout du fusil, ils s'élancent vers le lieu où ils ont vu tomber les insurgés; ceux-ci les attendent en silence ; quand les soldats royaux sont à quelques pas d'eux, les Camisards se lèvent comme un seul homme, entonnent un psaume, déchargent leurs fusils à bout portant et s'élancent sur eux avec furie; au même moment, des cavaliers, secondés par des fantassins, sortent tout à coup derrière des taillis où ils se tenaient cachés, exécutent, avec la rapidité de l'éclair, une évolution qui enferme les troupes de la marine dans un cercle de fer et de feu. L'étonnement et la terreur font tomber les armes de leurs mains ; elles meurent sans opposer la moindre résistance, mais sans se plaindre. La Jonquière ne dut son salut qu'au cheval d'un dragon. Il abandonna ses braves officiers, dont la plupart furent tués. (1) (1). Louvreleuil, tome III, page 20. - Brueys, tome III, page 274. - Mémoires de Villars, tome I page 233. - Court. - Nap. Peyrat. - Ernest Moret. Cette victoire valut à Cavalier un surcroît de gloire et un riche butin. Montrevel quittait Uzès, lorsqu'il apprit la fatale nouvelle. Il retourna sur ses pas, mit toutes ses troupes en mouvement pour chercher les Camisards. Ils avaient disparu. La nouvelle défaite des milices royales retentit douloureusement à Nîmes. Fléchier poussait, dans ses lettres pastorales, des gémissements ; l'intendant Bâville rugissait comme un tigre auquel on a enlevé sa proie ; les catholiques étaient exaspérés. Chacun à sa manière se déchaînait contre Montrevel, rendu seul responsable de la honte infligée aux milices royales. On porta plainte contre lui, la cour décida son rappel. Le maréchal ne voulut pas partir sous le coup humiliant de la victoire des Camisards. Il chercha une occasion de se relever dans l'estime de ses troupes ; elle ne tarda pas à se présenter. Cavalier, tout fier de sa victoire de Saint-Chaptes, oubliait les règles les plus élémentaires de la prudence militaire. Il se croyait invincible en se voyant à la tête de 1 200 hommes bien équipés, bien armés, qui marchaient au pas au son d'un fifre, d'un clairon et de quatre tambours. Il avait douze gardes à habits rouges et galonnés et quatre laquais; la vanité lui tournait la tête. A sa place Roland se serait tenu dans les bois, guettant le moment propice pour se jeter à l'improviste sur ses ennemis ; Cavalier gagna la plaine de Nages, après avoir, le 13 avril 1704, abattu les remparts de Boucoiran. Montrevel, qui le faisait suivre par ses espions, fit habilement ses préparatifs et surprit les Camisards au moment même où ils se livraient à un sommeil d'autant plus doux, qu'ils étaient plus harassés de fatigue. Cavalier, comme s'il eût eu le pressentiment d'un grand danger, fit de vains efforts pour se tenir éveillé. Il s'endormit. Montrevel, qui, à force de vanité blessée, avait, ce jour-là, un éclair de génie militaire, s'avança à pas de loup vers les Camisards et lança, à fond de train, sur eux les dragons de Firmaçon commandés par Grandval. Ils se ruèrent sur les Cévenols, en criant : Tue ! tue ! Ceux-ci se réveillèrent en sursaut; le cri : Aux armes ! retentit dans leurs rangs. Cavalier se réveille ; un regard, jeté rapidement autour de lui, lui révèle la grandeur du péril qui le menace. Dans ce moment, le plus critique de sa vie militaire, il déploie une habileté sans égale. Son cœur bat violemment, mais sa tête demeure froide; soit qu'il se défende, soit qu'il attaque tout est calculé; rien n'est livré au hasard. Sa cavalerie le sert mal. Il la lance sur les dragons de Firmaçon qu'elle met en déroute, mais au lieu de revenir rejoindre le gros de son armée, elle perd un temps précieux à poursuivre les fuyards, et quand entre Vergèze et Boissière elle retourne sur ses pas, elle trouve en face d'elle le régiment de Charolais avec lequel elle engage une escarmouche et retourne à toute bride, mais trop tard, à Nages. Pendant ce temps-là Montrevel, à la tête du gros des troupes royales, se jette sur les camisards ; Cavalier se trouve pris entre deux feux. Il n'hésite pas : il s'élance avec ses braves Cévenols et se fraye un chemin sanglant à travers les rangs épais des milices royales. Il se croit sauvé ; vain espoir ! Il se trouve en face d'un nouveau corps d'ennemis, prêts à fondre sur lui. Il fond sur eux, passe à travers et gagne les hauteurs de Nages ; mais de quelque côté qu'il porte ses regards, il se voit entouré d'ennemis, qui brûlent du désir d'effacer la honte de Saint-Chaptes. De la voix et du geste Montrevel fait passer dans leurs cœurs les bouillonnements du sien ; quelle gloire pour lui s'il prend le jeune chef et ramène lié, garrotté à Nîmes ! Quelle réponse à ses détracteurs ! Du haut des collines de Nages, Cavalier se voit comme enfermé dans un cercle de fer; d'issues, nulle part ! Bien d'autres, à sa place, eussent demandé à capituler ; il n'en a pas même l'idée. « Enfants, dit-il à sa troupe, il ne nous reste qu'un moyen de salut : passer sur le ventre de ces gens-là : serrez-vous et suivez-moi. » A ces mots, suivi de ses braves, il fond sur les milices royales qui sont devant lui, enfonce leurs rangs, jonche la terre de leurs morts. Mais ses ennemis semblent renaître à chaque pas. Il rencontre un mur d'hommes qu'il faut renverser ; il le renverse et ce n'est qu'après s'être jeté avec furie sur les dragons qui gardent la tête du petit pont de Nages, qu'il opère sa retraite, que la nuit favorise. Il était sauvé ! mais à quel prix ! Sa belle troupe avait été écharpée. Quelques jours après, au bois d'Hieuset, Lalande l'attaqua, lui tua deux cents soldats et, pour surcroît de malheur, découvrit la grotte qui lui servait d'arsenal, de magasin et d'infirmerie. Le chef catholique s'empara de tout. Montrevel, après sa brillante victoire, partit en disant : « Voilà comment je prends congé de mes ennemis. » Bientôt après le maréchal de Villars arriva à Nîmes pour prendre la direction des affaires militaires, doublement compromises par la brutalité et l'impéritie de son prédécesseur, sur lequel le combat de Nages n'avait pas jeté l'absolution qu'il en attendait. Son successeur occupait dans l'armée un rang distingué ; il rivalisait par le génie militaire avec les meilleurs généraux de Louis XIV, et il avait, entre autres hauts faits d'armes, gagné la célèbre bataille de Friedlingen ; plus tard il devait, gagner celle de Denain, qui sauva la France et lui épargna la honte d'un démembrement. Aux qualités du capitaine, Villars joignait celles du diplomate. Il avait cinquante ans, sa figure était belle, imposante, sa voix gracieuse et sympathique. Il était ferme et ne recourait aux rigueurs que quand la nécessité lui en était imposée. Nul des hommes qui entouraient Louis XIV n'était plus propre à remplir la délicate mission qui lui avait été confiée. Avant d'agir, il voulut se rendre raison de l'état des esprits ; il écouta tout le monde, « voulant, disait-il, avoir deux oreilles pour écouter les deux partis. » Il parcourut une partie des Cévennes, et après avoir tout vu et entendu, il conclut qu'il valait mieux agir en diplomate qu'en homme de guerre, et il se servit de Lacombe, l'ancien maître de Cavalier, et du baron d'Aigaliers, qui aspirait à l'insigne honneur d'être le médiateur des deux partis ; trop heureux si, après sa réussite, le roi, son maître, daignait lui dire : « Baron, je suis content de vos services.» CHAPITRE XIII
Premières tentatives d'accommodement. - Moment opportun pour les faire. - Catinat et Lalande. - Entrevue de Cavalier et de Lalande. - Cavalier décidé à traiter. - Son entrée triomphale à Nîmes. - Conférence de Cavalier et de Villars. - Bases de leur négociation. - Joie des populations cévenoles. - Elles croient au rétablissement de l'édit de Nantes. - Roland continue les hostilités. Le moment pour traiter avec Cavalier était des plus propices ; le jeune chef était sous le coup de sa défaite de Nages, et les voiles anglaises, si impatiemment attendues, n'apparaissaient pas à l'horizon. L'espérance, cette dernière force du vaincu, manquait à l'ancien berger de Lacombe ; cependant quand ce dernier vint le trouver pour l'engager à déposer les armes, Cavalier lui dit en relevant fièrement la tête : « Nous le ferons quand le roi aura rétabli l'édit de Nantes. » Il demandait ce que Louis XIV s'était mis dans l'impossibilité d'accorder. Cependant, Lacombe, avec son regard pénétrant, devina, à certaines paroles de Cavalier, qu'il n'avait pas dit son dernier mot. De retour auprès de Bâville, il lui fit part de ses impressions, et quelques jours après, d'après son conseil, Lalande fit proposer au chef huguenot une entrevue ; celui-ci l'accepta et chargea Catinat de porter au chef catholique la lettre qui contenait son acceptation. Catinat, revêtu de son beau costume, se présenta devant lui, la tête haute et la contenance fière : « Qui êtes-vous? lui dit Lalande. - Le chef de la cavalerie du frère Cavalier. .- Quoi ! vous êtes ce Catinat qui a assassiné tant de gens dans les environs de Beaucaire? - C'est moi, lui répondit le Camisard sans se troubler ; ce que j'ai fait, j'ai cru devoir le faire. - Et vous osez vous présenter devant moi ? - Frère Cavalier m'a dit: « Va, il ne te sera fait `aucun mal, » et je suis venu, voici sa lettre. - Il a eu raison, » lui répondit Lalande qui décacheta la lettre. Après l'avoir lue, il dit à Catinat : «Retournez vers votre chef et dites-lui que dans deux heures je serai au pont d'Avesnes avec trente dragons ; qu'il en amène autant avec lui. » Bientôt après, Cavalier, suivi de trente de ses Camisards, arriva au rendez-vous assigné ; les deux chefs se saluèrent et la conversation s'engagea. Jusqu'ici on n'a pu connaître exactement ce que Cavalier demanda pour ses frères, ni ce que Lalande offrit au nom de Villars ; seulement on peut affirmer que Cavalier se relâcha de ses prétentions et qu'il ne dit. Pas : « Hors du rétablissement de l'édit de Nantes point d'accord. » Après les pourparlers, Lalande s'avança vers les soldats qui avaient accompagné Cavalier : « Voilà pour boire, » leur dit-il en leur jetant une poignée de pièces d'or. Les Camisards ne se baissèrent pas même pour regarder l'or qui roulait à leurs pieds : Ce n'est pas de l'argent, dirent-ils fièrement à l'officier catholique, qu'il nous faut, mais la liberté de conscience. .- Je ne peux, leur dit Lalande, vous l'accorder ; mais votre intérêt vous fait un devoir de vous soumettre au roi. » Les Camisards allaient répondre ; mais Cavalier, prenant aussitôt la parole, dit à Lalande : « Nous mourrons les armes à la main plutôt que de souffrir les violences qu'on nous fait. » Il exprimait les sentiments de sa troupe et non les siens. Le tentateur l'avait mordu ; il était sur une pente qu'il ne devait plus remonter. D'Aigaliers, qu'il vit le lendemain, l'impressionna plus encore que Lalande et l'engagea à écrire à Villars une lettre dans laquelle, après avoir exposé que les Cévenols n'avaient pris les armes que pour défendre leur vie et celle de leurs familles, il suppliait le maréchal d'intercéder auprès de Sa Majesté, afin qu'elle voulût leur pardonner et les recevoir à son service. Il n'était déjà plus ce fier Cévenol qui traitait de pair à pair avec Louis le Grand, disant : « Sans le rétablissement de l'édit de Nantes point de paix. » Les populations cévenoles, qui se croyaient au moment de recouvrer leur liberté, laissaient éclater naïvement leur joie ; elles allaient au-devant de Cavalier, dans lequel elles saluaient leur libérateur. À leurs yeux, il était le Néhémie de leur Jérusalem désolée. Comment en auraient-elles douté, quand, sur tous les points des Cévennes, la chaire du désert se dressait au milieu d'un concours immense de fidèles, et que, sans crainte des dragons, on pouvait, à ciel ouvert, psalmodier, prêcher, célébrer la sainte Cène, baptiser les enfants, bénir les mariages. - L'enthousiasme ne pouvait être plus grand ; aussi quand, le 6 mai 1704, Cavalier entra à Nîmes pour conférer avec Villars, il reçut une magnifique ovation ; toute la ville était sur pied, chacun voulait voir ce jeune pâtre élevé à la taille d'un héros, avec lequel le plus puissant roi de la terre daignait traiter. Catinat, le sabre à la main, précédait son maître, il écartait la foule qui se pressait sur ses pas ; il portait la tête haute, fier comme un valet de grand seigneur. Cavalier arriva aux Récollets et entra dans le jardin où l'attendaient Villars et Bâville entourés de quelques gentilshommes. À la vue du chef camisard, l'intendant ne sut contenir sa colère : « Il faut, lui dit-il, que le roi soit bien bon pour traiter avec un rebelle tel que vous.... - Si c'est tout ce que vous avez à me dire, lui répondit froidement Cavalier, il ne valait pas la peine de me faire venir ici; au reste, si nous avons pris les armes, ce sont vos cruautés qui nous y ont contraints. » Villars, qui avait accueilli gracieusement Cavalier, coupa la parole à Bâville, qui allait répondre, et dit : « C'est à moi que vous avez affaire ; que demandez-vous ? - La liberté de notre culte.» À ces mots, Bâville, hors de lui, dit à Cavalier : « Vous êtes trop heureux que le roi veuille vous pardonner ; soyez satisfait de sa clémence et ne prétendez pas à des conditions.» Le jeune Cévenol, sans se troubler, le regarda en face et dit : « Au point où en sont les affaires, nous obtiendrons notre demande ou nous mourrons les armes à la main. » 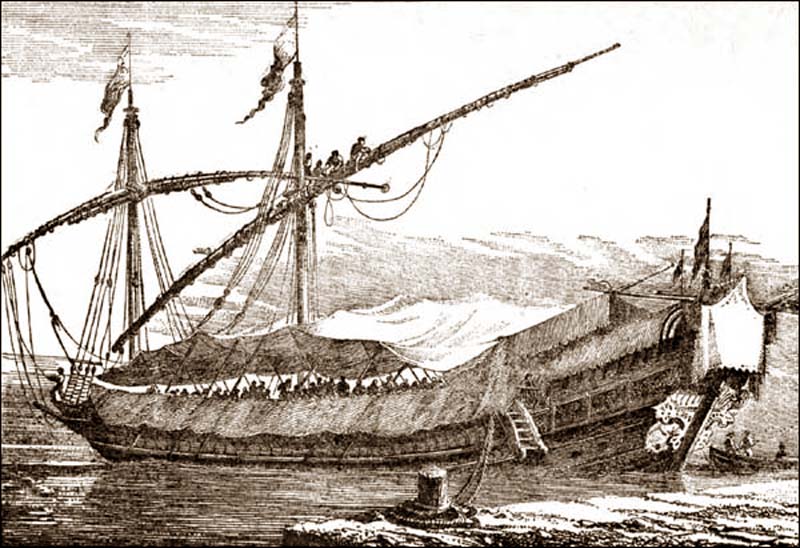 Vue d'une galère désarmée L'intendant, pâle de colère, allait éclater, quand Villars, lui coupant brusquement la parole une seconde fois, dit à Cavalier : « C'est à moi que vous avez affaire, que demandez-vous ? - Ce que j'ai demandé au pont d'Avesnes. - Le roi vous accordera la liberté de conscience; mais de relever vos temples, jamais ! » À ces mots, Cavalier aurait dû dire à Villars : « Je retourne vers mes frères pour mourir avec eux. » Il ne le dit pas et resta. « Que demandez-vous encore ? lui dit le maréchal. - La liberté de tous les prisonniers et de tous les galériens condamnés pour opinion religieuse. - Au nom du roi, je vous l'accorde ; » et puis, avec cet air gracieux et séduisant, qui lui était particulier et qui contrastait avec l'air farouche de Bâville, Villars dit à Cavalier : « Pourquoi sortiriez-vous de France ? Formez un régiment de vos soldats, mettez-vous à leur tête et allez servir Sa Majesté soit en Espagne, soit sur les bords du Rhin. » Les épaulettes de colonel séduisirent Cavalier. « J'accepte, » dit-il; mais comme si sa conscience lui eût reproché d'avoir sacrifié sa foi, il dit à Villars : « Accordez à ceux des Camisards qui sortiront du Languedoc la faculté de célébrer leur culte dans certaines localités déterminées. - Impossible ; ce serait rétablir l'édit de Nantes ; le roi ne le rétablira jamais. Si vos frères veulent célébrer leur culte, ils le peuvent, mais à l'étranger; le roi leur accordera la permission de vendre leurs biens et de sortir du royaume. » Cavalier obtenait moins qu'il n'avait espéré, ou plutôt il n'obtenait rien, si ce n'est un brevet de colonel et une pension. Villars, par sa diplomatie, faisait en une heure ce que, en deux ans et demi, Ravine, avec ses potences, et Montrevel, avec son sabre, n'avaient su faire. Cavalier, héros sur un champ de bataille, se rapetissait dans une conférence diplomatique à la taille d'un homme vulgaire ; Villars le dominait. Avant de se séparer, il fut convenu que Cavalier présenterait ses demandes par écrit et qu'on les soumettrait au roi. La conférence était terminée; quand le chef camisard prit congé de Villars, celui-ci, en lui frappant amicalement sur l'épaule, lui dit : « Adieu, seigneur Cavalier. »  Villars Le jeune chef sortit du jardin des Récollets, précédé de Catinat. À la porte une foule immense de curieux l'attendait ; il montait un petit cheval bai, portait un habit couleur de café et son cou était entouré d'une grande cravate de mousseline blanche. À la vue de tout ce peuple qui l'acclamait , il oublia le rôle piteux qu'il venait de jouer, et ne pensa qu'à jouir du triomphe éphémère que lui décernait la foule ; il saluait gracieusement à droite et à gauche, et cédant à une vanité d'enfant, il affectait de montrer sa main où brillait une superbe émeraude, et sous prétexte de connaître l'heure de la journée, il sortait une belle montre enrichie de diamants. Catinat, qui ne doutait pas que son chef n'eût obtenu le rétablissement de l'édit de Nantes, triomphait à sa manière; jamais il n'avait été plus fier et ne s'était montré plus content de lui-même. A la porte de la ville sa troupe attendait Cavalier, elle l'accueillit avec enthousiasme et prit la direction de Saint-Cézaire, où elle entra au chant des psaumes ; cinq cents Nîmois protestants l'attendaient; ils lui offrirent, ainsi qu'à ses camisards, des rafraîchissements. La joie était peinte sur tous les visages, on croyait avoir obtenu ce qui avait coûté tant de larmes et tant de sang. De tous, Cavalier était le moins joyeux, il savait que ses frères se berçaient d'une fausse espérance. Pendant les négociations de Nîmes, Roland agissait comme s'il les eût ignorées ; il trouvait, non sans raison, étrange que son lieutenant se fût permis, sans prendre d'autre conseil que de lui-même, d'entamer des négociations avec Villars ; il fit semblant de l'ignorer, et au moment même où Cavalier conférait avec Lalande au pont d'Avesnes, il faisait subir une sanglante défaite aux troupes royales à Forêt-Morte, près du château de la Devèze, tuait leur colonel, plusieurs de leurs capitaines, faisait un riche butin et relevait le moral de ses soldats, que la défaite de Nages avait abattus. Cavalier sentait la faute qu'il avait commise en agissant à l'insu de son chef. Il fallut cependant qu'il se décidât à lui communiquer ce qui s'était passé entre lui et Villars et qu'il devait savoir par le bruit public ; il le fit par une lettre dans laquelle il ne lui exposait que l'un des côtés de la vérité. Roland, qui à un grand courage joignait une grande prudence, ne voulait pas rompre ouvertement avec son lieutenant ; il se contenta de lui répondre qu'il acceptait le traité, mais qu'il ne tomberait pas dans les pièges de Villars. C'était lui dire : « Le maréchal t'a séduit, il ne me séduira pas. » Aussi sa réponse ne satisfit pas son lieutenant, qui alla avec sa troupe attendre à Calvisson la réponse de la cour aux demandes qu'il lui avait faites par écrit. Cavalier fut-il gagné par Villars ou céda-t-il à la nécessité ? Cette question est difficile à résoudre, tant les raisons, pour et contre, se balancent. Ceux qui soutiennent que le chef camisard céda à la nécessité, représentent sa position comme désespérée. « Au moment où il traitait, il n'avait, disent -ils, ni bagages, ni munitions, ni argent, sa troupe était affaiblie par la sanglante défaite de Nages ; la contrée où devait se continuer la guerre, était un véritable désert, et les populations protestantes, fatiguées de la guerre , étaient prêtes à se lever en masse contre lui à la voix de d'Aigaliers ; ils ajoutent, enfin, que les troupes royales étaient commandées par un maréchal de France aussi profond politique qu'habile tacticien, et que le résultat de la lutte ne pouvait être douteux. » Ceux qui soutiennent l'opinion contraire, disent que Cavalier se laissa séduire par les promesses de la cour et que la perspective d'un brillant avenir, dans les armées royales, lui parut plus belle que celle de continuer son métier hasardeux et si peu lucratif de guérillas cévenol. Quant à nous, nous pensons que le chef camisard trouva dans sa position difficile moins une nécessité qu'un prétexte plausible pour signer un traité qui ne répondait nullement aux espérances de ceux qui avaient le droit d'attendre davantage après tant de sang versé. Notre opinion n'est donc pas favorable à Cavalier, qui manqua d'énergie morale et pensa à lui plutôt qu'à ses frères opprimés ; sa position, quoique difficile, n'était pas désespérée, car, s'il eût essayé de tenir encore la campagne pendant une saison, il est probable que les efforts tentés par les États protestants eussent été couronnés de quelques succès ; le pâtre de Ribaute se hâta trop ; il fit peut-être le saut, périlleux pour des épaulettes de colonel, comme le Béarnais pour la couronne de saint Louis. CHAPITRE XV
Aspect de Calvisson. - Joie délirante des populations cévenoles. - Colère des prêtres et de Bâville à la vue des chaires qui se dressent dans toute la Vaunage. - Réponse de la cour aux demandes de Cavalier. - Désappointement de ce dernier. - Villars le force à signer le traité. - Cavalier communique le traité à Roland. Calvisson, pendant huit jours, présenta un aspect des plus animés et des plus curieux. De tous côtés les protestants y arrivaient pour voir Cavalier et saluer en lui leur libérateur. Des larmes de reconnaissance coulaient de tous ces yeux qui, depuis si longtemps, n'en avaient versé que de douleur. Les cachots allaient enfin s'ouvrir pour rendre leurs prisonniers, les bagnes leurs forçats, les frontières leurs fugitifs. Quant au rétablissement de l'édit de Nantes, il existait déjà à leurs yeux : comment en auraient-ils douté à l'aspect de ces chaires qui se dressaient dans la Vaunage, et du haut desquelles, à quelques pas de Bâville, leurs prophètes, sans crainte des dragons, annonçaient le conseil de Dieu ? Leur joie tenait du délire, elle était si naturelle, ils avaient tant souffert ! Aujourd'hui ils prient sur les ruines de leurs temples et hier encore le glaive royal était suspendu sur leurs têtes ! quelle merveilleuse délivrance ! ils la célébraient en chantant des psaumes qui déchiraient les oreilles de Fléchier. Il s'indignait, ainsi que ses prêtres. Villars avait osé permettre aux Camisards de dresser leurs chaires dans toute la Vaunage et jusqu'aux portes de Nîmes ! c'était, à leurs yeux, la profanation des profanations. Les murmures du clergé parvinrent jusqu'à Villars. « C'est quelque chose de bien ridicule, dit-il devant Bâville, que l'impatience que les prêtres témoignent à ce sujet. J'ai reçu, je ne sais combien de lettres remplies de plaintes, comme si les prières des Camisards écorchaient non-seulement les oreilles, mais encore la peau du clergé. Je voudrais, de tout mon cœur, savoir qui sont ceux qui m'ont -écrit et qui n'ont eu garde de signer, pour leur faire donner la bastonnade ; car je trouve que c'est une imprudence bien grande que ceux qui ont causé ces désordres se plaignent et désapprouvent les moyens dont on se sert pour les faire cesser. » Bâville comprit que ces paroles étaient à son adresse, car, moins que Fléchier encore, il comprenait l'audace des protestants. « On ne peut souffrir, dit-il au maréchal, un tel scandale. » « Voulez-vous donc mettre le feu à la province? » lui répondit le maréchal impatienté.  Bâville Dès que la réponse de la cour aux demandes de Cavalier fut arrivée, Villars la porta lui-même à Calvisson ; elle n'en accordait qu'une partie et refusait la seule qui pût satisfaire les Camisards : « la liberté de leur culte. » Cavalier, à la fois confus et surpris d'obtenir si peu, dit au maréchal : « La paix n'est pas possible, à ces conditions je ne signe pas. » Villars qui jusqu'alors s'était montré conciliant et gracieux, sentit bouillonner tout son orgueil de grand seigneur à la vue de ce pâtre qui, traitant d'égal à égal avec lui, un maréchal de France, allait l'obliger, par un refus, de faire savoir à la cour que toutes les espérances qu'il lui avait données de la pacification des Cévennes, s'étaient évanouies et que tout était à recommencer, avec lui comme avec Montrevel ; il jeta un regard sévère sur Cavalier. « La parole du roi, lui dit-il, est plus sûre que les vingt places que vous demandez, vous êtes trop heureux qu'il veuille vous accorder quelques-unes de vos demandes. » Cavalier, intrépide en face des balles des milices royales, n'osa soutenir le regard irrité du maréchal, prit la plume qu'on lui présentait et signa. Le jeune chef avait aliéné sa liberté ; de ses propres mains il s'était désarmé, et si par sa soumission il ne termina pas la guerre, il en hâta au moins la fin. Sa tâche la plus difficile n'était pas faite, il fallait engager Roland et les autres chefs à se soumettre ; il se rendit près d'Anduze, où il trouva son chef qui avait connaissance de son traité avec Villars, mais qui en ignorait le contenu. Cavalier, qui, depuis son ovation de Nîmes, se croyait le personnage le plus important de l'armée camisarde, oublia, en parlant à Roland, qu'il n'était que son lieutenant ; il lui parla en maître. Roland jeta sur lui ses regards dans lesquels perçait une ironie amère. « Tu oublies donc, lui dit-il, que je suis ton chef ? tu es fou, tu devrais mourir de honte d'avoir fait ce que tu as fait ; tu n'es plus qu'un vil agent du maréchal. Va lui dire que je suis prêt à mourir l'épée à la main, jusqu'à l'entier et complet rétablissement de l'édit de Nantes.» À ces mots Cavalier bondit de colère et porta la main à ses pistolets ; Roland saisit les siens ; le sang allait couler, quand leurs lieutenants s'interposèrent entre eux et calmèrent Roland ; mais il fut convenu que Salomon irait, avec Cavalier, trouver le maréchal pour faire subir des modifications au traité, car tel qu'il était, il était inacceptable. Cavalier et Salomon, montés chacun sur un cheval, se dirigèrent vers Nîmes ; à peine arrivés, ils se rendirent chez Villars, Cavalier lui raconta son entrevue avec Roland et laissa la parole à Salomon. L'impétueux et rustique prophète, nullement intimidé de la présence du maréchal entouré de ses officiers d'ordonnance, formula, brièvement et nettement, les plaintes des Camisards et termina en disant : « Sans le rétablissement de l'édit de Nantes nous ne déposerons pas les armes. » Villars s'impatienta ; le prophète demeura impassible. Il était du nombre de ces hommes forts qui ne baissent la tête que devant Dieu. Le maréchal ne revenait pas de son étonnement et il se prenait à estimer ce pâtre dont il était digne de comprendre le courage indomptable. Cavalier et Salomon prirent congé de lui, le premier alla à Calvisson, le second demeura à Nîmes. Le lendemain le prophète pria Lalande de remettre à Villars une lettre de Roland pour le maréchal, il ne la lui avait pas présentée la veille en voyant son emportement. Salomon répéta â Lalande ce qu'il avait dit à Villars, que ses frères ne déposeraient les armes qu'à la condition du rétablissement de l'édit de Nantes. Après vos échecs, lui répondit brusquement le général catholique, vous feriez mieux de vous rendre, dépêchez-vous... Salomon, arrêtant son regard d'aigle sur Lalande, lui dit : « Les défenseurs ne manqueront pas à l'Éternel ; je monterai sur la montagne, et douze mille hommes se lèveront à ma voix. » Lalande haussa les épaules de pitié, prit la lettre de Roland qu'il remit au maréchal. Le général en chef des enfants de Dieu demandait ce qu'on ne pouvait lui accorder. Revenons à Cavalier ; triste et abattu, il avait quitté Nîmes pour se diriger vers Calvisson, où sa troupe l'attendait avec une vive impatience. Ravanel alla à sa rencontre. « A quelles conditions as-tu traité ? » lui dit-il, dès qu'il l'aperçut. Cavalier répond d'une manière évasive. Ravanel précise de plus en plus sa question. Cavalier hésite à répondre, ou bien, il ne le fait que d'une manière qui éveille des soupçons dans l'esprit de son lieutenant; de plus en plus pressé par ce dernier, il dit : « On prépare des habits , il faut aller en Portugal. - Lâche ! traître ! tu nous as trahis ! » lui crient Ravanel et ses officiers. M. de Vincel, commissaire ordonnateur, qui accompagnait Cavalier, prit la parole et dit: « De quoi vous plaignez-vous ? » Ravanel, dissimulant le sujet de sa colère, lui répondit : « L'Hermite a assassiné deux de nos frères, et l'on a empêché les autres de se joindre à nous, pour prier dans nos assemblées. - L'Hermite sera puni, dit M. de Vincel, mais que voulez-vous ? Le rétablissement de l'édit de Nantes, le relèvement de nos temples, la liberté de nos prisonniers. - On dirait que tu es le maître, lui dit Cavalier d'un ton moitié ironique, moitié colère. - Je le suis, » lui répond son farouche lieutenant. Il fait battre la générale et lui tourne le dos. Cavalier se jette au milieu de ses soldats. « Frères, » leur crie-t-il. - « Point de paix ! point d'accommodement ! s'écrient-ils, que nous n'ayons recouvré nos temples. » La troupe de Cavalier s'éloigne, ayant à sa tête Ravanel. Un seul jour a suffi pour faire perdre au jeune chef son prestige et sa gloire ; il sent qu'il n'est qu'un traître aux yeux de ses vaillants soldats, comment osera-t-il se présenter devant Villars, après l'avoir assuré que sa soumission entraînerait forcément celle des Camisards ? Désespéré, il court après ses soldats qui s'éloignent tambour battant; il les atteint. « Frères, » leur crie-t-il. Sa troupe lui répond par des huées et par des cris, deux fois il essaye de se faire entendre, deux fois sa voix est couverte par des cris ; des pistolets sont dirigés contre sa poitrine. Un Camisard élève la voix : « Frères, vous traitez Cavalier comme s'il était un larron et un brigand; il faut lui pardonner; s'il a mal fait dans le passé, dans l'avenir il fera mieux. » Les Camisards ne l'écoutent pas et poursuivent leur route ; Cavalier les suit et tente un -dernier effort au moment où il est couché en joue : « Qui m'aime me suive,» s'écrie-t-il ; il prononce ces paroles les larmes aux yeux. Au son de cette voix tant aimée, quelques Camisards se sentent profondément émus; ils s'arrêtent, hésitent un instant, rompent leurs rangs et se joignent à leur chef. Les partisans de Ravanel, indignés de leur désertion, s'écrient d'une voix tonnante : « Vive l'épée de l'Éternel ! » et poursuivent leur marche.
CHAPITRE XVI
Cavalier reçoit de Villars l'ordre de partir. - Il quitte les Cévennes et remonte le Rhône. - Les populations se pressent sur son passage. - À Valence l'évêque l'invite à sa table. - À Vienne il visite un couvent. - La jeune pensionnaire huguenote. - Cavalier arrive à Mâcon. - Accueil qu'il y reçoit. Lorsque Villars fut convaincu que Cavalier ne lui était plus utile, il lui ordonna de se préparer à partir. Le lendemain 21 juin 1704, le chef camisard, escorté par quinze des gardes du maréchal, alla coucher à Vallabrègues, où l'attendaient ceux de ses soldats qui n'avaient pas voulu séparer leur fortune de la sienne. Ils saluèrent son arrivée de leurs joyeuses acclamations ; mais lui était triste, car sa conscience lui reprochait d'abandonner les Cévennes, ce théâtre sacré et sanglant où l'héroïque Roland, inaccessible aux séductions de la cour, avait juré de mourir plutôt que de trahir la cause pour laquelle tant de sang avait été répandu. Le lendemain, suivi de ses fidèles Camisards, il traversa le Rhône et dit un dernier et triste adieu à ces lieux qu'il ne devait plus revoir et qu'il avait rendus célèbres par tant de combats ; il remonta le fleuve qu'il avait franchi il y avait à peine deux ans et demi, alors jeune homme inconnu et n'ayant pas même dans ses rêves l'idée de la place que quelques jours de vie lui avaient donnée dans l'histoire. Que de pensées diverses devaient se presser dans le cœur de l'ancien berger de Lacombe ! soit que son regard s'arrêtât sur son passé, soit qu'il essayât de plonger dans l'avenir, il n'était qu'aux premiers abords de la vie et cependant il avait tant vécu ! C'est aussi avec un vif intérêt que nous le suivons remontant la rive droite de ce Rhône au cours rapide et dont les eaux furent, aux jours sinistres de la Saint-Barthélemy, rougies de tant de sang huguenot ; ses bords pittoresques sont pleins de souvenirs : ils virent Coligny malade, conduisant ses infatigables légions sur ces champs de bataille où, toujours vaincu, il était toujours à vaincre ; ils virent le terrible baron Des Adrets remplir, de la terreur de son nom, le Vivarais, le Dauphiné, la Provence, et faire trembler le pape jusque dans son Vatican ; ils virent de nombreux fugitifs se hasarder sur des barques légères pour échapper aux poursuites de leurs implacables persécuteurs, et maintenant ils voyaient le héros camisard s'acheminant triste et pensif vers Lyon et excitant partout sur son passage une vive curiosité. Chacun voulait le voir, l'entendre, le toucher ; son entrée à Valence lui rappela celle de Nîmes. L'évêque de cette ville l'invita à sa table et entama une discussion religieuse avec lui ; Cavalier, qui connaissait la Bible et plus encore les passages qui condamnent formellement Rome que ceux qui ordonnent au chrétien de porter sa croix, mit le provocateur dans un embarras dont il sortit moins par de bonnes raisons que par des traits d'esprit. En quittant Valence, Cavalier suivit la rive gauche du Rhône et reçut partout, ainsi que sa troupe, un sympathique accueil. A Vienne, la sœur du maréchal de Villars, abbesse d'un couvent, l'invita à prendre une collation ; sa présence dans le cloître impressionna vivement les jeunes pensionnaires nobles qui y complétaient leur éducation. Elles étaient avides de voir et d'entendre ce terrible Camisard qu'on leur avait représenté tenant d'une main une torche pour incendier les églises et les couvents, de l'autre un glaive pour en frapper les prêtres et les religieux ; elles se faisaient de lui le portrait le plus hideux, et voilà, elles se trouvent en présence d'un tout jeune homme, petit de taille, à la chevelure blonde tombant en boucles sur ses larges épaules ; ses yeux n'ont rien qui indique la férocité, ils sont vifs, expressifs, doux comme sa parole. De l'étonnement elles passent presque à la familiarité ; quelques-unes lui font .des questions, auxquelles il répond avec simplicité et sans embarras. Au milieu de ces pensionnaires, heureuses d'un incident qui rompait la monotonie de leur vie, l'une d'elles gardait le silence et laissait voir sur sa belle et douce physionomie les traces d'une, profonde tristesse ; elle appartenait à une famille noble protestante du Languedoc qui avait abjuré ; son frère, misérable apostat, l'avait condamnée à l'état monastique pour s'emparer de la part de succession qui lui revenait dans l'héritage paternel. La jeune fille, qui avait eu le bonheur, avant la lâcheté de ses parents, de connaître la foi chrétienne, avait été, malgré elle, jetée dans un couvent ; elle soupirait après sa liberté comme l'oiseau des champs retenu dans sa cage ; elle s'approcha de Cavalier, lui fit en termes simples, touchants, le récit de ses malheurs et le supplia, les larmes aux yeux, de s'intéresser à son sort. « Ayez pitié de moi, lui dit-elle ; faites-moi rendre la liberté ! » Cavalier, touché de ses malheurs, le lui promit, et, en prenant congé d'elle, il lui laissa une espérance ; se réalisa-t-elle ? Nul ne le sait. Le chef camisard aurait pu, quand il commandait ses bandes cévenoles, forcer les portes de sa prison ; mais le futur colonel n'avait ni puissance ni influence, et dans ces temps calamiteux, les couvents étaient le plus souvent des tombes ; rarement ils rendaient leur proie. Cavalier traversa Lyon, remonta avec sa troupe la Saône et arriva à Mâcon, où il reçut l'ordre de séjourner indéfiniment.. Les Mâconnais, qui n'étaient pas fanatiques comme les catholiques du Languedoc, firent un accueil cordial au chef camisard et à ses soldats ; ils les fournirent de vivres et prirent plaisir à assister à leur culte ; ils ne furent scandalisés ni de sa simplicité ni de la rude monotonie du chant de leurs psaumes.
CHAPITRE XVII
Cavalier s'ennuie à Mâcon. - Son désir d'aller à Versailles et d'être présenté au roi. - Il écrit à Chamillard qu'il a des secrets importants à révéler. - Cavalier à Paris. - Il y est l'objet d'une vive curiosité. - Le roi consent à ce qu'il lui soit présenté. - Récit de l'entrevue. - Retour de Cavalier à Mâcon. - Avertissements donnés à Cavalier. - Il craint d'être enfermé dans la citadelle de Neuf-Brisach. - Départ de Cavalier pour Neuf-Brisach. - Cavalier s'échappe avec sa troupe. - Son arrivée à Lausanne. - Il se rend à la cathédrale et rend grâces à Dieu de sa délivrance. Cavalier était à Mâcon depuis à peine quelques jours, et déjà il était fatigué de cette vie oisive qu'on mène dans les garnisons. Ses regards se tournaient sans cesse vers Versailles, et sa seule ambition du moment était d'être présenté à ce roi si grand à ses yeux par les choses merveilleuses qu'on disait de la majesté de sa personne, de la somptuosité de sa demeure et de l'éclat de son entourage. Quel honneur pour lui si le monarque daignait l'honorer d'une audience ! et l'ancien pâtre de Lacombe s'enivrait de cette idée. Pour la réaliser, il eut recours à un mensonge ; il écrivit à Chamillard qu'il avait d'importantes révélations à faire. Le ministre chargea d'Aigaliers, qui de Paris se rendait dans les Cévennes, de s'arrêter à Mâcon pour recevoir ses communications. Cavalier refusa et déclara que ce ne serait qu'à Versailles qu'il les ferait. Le ministre, le croyant dépositaire de quelque grand secret, lui envoya la permission tant désirée. Le chef huguenot quitta Mâcon et arriva à Paris, où le bruit de sa renommée l'avait précédé. Chacun voulait voir ce jeune pâtre qui, sans jamais avoir appris l'art de la guerre, faisait l'admiration des plus habiles capitaines. Pendant deux ans n'avait-il pas, avec quelques centaines de paysans armés de bâtons et de mauvais fusils, tenu tête à de Broglie et à Montrevel, après leur avoir fait subir d'éclatantes défaites ? S'il a déposé les armes, ce n'est pas devant Villars victorieux, mais devant Villars diplomate. Partout où il se présentait, il était acclamé, et lui jouissait naïvement de son triomphe et oubliait ses frères qui versaient leur sang pour la cause qu'il avait abandonnée. Paris l'émerveillait ; tout y était nouveau pour lui: ses rues, ses places publiques, ses palais, ses monuments. Versailles avec son aspect féerique l'enchantait. Mais au milieu de ces enivrements, qu'on comprend si bien chez un jeune homme, Cavalier pensait toujours au roi auquel il voulait avoir l'honneur d'être présenté. Le moment si désiré et attendu avec tant d'impatience arriva : le monarque condescendit à le voir. Louis XIV avait alors soixante-trois ans. Quoique sa taille fût un peu au-dessous de la moyenne, avec son costume et sa figure imposante, il paraissait grand : tout décelait en lui le roi, le maître ; car s'il ne sut pas toujours bien gouverner son royaume, il sut au moins toujours bien trôner. C'est ce qui lui donna cet ascendant irrésistible sur tous les hommes d'élite, prêtres, militaires, diplomates, poètes, orateurs, artistes, qui ont jeté tant d'éclat sur son règne et qui sont son plus beau titre de gloire devant la postérité. Cavalier fut introduit dans le cabinet royal par Chamillard. Louis, à la vue de ce jeune Cévenol, prit un air hautain et dédaigneux ; et, sans autre préambule, lui dit: « Qu'avez-vous à me communiquer ? » Cavalier ne fut pas déconcerté, ni par les paroles dédaigneuses, ni par l'aspect imposant de son royal interlocuteur ; en termes simples, mais fermes, il fit l'apologie des Cévenols. « Ils n'ont, dit-il, pris les armes que parce qu'ils y ont été contraints par les cruautés des prêtres ; leur conscience leur a fait un devoir impérieux de ne pas embrasser la foi romaine. » Le roi ne s'irrita pas de sa hardiesse. « Nous sommes prêts, Sire, continua Cavalier, verser tout notre sang pour le service de Votre Majesté, si votre clémence nous couvre de son pardon, et si elle daigne réaliser les promesses de Monseigneur le maréchal de Villars. » Louis fronça les sourcils. « Ne me parlez pas de cela, dit-il vivement à Cavalier, si vous ne voulez pas encourir mon indignation ; si les rebelles se soumettent, je verrai ce que j'aurai à faire. » Brusquant la conversation, il lui demanda si le duc de Savoie lui avait envoyé de l'argent. « Non, Sire. » Louis, passant à un autre sujet, reprocha à Cavalier les cruautés des Camisards. « Ils ont, lui dit-il, brûlé les églises et les couvents, incendié des bourgs et des villages, tué des prêtres... - Ils n'ont fait, lui répondit, sans se troubler, le jeune Cévenol, qu'user de représailles; » et en paroles de feu, il lui raconta les expéditions sanglantes de Montrevel et notamment le massacre du moulin de Nîmes. Louis, étonné, se tourna vers Chamillard « Quelle est, lui dit-il, cette affaire ? » On la lui avait cachée ! « Ces gens que le maréchal fit tuer, répondit le ministre en balbutiant, étaient de, misérables vagabonds dignes du châtiment qu'il leur infligea .- C'est faux! s'écria vivement Cavalier ; si j'ai menti, Sire, punissez-moi. » Le roi comprit et n'insista pas. « Voulez-vous vous faire catholique ? lui dit-il. - S'il vous faut ma vie, Sire, prenez-la, elle est à vous ; quant à ma religion, je n'en changerai jamais ! » Louis ne parut pas offensé de son refus. Voyant que le chef huguenot n'avait pas de révélations plus importantes à lui faire, il lui dit : « C'est bien, à l'avenir soyez plus sage. » Et d'un geste il le congédia, comme il eût congédié un valet. Cavalier s'inclina et sortit. Chamillard, qui l'accompagnait, s'étonna de son refus d'embrasser la religion du roi. « Si vous le faisiez, lui dit-il, votre père aurait une pension de 100 livres et vous un brevet de maréchal de camp. » Cavalier était vaniteux, mais il avait une âme noble et fière. Il avait pu se laisser enlacer dans les filets de Villars, tout en s'efforçant de croire qu'il servait la cause de Dieu ; mais les principes religieux qu'il avait repus sous le toit paternel étaient trop profondément enracinés dans son cœur pour qu'il eût même l'idée, pour une épée de maréchal de camp, de faire le saut périlleux. S'il n'avait pas l'amour de Dieu comme un vrai chrétien, il en avait la crainte ; il savait qu'en abjurant, il perdrait son âme, parce qu'il agirait contre les lumières de sa raison et le cri de sa conscience. A la proposition de Chamillard, il répondit : « Jamais ! - Vous êtes un entêté, » lui dit le ministre: Bientôt après, le chef camisard quittait Paris qu'il ne devait plus revoir et allait rejoindre sa troupe à Mâcon. À peine arrivé dans cette ville, il reçut des lettres dont le contenu l'impressionna vivement: « Craignez, lui disait-on, pour vous et pour vos braves compagnons. » Ces avertissements lui donnèrent de l'inquiétude ; instinctivement il sentait qu'un grand danger le menaçait ; il se tenait sur ses gardes ; mais ne communiquait pas ses craintes à ses fidèles Camisards, qui jouissaient avec délices, après tant de jours orageux, du repos que leur offrait Mâcon. Ils y avaient en abondance ce qui leur avait si souvent manqué dans les Cévennes : du pain, de la viande, des souliers, des vêtements ; ils croyaient même par moment au rétablissement de l'édit de Nantes. En face des églises catholiques ils avaient leur lieu de culte ; ils y assistaient sans armes, et ni prêtres ni milices armées ne venaient les y troubler. Un jour un Suisse aborda Cavalier : « Tenez-vous sur vos gardes, lui dit-il, on veut vous enfermer, votre vie durant, dans la forteresse de Neuf-Brisach. » Ces paroles le rendirent de plus en plus vigilant ; et il ne douta plus du sort qui l'attendait, quand vers la fin d'août (1704) il reçut l'ordre de se mettre en route pour Neuf-Brisach, et surtout quand l'homme chargé de l'escorte était le célèbre Lalande. Cavalier ne fit pas la moindre résistance, ensevelit ses appréhensions au fond de son. Cœur, dans la crainte d'éveiller le plus léger soupçon dans l'esprit de celui qui, n'ayant pu être son vainqueur, aurait été, selon toutes les probabilités, son geôlier. Il marchait donc avec sa troupe d'étape en étape, comme si sa destination eût été d'aller combattre les Impériaux sur les bords du Rhin. Lalande croyait déjà tenir sa proie, et, aussi impénétrable que Cavalier, il ne disait pas un mot qui pût faire soupçonner à ce dernier ce qui l'attendait à Neuf-Brisach. Arrivé à Onay, à trois lieues de la frontière suisse, Cavalier crut le moment arrivé pour échapper à son futur geôlier. Il .était seul avec ses compagnons. « Frères, leur dit-il, nous sommes trahis ; si nous entrons à Neuf-Brisach, nous n'en sortirons jamais. Ce soir, à neuf heures, quand on nous croira endormis, prenons la fuite. » À l'heure indiquée et au moment où Lalande croyait que les Camisards s'abandonnaient au sommeil, Cavalier donne le signal de la fuite, sa troupe le suit. En quelques heures, il gagne le pays de Montbéliard, traverse le Porrentruy; il était sauvé! Le 1er septembre 1704, Lausanne fut témoin d'un spectacle des plus touchants : le chef cévenol, suivi de ses compagnons, gravit les degrés qui conduisent à sa belle cathédrale, pénètre dans le sanctuaire et rend publiquement, au milieu d'une foule immense d'assistants, des actions de grâces à Dieu qui l'a délivré, ainsi que sa troupe, de la gueule du lion. CHAPITRE XVIII
Les Camisards après la capitulation de Cavalier. - Aspect triste et douloureux que présente leur camp. - D'après l'ordre de Villars, d'Aigaliers s'abouche avec Roland. - Refus de ce dernier de déposer les armes aux conditions proposées par le baron. - Villars a recours à des mesures de rigueur. - Un nouveau cri de douleur retentit dans toutes les Cévennes. - Roland et Mlle de Cornelly, sa fiancée. - Héroïsme de cette jeune huguenote. - Un traitre livre Roland au maréchal. - Le château de Castelnau-Valence. - Scènes tragiques dont il est le théâtre. - Mort de Roland. - Son cadavre est promené en triomphe à Uzès et brûlé en grande pompe à Nîmes. - Parallèle de Roland et de Cavalier. - Que devint Mlle de Cornelly. Retournons maintenant au camp des Camisards, affaiblis mais non découragés par la défection de Cavalier. Ces hommes au cœur d'acier ont depuis longtemps fait le sacrifice de leur vie; ce qu'ils redoutent, ce sont moins les sabres et les balles des milices royales que le manque des choses les plus nécessaires à la vie. Ils ont une nourriture chétive, souvent insuffisante ; leurs vêtements tombent en lambeaux, leurs souliers sont usés; pour s'abriter, ils n'ont que la voûte du ciel. Le jour, ils ont la chaleur ; la nuit, le froid ; et pour comble d'infortune, du sommet de leurs montagnes, ils n'aperçoivent pas à l'horizon les voiles anglaises, si impatiemment attendues. Poursuivis, traqués par les soldats de Villars, ils ne peuvent compter ni sur la bourgeoisie, ni sur la noblesse protestante, courbées avec une terreur respectueuse devant le bâton du maréchal. Tout leur fait défaut, tout, si ce n'est leur indomptable énergie qu'ils puisent dans leur confiance en Dieu et la sainteté de leur cause. Aussi ce n'est pas sans un attendrissement mêlé d'admiration que nous arrêtons nos regards sur ces paysans cévenols, aux traits amaigris par les souffrances et hâlés par le soleil, qui soutiennent depuis deux ans et demi une lutte, à vues humaines impossible. Notre intention, en commençant ce livre, n'étant que d'écrire la vie de Jean Cavalier, nous nous contenterons de raconter, dans un récit rapide et sommaire, les événements qui se passèrent dans les Cévennes, après que le jeune chef cévenol eut disparu de la scène, où sa présence avait jeté tant d'éclat. Ceux des lecteurs de ce livre qui désireront des détails plus circonstanciés, les trouveront dans mon Histoire de la Réformation française. (1) (1) Histoire de la Réformation française, volume VI et VII. Le maréchal de Villars, trompé dans ses espérances, voulut, avant d'en venir à des voies de rigueur qui lui répugnaient, faire une dernière tentative pour amener Roland à une capitulation. Il lui dépêcha le complaisant d'Aigaliers, qui continuait à se nourrir d'illusions. Le baron se rendit à Durfort, auprès de Roland. Leur entrevue fut orageuse. Le chef des enfants de Dieu mit à sa capitulation des conditions inacceptables ; il demandait ce que l'orgueilleux Louis XIV ne pouvait accorder : le rétablissement de cet édit de Nantes qu'il avait révoqué. D'Aigaliers, aussi honteux que désappointé, retourna auprès du maréchal et lui fit connaître le résultat de ses négociations ; Villars comprit qu'il ne devait, désormais, demander qu'à la force seule ce qu'il avait attendu, mais vainement, de sa diplomatie. Les rigueurs, un moment suspendues, reprirent leur cours, et un cri de douleur retentit dans toutes les Cévennes ; les prisons et les bagnes, fermés, se rouvrirent et se peuplèrent de nouveaux hôtes. Les Camisards, à leur tour, sautèrent sur leurs armes, et le sang coula comme aux jours les plus mauvais de cette guerre fratricide. Roland et ses braves lieutenants se multipliaient. L'espérance, cette dernière planche de salut des infortunés, les soutenait ; ils se battaient, à leur manière, en braves, et, tout en combattant, leurs regards se dirigeaient du côté de la mer : « Le secours, disaient-ils, vient de Dieu; il nous l'enverra. » Le secours n'arriva pas, mais la trahison vint. Dans toutes les guerres, il est extrêmement rare qu'il n'y ait pas un traître qui , à lui seul, ne fasse pas ce que la force et quelquefois le génie militaire sont impuissants à faire. Ce traître se trouva : un jeune Camisard, nommé Malarte, qui vivait dans l'intimité de Roland, livra son chef à Villars. Roland, par ses manières distinguées et son héroïsme, avait touché le cœur de Melle de Cornelly. (1) Cette jeune fille, sans que jamais un seul instant la calomnie eût osé essayer de la salir de son venin, accompagnait Roland dans ses courses et partageait ses dangers. Leur mariage devait se célébrer à l'issue de la guerre. Montrevel la fit prisonnière et lui donna un couvent pour prison. Un jour, il lui offrit 400 pistoles, si, en échange, elle voulait engager Roland à déposer les armes. C'était très-tentant pour cette jeune fille, qui aimait passionnément Roland ; mais, plus huguenote encore qu'amante, elle refusa noblement et dit à Montrevel : « Roland ne veut pas se rendre, l'Esprit le lui défend. » (1) Le château de Cornelly, situé au-dessus de la Salle, ne serait-il pas le berceau de l'héroïne Quelque temps après, elle fut mise en liberté. Le 14 août 1704, Roland, accompagné de Melle de Cornelly, s'était retiré au château de Castelnau-Valence, près Brignon, où il se proposait de passer la nuit avec sa troupe ; il s'y croyait en sûreté, mais le traître veillait ; il dénonça à Parate le lieu de la retraite de son chef, de celui qui l'honorait de sa confiance. Parate, à la faveur des ténèbres de la nuit, se dirigea avec un fort détachement de troupes vers l'antique manoir. La sentinelle, qui du haut d'une tour veillait, donna le signal d'alarme. Roland se réveille en sursaut ; sa première pensée est pour sa fiancée, qui repose dans une chambre du château ; il la fait évader par une poterne ; puis, d'une voix tonnante, il ordonne à ses soldats de décamper, et lui, l'épée à la main, suivi de cinq de ses lieutenants, il cherche son salut dans la fuite, car il a compris de suite que toute résistance est impossible. Les dragons de Parate se mettent à la recherche des fuyards ; mais le seul qu'ils désirent atteindre, c'est Roland ; les autres leur importent peu. Ils l'aperçoivent et s'élancent vers lui. Roland voit le danger; il s'adosse à un chêne qui existe encore, là il attend de pied ferme ses ennemis. Il est armé jusqu'aux dents, sa ceinture est garnie de pistolets ; sur les trois premiers soldats qui s'approchent, il lâche habilement son feu et les étend roides morts à ses pieds. Il va le continuer, quand l'un de ses assaillants, furieux de la mort de ses compagnons et oubliant l'ordre de prendre vif le chef cévenol, décharge sur lui, à bout portant, sa carabine. Roland ne pousse pas un soupir : atteint au cœur, il était mort. Raspal, Coutereau, Mallié, Grimaud, Guérin, ses braves lieutenants, qui se défendaient en lions, laissent tomber leurs armes à la vue de leur chef mort, se jettent en pleurant sur son cadavre et se laissent prendre comme des agneaux. Pendant que cette tragique scène se passait, Mlle de Cornelly, grâce à l'obscurité de la nuit et à la vitesse de son cheval, échappait aux dragons mis à sa poursuite. Parate était triomphant, il regrettait de n'avoir pas pris Roland vivant, mais enfin, il avait son cadavre, c'était une proie assez belle ; ce cadavre, tout Uzès le vit le lendemain. Le commandant catholique, en entrant dans la ville, le portait comme un trophée sur l'arçon de la selle de son cheval de bataille ; et pour qu'on ne répandit le bruit que le chef cévenol n'était pas mort, Uzès, pendant toute une journée, vit un homme qui parcourait ses rues, tenant par la bride un cheval sur lequel était le cadavre de Roland. De temps en temps, cet homme s'arrêtait et disait à haute voix : « Voilà le corps de Roland, le fameux chef camisard ! » Cette oraison funèbre, dans la bouche d'un ennemi, était digne du héros cévenol. Ici nous allons, ce qui nous est permis, nous copier nous-mêmes. Roland fit son entrée funèbre à Nîmes au milieu d'une foule immense, qui se pressait avidement autour du char qui traînait son cadavre ; chacun voulait contempler les traits de l'homme qui avait rempli le Languedoc du bruit de ses exploits. Bâville, rayonnant de joie, monta sur son siège de juge, fit le procès au cadavre de l'illustre mort et le condamna à être traîné sur la claie et ensuite à être brûlé. La sentence s'exécuta avec un grand appareil. Quand le corps de Roland eut été consumé par les flammes, ses cendres furent jetées au vent. Les cinq officiers qui, après la mort de leur brave chef, s'étaient laissé prendre sans résistance, furent exécutés peu de temps après. Fléchier et quatre autres prélats voulurent les voir mourir; leur joie, qu'ils ne surent pas dissimuler, indigna même les catholiques. Les prisonniers ne démentirent pas leur nom de Camisard. Ils furent aussi grands sur l'échafaud qu'ils avaient été intrépides sur les champs de bataille. Roland avait à peine trente ans quand il termina sa courte et orageuse carrière ; son nom, moins populaire que celui de Cavalier, a sa place marquée à côté de celle du pâtre de Ribaute, ni au-dessus, ni au-dessous. Ces deux chefs se complétaient : Cavalier avait plus d'élan, Roland plus de prévoyance ; le premier rappelle Andelot, le brave des braves; le second, l'indomptable et patient Coligny. Cavalier se battait souvent pour le plaisir de se battre, Roland poursuivait toujours un but. Tous les deux, ils firent des prodiges de valeur, et étonnèrent Villars, un maître dans l'art de la guerre, Cavalier par ses brillantes improvisations, Roland par la profondeur de ses combinaisons. L'un et l'autre exercèrent une influence puissante sur leurs soldats et leurs lieutenants, et servirent la même cause, le premier avec l'enthousiasme de la jeunesse, le second avec les réflexions de l'âge mûr. Il ne leur manqua qu'une éducation militaire et un plus vaste théâtre pour se placer, Cavalier à côté du grand Condé, Roland à côté de Turenne. Ils firent tous les deux leur entrée triomphale dans Nîmes ; le premier sur son cheval de bataille, au milieu des acclamations enthousiastes des huguenots ; le second sur son char funèbre, au milieu des cris, des larmes et des sanglots de ses frères. Le nom de Cavalier est devenu un nom presque légendaire ; celui de Roland demeure à demi voilé, et cependant le chef ne le cède en rien à son lieutenant, qu'il surpasse en grandeur morale. Puissent ces lignes rendre au neveu du brave Laporte, dans le souvenir des protestants, la place qu'il occupa parmi ses braves Camisards ! Que devint Melle de Cornelly après la mort de son fiancé ? Nul, jusqu'ici, n'a su le dire ; on aimerait cependant à le connaître, tant cette jeune héroïne cévenole nous inspire un profond intérêt. Cependant autant que cela peut être permis à un historien, nous croyons qu'elle dut demeurer fidèle au souvenir de l'homme qui, à ses yeux, personnifiait le héros protestant, et prendre des vêtements de deuil pour ne les quitter que le jour où la mort la coucha dans un cercueil; pour nous, Mlle de Cornelly n'a pas vieilli, elle est toujours la jeune fille belle, pieuse, intrépide, dont l'esprit élevé ne s'est pas arrêté à des exigences de famille et de caste, et qui, dans un paysan de Mas- Soubeyran, a découvert la première des noblesses, celle du cœur. CHAPITRE XIX
Villars quitte le Languedoc et va recevoir à Paris la juste récompense de ses services. - Les Camisards à Genève. - Ils y sont un objet de répulsion. - L'abbé La Bourlie essaye d'insurger de nouveau les Cévennes. - Les chefs camisards entrent dans ses plans. - De Genève ils se dirigent vers le Languedoc. - Terreur de Bâville. - Arrestation et exécution de Castanet. - Son héroïsme. - Fin tragique de Ravanel, de Catinat et des autres chefs. Par la mort de Roland, la guerre des Camisards était, en réalité, terminée; car les insurrections qui suivirent ne furent que les dernières convulsions d'un corps atteint dans les sources mêmes de la vie. Aussi le maréchal de Villars, ne croyant plus sa présence nécessaire, retourna à Paris, où l'attendaient les faveurs de Louis XIV, qui récompensa royalement l'heureux et habile pacificateur des Cévennes. Les États du Languedoc se montrèrent également reconnaissants : ils lui offrirent un don de 12,000 livres, et à son épouse un de 8,000. Le clergé, par l'organe de Fléchier, appela sur lui les bénédictions d'en haut. Comment ne l'eût-il pas fait ? Le maréchal avait frappé à la tête et au cœur l'hérésie, et, à ses yeux, désormais, le protestantisme en France n'était destiné qu'à vivre dans l'histoire ; aussi, comme aux grands jours de fêtes, le clergé nîmois déploya toutes les pompes de son culte : les voûtes de ses églises résonnèrent de ces Te Deum toujours au service des pouvoirs qui s'élèvent, alors même qu'il en est aux regrets de ceux qui tombent. Pendant que le clergé rendait, à sa manière, c'est-à-dire en chantant, grâces à Dieu de la défaite des Camisards, ceux qui avaient échappé aux balles ennemies et ne voulaient pas prostituer leur nom de protestant en prenant celui de nouveau converti, se dirigeaient, pour la plupart, vers Genève, où les avait précédés leur réputation ; aux yeux de leurs frères de cette ville, ils étaient des héros hauts de dix coudées et leurs chefs des Guillaume Tell. Leur admiration s'évanouit à la vue de ces hommes agrestes, mal vêtus, mal peignés, au langage rustique. Entre tous, les prophètes firent la plus mauvaise impression : on les trouva ridicules, inconvenants ; et cependant ce furent ces paysans qui, pendant plus de deux ans, avaient tenu en échec la fortune de Louis XIV dans les Cévennes et qui auraient peut-être contraint l'orgueilleux monarque à rendre aux protestants l'édit de Nantes, si ses ennemis avaient compris que c'était au cœur même des Cévennes qu'il fallait l'attaquer. 5 000 hommes, de l'argent et des vivres auraient suffi pour insurger le Rouergue, le Dauphiné, les Cévennes, le Poitou. Ils ne le comprirent pas : ils n'avaient vu dans l'insurrection camisarde qu'une émeute sans importance. Dieu, dont les desseins sont insondables, ne le permit pas. Le rétablissement de l'édit de Nantes eût empêché la chute des Bourbons : Dieu la voulait; car cette maison royale avait répandu trop de sang chrétien pour qu'il ne la frappât pas dans sa justice comme il avait frappé celle de Saül, fils de Kis, en brisant, aux jours déterminés par son conseil, ce sceptre dont elle avait tant abusé. Les lecteurs de ce petit livre désirent naturellement connaître ce que devinrent les chefs camisards après la mort de Roland. Nous allons les satisfaire, toutefois en abrégeant des récits qui, à eux seuls, demanderaient autant de pages que nous en avons écrit. Bâville, après le départ de Villars, se disposait à quitter le Languedoc pour aller demander à son maître la récompense de ses longs et sanglants services, et attacher à son nom le titre de pacificateur des Cévennes, quand tout à coup il apprit que l'abbé La Bourlie, plus connu dans l'histoire sous le nom du marquis de Guiscard, avait formé le projet, avec le marquis de Miremont et de Belcastel, de soulever les Cévennes. L'intendant, qui croyait en avoir fini avec les Camisards, tressaillit de colère, et, à sa demande, le maréchal de Berwick vint prendre le commandement du Languedoc. Aussi brutal que Montrevel, Berwick avait ce que n'avait pas le destructeur des hautes Cévennes, le coup d'œil du parfait militaire. Catinat et Castanet, qui s'étaient retirés à Genève, s'y ennuyaient à ne rien faire ; les jours leur paraissaient d'une longueur démesurée. Cette vie oisive les fatiguait plus que les marches les plus forcées aux jours où ils étaient d'une aube à l'autre sur pied ; aussi quand La Bourlie les fit sonder pour savoir s'ils voulaient entrer dans le complot, leur cœur bondit de joie, et sans calculer, ni même penser aux dangers de l'entreprise, ces deux chefs résolurent de quitter Genève. Catinat partit le premier et arriva dans les Cévennes, où sa présence causa une émotion profonde. Berwick mit tous ses régiments sur pied, comme s'il se fût agi d'aller se mesurer avec un corps d'armée ennemi sur les bords du Rhin ou aux frontières d'Espagne. Castanet, quelques jours après le départ de Catinat, se dirigea vers le Vivarais, arriva à Vals et prit avec lui deux hommes déterminés, Valette, de Vals, et Boyer, des environs de Vallon. Ils passèrent sous Aubenas, traversèrent Lagorce, Vallon, Salavas, Barjac, se rendirent à Saint-Jean de Marvéjols, et arrivèrent à Rivière. Bâville veillait ; il avait ses agents partout, offrant de l'or à qui lui livrerait les chefs camisards, menaçant de la mort celui qui, connaissant leur retraite, ne les dénoncerait pas. Chez lui, rien n'avait vieilli : sa hache et sa corde étaient neuves, comme le premier jour où il les essaya. Un paysan de Rivière, ou peut-être des environs, soit par cupidité, soit par crainte, découvrit au capitaine Muller la retraite de Castanet et de ses compagnons. L'officier les arrêta et, sans forme de procès, il fit couper la tête à Boyer et força Castanet à la porter ; c'est avec ce sanglant trophée à la main que l'ancien garde de l'Aigoâl fit son entrée funèbre dans Montpellier. A la nouvelle de la captivité de son époux, Mariette alla se jeter aux pieds de Berwick pour lui demander sa grâce. C'était peine perdue : le sépulcre eût rendu plutôt son mort que le maréchal lâché une si belle proie. Castanet n'était pas un Camisard ordinaire : c'était un chef hardi, intrépide, qui avait souvent donné de ses nouvelles à Bâville par ses hardis coups de main ; son procès ne fut pas long. L'intendant, du haut de son tribunal, fit descendre un arrêt de mort que Castanet écouta avec la plus grande impassibilité ; mais là où se révéla, dans tout son éclat, la force d'âme du garde forestier de l'Aigoàl, ce fut au moment où le bourreau se fatiguait à le torturer ; il le regardait faire comme s'il se fût agi d'un autre ; les noms de ses complices, qu'on voulait lui arracher par la douleur, demeurèrent ensevelis dans son cœur : il ne nomma personne. Quand il fut conduit sur le lieu de son supplice, il put promener ses regards sur plus de 12 000 personnes accourues des environs pour le voir mourir ; parmi elles se trouvaient des huguenots qui faisaient des efforts pour retenir leurs larmes, de peur d'être reconnus. Deux prêtres accompagnaient Castanet et l'exhortaient à se réconcilier avec l'Église. Le prisonnier ne les écoutait pas ; son âme, prête à comparaître devant Dieu, était ailleurs. Les prêtres redoublèrent d'instance et d'importunités. Castanet, arrêtant sur eux un regard où le dédain se mêlait à l'impatience, leur dit : « Retirez-vous, sauterelles de l'abîme, maudits tentateurs; que venez-vous faire ici ? - Vous consoler », lui dit l'un d'eux. Le Camisard se tourne alors vers le bourreau, et sans répondre au prêtre, il dit à l'exécuteur : « Fais ton office.» Le prêtre insiste. Castanet, d'une voix forte et qui fut comprise, lui dit : « je veux mourir dans la religion dans laquelle je suis né ! » Le bourreau, à un signal donné, saisit le patient, et lui, ferme comme un roc, meurt comme il a vécu, en vrai Camisard. Le supplice de Castanet consola Bâville de ses mécomptes ; mais quelque chose manquait à sa joie, qui eût été complète, s'il eût pu, du même coup de hache, faire tomber la tête de tous les chefs cevenols ; aussi mettait-il à leur recherche ses espions, cherchant, à prix d'or, des traîtres. Catinat et Ravanel ne tardèrent pas à tomber entre ses .mains. Leur exécution eut lieu à Nîmes, sur l'Esplanade, en face d'une assemblée innombrable. Rien ne manqua à l'appareil funèbre ; si Bâville eût pu inventer un supplice plus douloureux que la roue, il en eût fait joyeusement l'application aux deux chefs camisards qui, unis dans la vie, le furent dans la mort. « Plus tard, Joany, Lafleur, Salomon, Abraham, le baron d'Aigaliers, Fidel périrent de mort violente. La mort ne se lassa pas de frapper. Bâville avait vaincu l'insurrection ; il pouvait, après trente-six ans de séjour dans le Languedoc, dont il avait fait une solitude, se présenter à son maître et lui demander la récompense de sa longue fidélité. Si agir, c'est vivre, le roi du Languedoc avait vécu de longs jours; sa présence, dans son intendance, ne fut qu'une action continue qui, chez toute autre nature que la sienne, aurait brisé, sinon affaibli, les ressorts de la vie. Chez lui, rien n'avait vieilli que le corps. Sa haine contre les protestants, loin de s'affaiblir, ne fit que s'accroître avec les années ; quelques jours avant de descendre dans la tombe, il rédigea avec Fleuri et Tressan le célèbre édit de 1724, qui, le code noir de la Réforme ; le sanguinaire vieillard n'oublia rien, et comme si les édits de Louis XIV n'eussent pas été suffisants pour anéantir un pauvre peuple opprimé, aux rigueurs anciennes il en ajouta de nouvelles ; et puis, sans que sa conscience lui reprochât un seul acte de son sanglant passé, il put dire comme l'odieux Le Tellier : « Laisse maintenant, Seigneur, aller en paix ton serviteur. » Pendant que tant de noms connus et même célèbres disparaissent peu à peu dans la fosse commune, Bâville demeure un vivant : c'est sa punition dans l'histoire. Il n'en méritait pas d'autre.  Jean Cavalier CHAPITRE XX
Cavalier à Lausanne. - Le marquis de Furieux, ambassadeur de Louis XIV, s'inquiète de sa présence. - Sa lettre à Messieurs de Berne. - Fermeté des magistrats bernois. - Cavalier en Hollande. - Il continue à être un objet d'inquiétude pour - Cavalier prêt à entrer avec le duc de Savoie dans les Cévennes. - Le projet d'invasion avorte. - Cavalier à la bataille d'Almanza. - Choc de deux régiments. - Brillant fait d'armes. - La défaite de l'archiduc Charles ôte à Cavalier tout espoir d'une nouvelle insurrection. - Son séjour en Hollande. - A-t-il épousé la plus jeune fille de Mme Dunoyer ? - Cavalier gouverneur général de I'Île de Jersey. - Sa mort à Chelsea. Nous avons laissé Cavalier et ses braves compagnons dans la belle et gracieuse cathédrale de Lausanne; nous aimons à les trouver là, à genoux, rendant à Dieu des actions de grâces de les avoir délivrés des mains de Lalande et d'une captivité plus dure que ne l'eût été pour eux la plate-forme d'un échafaud. Comme aux jours de leurs combats, ils sont serrés autour de leur jeune chef, pour lequel, malgré sa capitulation, rien n'a vieilli, chez eux, ni l'estime, ni l'admiration ; ils ont, en franchissant la frontière suisse, dit adieu à la mère patrie ; cet adieu n'a pas été sans tristesse, sans serrements de cœur ; mais pour ces hommes, qui aiment autant le prêche qu'ils haïssent la messe, la patrie, la vraie patrie, est celle où l'on peut adorer son Dieu en toute liberté. Qui oserait les blâmer de préférer l'exil à une lâche apostasie ? Honneur donc à ces hommes rustiques qui nous donnent un exemple si éclatant de la fidélité aux convictions religieuses et qui vont, pour la plupart, mourir sur la terre étrangère, ignorés de tous, excepté de Dieu, auquel ils sont demeurés fidèles. Revenons à leur jeune chef, objet de l'empressement et de l'admiration de ses nouveaux hôtes ; il souffrait de son repos. Lui, l'homme des combats, des batailles, des assauts, il se trouvait tout à coup transporté dans une ville où tout était paix, repos, tranquillité ; et cependant, sans sortir des conjectures permises à l'historien, nous ne croyons pas nous écarter de la vérité en disant que le jeune chef camisard devait passer des heures pénibles, quand, de Lausanne, la belle, la ravissante, avec son lac bleu à ses pieds et son splendide rideau de montagnes aux cimes neigeuses, il dirigeait ses regards du côté de ces abruptes et sauvages Cévennes, témoins muets, mais vivants, de ses hardis coups de main. On s'y battait ; Roland, Castanet, Ravanel, Catinat, Lafleur, Joany, Fidel y défendaient, au péril de leur vie, la sainte cause qu'il avait abandonnée. Ces hommes au cœur intrépide, naguère encore ses amis, devaient lui infliger le nom de traître. À leurs yeux, il n'était qu'un misérable ambitieux qui avait déposé les armes pour une pension et les épaulettes de colonel ; sans doute, il devait essayer de se justifier à ses propres yeux ; mais la manière dont on l'avait traité, après sa capitulation, devait aussi lui faire regretter amèrement de s'être séparé de son noble chef Roland et de ses intrépides lieutenants. Nous qui écrivons sa vie, nous aurions aimé le voir reprendre le chemin des Cévennes, gagner le camp de ses frères et leur dire : « Me voici prêt à défendre avec vous la sainte cause dans laquelle nous sommes engagés, prêt à mourir sur un champ de bataille ou sur un échafaud. » Il aurait pu le faire sans forfaire aux lois de l'honneur militaire. Louis XIV, avec lequel il avait traité, lui avait rendu sa parole le jour où son gouvernement avait donné à Lalande l'ordre de l'enfermer à Neuf-Brisach. Cavalier ne le fit pas; qui le retint ? crut-il à l'impossibilité de faire triompher sa cause par les armes ? Nous sommes assez porté à le croire, car ce chef est de la famille de ces hommes qui ne reculent jamais devant le danger, parce qu'ils s'y complaisent. Cavalier ne demeura pas, cependant, oisif, car ses regards ne cessèrent pas de se tourner vers la France et de rêver pour ses coreligionnaires la liberté religieuse. Sa présence à Lausanne inquiéta le marquis de Puysieux, ambassadeur du roi de France auprès de Messieurs de Berne. Il écrivit à ces derniers une lettre dans laquelle il s'étonnait que Lausanne eût osé donner asile à un traître tel que Cavalier, et, sans le dire textuellement, il attendait de leur titre d'anciens et fidèles alliés de la France, qu'ils ne voudraient pas désobliger Sa Majesté très chrétienne en souffrant sur leurs terres des misérables, indignes de trouver un asile dans quelque partie de la terre que ce fût. Messieurs de Berne répondirent à M. le marquis de Puysieux ; leur lettre est un modèle de modération et de fermeté ; ils maintiennent leur droit de donner asile à ceux de leurs coreligionnaires que les persécutions forcent de quitter leur patrie ; ils ne font, du reste, que ce que fait la France quand elle reçoit comme ses hôtes les Anglais et les Irlandais qui ont quitté leur patrie à la suite de la guerre qui a vu Jacques II perdre son trône, et qui, aux yeux de leurs pays, sont de plus grands rebelles que les Cévenols. Devant la fermeté de Messieurs de Berne, M. de Puysieux n'insista pas, et Cavalier et ses compagnons jouirent en paix de la noble hospitalité de la Suisse ; elle en fut dignement récompensée, car pendant que Louis XIV, par son aveugle fanatisme, appauvrissait son royaume en forçant ses meilleurs sujets à s'exiler, la Suisse, ainsi que la Hollande et d'autres contrées, s'enrichissaient de leur présence. Cavalier avait, déposé les armes, et cependant le jeune exilé, qui avait quitté la Suisse pour aller en Hollande, troublait le sommeil de Bâville ; à chaque bruit qui lui venait des Cévennes ou du Vivarais, il se figurait le chef camisard au milieu des insurgés, le forçant à mettre un maréchal de France en campagne pour éteindre un nouvel incendie dans son foyer. Fléchier n'était pas moins craintif que Bâville. Le prélat, ayant appris que le chef huguenot s'était embarqué dans la flotte anglaise, tressaillit de joie. « Ce vaisseau, écrit le pieux prélat (lettre du 15 août 1706), périra sans doute, étant chargé de tant de crimes ; quelque orage imprévu s'élèvera et le brisera contre quelque effroyable rocher ; aussi bien ce scélérat serait-il venu périr ici sur une roue ?» Fléchier, quand il écrivit cette lettre, avait oublié les causes si légitimes qui avaient mis les armes à la main des Cévenols. Mais l'esprit de parti ne raisonne pas, et chez un prêtre, moins que chez tout autre : chez lui tout est passion. Les alliés, alors en guerre avec Louis XIV, avaient les yeux sur Cavalier et comptaient bien s'en servir au besoin. Mais par une fatalité incompréhensible, le seul homme qui eût pu raviver le feu cévenol et recommencer une nouvelle guerre des Camisards, plus dangereuse que la première, fut toujours éloigné des lieux où sa présence aurait donné de vives et sérieuses inquiétudes à Louis XIV. Ses ennemis, nous l'avons dit, pour ne pas avoir compris que le côté vulnérable du grand roi était, non les bords de l'Escaut ou du Rhin, mais les Cévennes, laissèrent échapper la plus belle des occasions de l'humilier et de le forcer à donner la paix à l'Europe, si longtemps troublée par son insatiable ambition. Cavalier était une force, ils le savaient : ils s'en servirent, mais pas au moment favorable; et quand tout paraissait prêt et que le duc de Savoie traversait avec Cavalier le Var pour, de là, pénétrer dans les Cévennes, Bâville savait tout. Il mit ses armées sur pied, et le nouvel incendie, prêt à embraser les Cévennes, fut éteint, grâce à sa vigilance et à sa dévorante activité. A dater de cette époque, 1707, Cavalier, qui semblait né pour la vie des camps, paraît pour la dernière fois sur un champ de bataille et s'y distingue par un acte de bravoure admiré d'un maître dans l'art de la guerre, de Berwick. Le maréchal commandait les troupes de Philippe V, l'archiduc Charles celles des alliés. De ce combat dépendait la couronne du petit-fils de Louis XIV; les deux armées se rencontrèrent dans les plaines d'Almanza ; Cavalier commandait un régiment composé d'anciens Camisards et de réfugiés. Au milieu de la mêlée, ce régiment se trouve face à face avec un régiment qui avait combattu dans les Cévennes. Des deux côtés, officiers et soldats se reconnaissent ; aussi rapide que le courant électrique, leur vieille haine assoupie se réveille ; ils s'élancent avec tant de furie les uns sur les autres que les autres combattants s'arrêtent stupéfaits. Jamais tant d'intrépidité ne se joignit à tant de fureur. Pas de quartier ; on se bat à l'arme blanche ; nul ne recule ; les pointes des baïonnettes n'arrêtent ni les Camisards, ni les milices royales ; Cavalier est au milieu de ses braves ; il ne les anime ni du geste, ni de la voix ; c'est inutile : la mort fait d'amples moissons ; la terre, ruisselante de sang, se jonche de morts et de mourants, et le combat ne finit que lorsque, des deux côtés, les deux tiers des combattants ont mordu la poussière. Dans cette journée, Cavalier se montra habile capitaine et soldat intrépide. Berwick, par ses habiles manœuvres, décida du sort de la journée. Coïncidence singulière ! les deux généraux qui avaient combattu les Camisards dans les Cévennes sauvèrent la fortune de deux rois. Berwick, à Almanza, affermit sur la tête de Philippe sa couronne qu'une défaite lui aurait ôtée, et Villars, à Denain, empêcha le démembrement de la France et consolida les conquêtes de Louis XIV. La défaite de l'archiduc Charles ôta toute espérance à Cavalier. Il retourna en Hollande, où il jouit, pendant tout son séjour, d'une grande considération. Quelques historiens ont prétendu à tort qu'il s'était marié à cette époque avec l'une des deux filles de la célèbre Mme Dunoyer, qui nous a laissé des mémoires qui sont loin d'être dénués de tout intérêt. Ce qui, toutefois, demeure hors de doute, c'est le plaisir qu'éprouvait le chef camisard dans la société d'une femme pleine d'esprit et qui était sa compatriote. L'une de ses filles, la plus jeune, lui plut; il lui fit la cour, mais le mariage qu'on lui a fait contracter avec cette jeune personne n'eut jamais lieu.  Mme Dunoyer A l'époque où Cavalier habitait la Hollande, un jeune homme, alors connu par quelques traits d'esprit et qui était appelé à une réputation retentissante, fréquentait le salon de Mme Dunoyer. Ce jeune homme, c'est Voltaire. Comme Cavalier, il ne fut pas insensible aux charmes et à l'esprit de la plus jeune fille de Mme Dunoyer. Il lui fit la cour. Ce fut tout ; il ne devint pas plus son mari que le pâtre de Ribaute. Ce fut, nous le croyons, un malheur pour lui. Marié à une femme jeune, spirituelle, belle, il eût eu les douces chances de devenir père ; père, il se serait respecté dans ses enfants et n'aurait pas sali sa plume et souillé ses cheveux blancs en publiant quelques-uns de ses écrits, plus dignes d'avoir une place dans un égout que dans une bibliothèque ; peut-être aussi se serait-il senti arrêté dans ses attaques contre le christianisme, s'il l'avait vu professé par quelques membres de sa famille. - Revenons à Cavalier; à dater de 1707 jusqu'au jour de sa mort, sa vie est aussi paisible qu'elle a été orageuse. Nommé gouverneur général de la belle île de Jersey, il occupa ses loisirs à dicter ses Mémoires à un réfugié de Nîmes, appelé Galli (1). (1). Ils parurent en anglais en 1726. Tous les historiens qui se sont occupés du célèbre Cévenol tiennent ses Mémoires pour inexacts, mais pour sincères; aussi ne les acceptent-ils que sous contrôle et sous toutes réserves. Nous trouvons cependant dans les Mémoires du chef cévenol le Cavalier que nous connaissons; il n'est pas orgueilleux, il est vaniteux ; cela perce, non pas à chaque ligne, mais un peu trop souvent, pour la gloire de notre héros, tant il est vrai que le plus sûr moyen de nous abaisser, c'est de nous élever. Le contraire, chez Cavalier, eût demandé une vertu surhumaine. Deux ans et demi de combats dans les Cévennes avaient suffi pour élever à la taille des héros le goujat de Vézenobres, l'apprenti boulanger d'Anduze. Toutefois, ce qui nous étonne chez Cavalier, nature vive, ardente, c'est le repos auquel il se condamna pendant plus de trente-deux ans ; avait-il, dans les luttes qu'il soutint de 1702 à 1707, épuisé toute son énergie militaire ? On serait assez porté à le croire, tant il semble étranger à ce qui se passe dans les contrées encore toutes pleines de son souvenir. Son nom, si souvent mêlé à ceux de Roland, de Catinat, de Ravanel, de Fidel, de Lafleur, de Castanet, ne se voit pas à côté de ceux d'Antoine Court, de Corteis, du vieux Roger, de tous ceux qui de 1715 à 1740 travaillent à la restauration des églises, dont Bâville a fait des ruines. Pendant que ces fidèles serviteurs du protestantisme s'exposent chaque jour à la mort pour la cause que Cavalier a défendue les armes à la main, le chef cévenol coule des jours paisibles dans l'île de Jersey, entouré de la considération publique et vivant d'une vie confortable à laquelle il n'avait pas été habitué dans sa jeunesse. Que de liens n'avait-il pas pour le retenir dans son île ? Il ne faudrait pas connaître le limon dont est pétrie notre pauvre nature pour nous étonner du repos auquel le jeune et bouillant Cévenol se condamna de lui-même, sans toutefois s'en rendre trop raison, par suite de cet affaiblissement moral dont il est difficile de se débarrasser, parce qu'on n'en a pas conscience. Toutefois, les trente-trois dernières années de la vie de Cavalier ne sont pas sans quelque dignité, si elles sont sans auréole. Il fut fidèle à la foi protestante, pour laquelle il avait tant de fois exposé sa vie. Il rejeta toujours les offres brillantes qu'on lui fit en échange d'une abjuration, et c'est avec bonheur que celui qui écrit aujourd'hui sa vie, a vu aux Tavernes, près de Ribaute, une lettre écrite de la main de Cavalier, dans laquelle il exhorte l'une de ses parentes de vivre et de mourir dans la foi protestante. Cette lettre, il l'écrivait peu avant sa mort ; un ton sérieux et mélancolique y règne, et l'on n'y sent pas ce patois de Canaan, dont nous devrions avoir le bon goût de nous déshabituer. L'homme que les balles des milices royales avaient si souvent épargné et qui ne devait avoir, à vues humaines, pour lit de mort qu'un champ de bataille ou un bûcher, expira doucement dans son lit, le 18 mai 1740, à Chelsea (aujourd'hui l'un des quartiers de Londres), paroisse du révérend Burgess, qui depuis tant d'années porte un si vif intérêt à l'avancement du règne de Dieu dans notre chère patrie. Cent vingt-trois ans se sont écoulés depuis la mort du célèbre chef camisard. Le temps, qui jette son linceul d'oubli sur tant de noms, même célèbres, a respecté le sien ; et quel que soit le jugement qu'on porte sur le pâtre de Ribaute, nul ne refusera au soldat le courage, au capitaine le génie militaire, au huguenot la fidélité aux convictions religieuses.  Jean Claude CHAPITRE
XXI
Coup d'œil rétrospectif sur le théâtre sanglant de la guerre des Camisards. - Mort de Louis XIV. - Deux enfants : l'un destiné à ruiner la monarchie de Saint Louis, l'autre à rendre à la Jérusalem protestante ses remparts et ses tours. Nous terminons cet écrit en jetant un rapide coup d'œil sur les contrées qui furent le théâtre sanglant de la guerre des Camisards, au moment où Bâville quitte le Languedoc. Le terrible proconsul part calme, joyeux ; il a accompli sa tâche sans pouvoir s'adresser le reproche d'avoir faibli un seul instant; il peut, la tête haute et fière, aller demander à son maître la récompense dix fois méritée de sa longue fidélité. Il l'a servi à souhait ; les Cévennes sont pacifiées ; la paix des tombeaux y règne ; pas un seul insurgé à l'horizon ! pas un seul protestant qui ose proférer une plainte ! pas un seul temple debout ! rien qui offusque les yeux de Fléchier ! rien qui déchire ses oreilles ! le chant des Psaumes a cessé ; tout indique que l'heure solennelle a sonné, le clergé nîmois peut entonner ses Te Deum et remercier le Dieu des armées d'avoir extirpé du sol des Cévennes la plus exécrable des hérésies. Pour célébrer dignement cette grande victoire de l'Église, il manque un homme, Bossuet, celui qui, en termes si magnifiques, a félicité Louis XIV d'avoir déchiré l'édit de Nantes ; il n'eût pas failli à sa tâche, pas plus que son illustre antagoniste Claude à la sienne, en se faisant le noble et terrible écho des plaintes de ses frères, si cruellement immolés. Mais la mort a couché ces deux vaillants athlètes dans la tombe, en épargnant à l'évêque la honte de ses odieux panégyriques, au ministre la douleur de la vue des nouveaux malheurs de son peuple, malheurs que Saurin, le plus illustre des prédicateurs protestants, déplorait alors en termes aussi sentis que magnifiques, quand, du haut de sa chaire, à La Haye, il prononçait quelques-uns de ces admirables discours qui devenaient, à force d'éloquence, d'indignation et de vérité, des événements politiques. 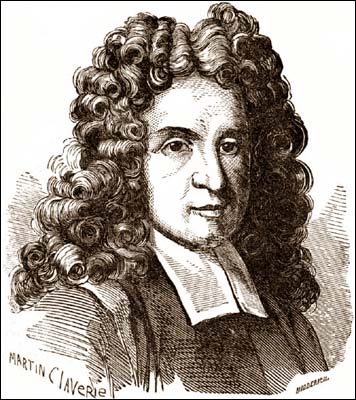 Saurin Le grand orateur nous touche et nous étonne au récit de nos malheurs, mais à quel degré d'éloquence ne se serait-il pas élevé, si, quittant sa seconde patrie, sa chère Hollande, cette arche de refuge pour ses infortunés coreligionnaires, il eût, au moment du départ de Bâville, visité ces contrées au milieu desquelles le sanguinaire vieillard avait exercé son ministère ! Quel tableau navrant ne nous eût-il pas tracé de ces villages dévastés, de ces temples en ruine, de ces champs abandonnés, et de ce pauvre peuple auquel on avait tout ravi, tout, jusqu'à ce beau nom de protestant qu'il avait illustré par sa piété sous le toit domestique, par son courage sur les champs de bataille, par sa foi sur les bûchers, par sa constance dans les cachots ! Le grand orateur, à la vue de tant de ruines fumantes, aurait quitté la France en secouant contre elle la poussière de ses pieds et aurait dit en pleurant : Le protestantisme a vécu, et cependant Dieu veillait sur son pauvre peuple ; il ne l'avait pas abandonné. Portez vos regards sur ce lit de douleur changé en lit d'agonie ; un vieillard y est étendu, le râle de la mort l'a gagné. Ce vieillard, c'est le Roi-Soleil, c'est Louis le Grand. Quelques serviteurs l'entourent, attendant l'heure fatale ; elle sonne ; le monarque s'en va vers celui devant lequel il est moins qu'un grain de poussière qui s'attache au plateau d'une balance. A la nouvelle de la mort de celui qu'on a encensé comme un demi-dieu, la France répond au glas funèbre de ses funérailles par des cris de joie ; elle se sent délivrée de l'homme qui la saigna à blanc, lui prit son dernier homme et son dernier écu, et ne l'aima jamais, parce qu'il n'aima que lui. Triste coucher de soleil que le sien, après un soleil levant si beau, si radieux ! Louis récoltait, ce qu'il avait semé pendant son trop long règne. Il laissait, après toutes ses splendeurs qui avaient ébloui l'Europe, une France abaissée, obérée, un trésor vide, une industrie ruinée, un commerce aux abois, et pour réparer ses fautes, il léguait à son peuple son arrière-petit-fils, un enfant de cinq ans, l'infâme Louis XV, ce châtiment trois fois mérité des fautes de son bisaïeul. Mais, ô admirable secret de la Providence ! pendant qu'un enfant royal devait être le ver rongeur de la monarchie de l'implacable persécuteur des protestants et la faire crouler en 1793, un enfant du peuple, un Vivaraisien, apparaissait tout à coup au milieu des Cévennes, et des débris fumants du protestantisme en faisait, à sa voix, sortir cette Église si célèbre dans l'histoire sous le nom d'Église du désert. Cet enfant, c'est l'illustre Antoine Court, (1695-1760) après Calvin, l'homme auquel les protestants français doivent le plus de reconnaissance. François Puaux, 1868
NDLR : Ce document est une publication du texte intégral de la première édition, avec les noms de lieux d’origine (ex : Aigoäl pour Aigoual). Il fait, dans sa mise en page originale 178 pages. -oOo-
|
| En savoir plus sur les guerres de religions à Nîmes > 1561 - Origine du nom PARPAILLOT > 1567 - La Michelade de Nîmes, 3 versions, Pontécoulan 1820, Nisard 1842, Ménard 1750 > Version complète de la Michelade par Léon Ménard > Version du Musée virtuel du Protestantisme > 1569 - Troisième guerre civile à Nîmes. Les religionaires surprennent la ville. > 1572 - La Saint-Barthélémy à Nîmes > 1681 - La Vie de Jean Cavalier, 1681-1740 > 1702-1705 - Les Sources de l'Histoire des Camisars, par Louis Baragnon, 1891 > 1720 - Répression de l'assemblée protestante de la grotte aux fées à Nîmes > Contact Webmaster |

